
De 1926 à 1938, Eugen Ionescu, jeune nihiliste intelligent qui aspire à la gloire littéraire, a prodigué son verbe et son talent polémique pour contrarier l’opinion publique littéraire roumaine. Le prix accordé à son volume Nu (1934. Non, Gallimard, 1986) aide à la publication d’un recueil hétéroclite et ironique qui préfigure les œuvres à venir. L’obscur poète des Poupées de chiffon (Élégies pour des êtres minuscules, 1931) se transforme du jour au lendemain en redoutable iconoclaste. « Il a fait ses preuves d’humoriste dans une direction étrangère à l’humour – la critique […]. S’il décide de s’attaquer au théâtre, à la comédie, l’avenir lui est ouvert », prophétisait le critique Şerban Cioculescu dans la Revue des Fondations Royales (9 sept. 1934).
Le jeune Ionesco réunit dans la première partie de cette profession de foi non conformiste des articles publiés précédemment sur trois piliers de la littérature roumaine de l’époque : les poètes Tudor Arghezi et Ion Barbu, et le prosateur Camil Petrescu. Il qualifie de facile et d’inauthentique la poésie d’Arghezi, se moque des critiques qui en ont fait l’éloge et donne une longue liste de poètes roumains et français dont Arghezi se serait inspiré. Quant au roman Le Lit de Procust de Camil Petrescu, il est pulvérisé : « L’influence de Proust est si écrasante que l’originalité du livre est faite presque exclusivement de défauts ; elle réside dans l’application erronée ou ratée de la méthode proustienne » (p. 18).
La deuxième partie de Nu regroupe douze petits essais sous le titre « Faux itinéraire critique ». « L’Identité des contraires » expose la thèse de l’ambiguïté de la critique littéraire et pour l’illustrer l’auteur rédige deux comptes rendus du roman Maitreyi (La Nuit bengali) de Mircea Eliade, le premier favorable et le second destructeur. Dans « La critique, les critiques et autres choses imprévisibles », les critiques roumains sont passés au crible sans indulgence, l’auteur exposant par la suite l’interaction entre l’esprit national et les influences culturelles étrangères. « Le Trèfle à quatre feuilles » est un conte scientifique absurde dans lequel quatre savants de nationalités différentes s’efforcent d’imposer leurs hypothèses sur le nombre de trèfles à quatre feuilles dans le monde. La parlerie sur rien, si courante dans ses pièces à venir, serait-elle typiquement roumaine ?
« Tu deviendras un grand écrivain » est une somme de conseils à l’intention du débutant qui veut faire carrière en littérature : suivre les modes littéraires, flatter, se ménager les sympathies des écrivains connus. « Idées qui se contredisent » comprend trois dissertations paradoxales : « Le Génie », « La Tristesse de la joie et vice-versa » et « Une fausse causalité ». Dans ce dernier texte, l’auteur proclame le journal intime supérieur au roman et aux autres genres littéraires parce que plus complet et plus vrai. Le chapitre « Mesdames et Messieurs » pose le problème de la sincérité, puis l’auteur sanglote, terrorisé (il n’a que 25 ans) par l’idée de la mort inévitable.
En 1930, Ionesco avait écouté les conférences de Marinetti à Bucarest. Tristan Tzara et les surréalistes ne lui étaient pas inconnus, son esprit de contradiction, sa fronde et son panache instinctifs se dévoilent déjà dans cette écriture de harcèlement où l’auteur soutient tour à tour la thèse et l’antithèse, ridiculise les maîtres à penser de son temps. Il fait scandale et le but est atteint. Il accepte avec allégresse l’étiquette d’anarchiste.
Sur l’impact du nouveau venu, ce jugement de P. Constantinescu dans Vremea (Le Temps, VII, n° 369) est des plus révélateurs : « L’événement de l’année (1934) fut le livre de M. Eugen Ionescu, Non, qui a donné lieu, par sa négation catégorique et par son ferment de doutes, à des discussions acharnées, à des attaques véhémentes, à des éloges excessifs. On ne peut pas contester que M. Eugen Ionescu a réussi à atteindre, ne serait-ce qu’une partie de ses désirs intimes : avoir du succès et être incommode à ses confrères. Un "cas" demeure néanmoins un "cas", quelque intéressant qu’il soit ; mais nous attendons aussi le miracle » (« L’Année littéraire 1934 », Bucarest, janv. 1935).
D’autres critiques nuancent le propos et clament la nécessité de cet « antidote à notre monde ». Ionesco aura retenu le mot. Dans son article « Pourquoi j’ai voté pour Nu » (27 mai 1934), du même journal Le Temps, Petru Comarnescu, professeur et critique d’art réputé, trouve ce livre « un des plus tristes et des plus vrais jamais écrits chez nous ». Et de continuer ainsi : « Un jeune homme rongé par le doute, hébété, absurde, contradictoire, se dévoile dans toute sa nudité, avec une impertinence d’enfant terrible qui joue au plus malin. Il est mesquin, farfelu, mégalomane, mais il est supérieur à ses semblables par sa sincérité […] Il fait une critique de la critique qui avoue la stérilité du jeu de l’intelligence et de la gravité infatuée. Ce volume est nécessaire comme antidote à notre monde. Pour un oui constructif on a besoin de ce non ».
Les avant-gardes ont-elles voulu autre chose ?
L’ami d’Ionesco Octav Şulutiu donne une explication de nature psychologique : « E. Ionescu est un timide et un asocial. Son agressivité et son négativisme sont une compensation pour cet homme mal armé pour le combat de la vie. Sa psychologie essentielle – l’esprit de contradiction (très roumain aussi). En plus, brillante intelligence, logique impeccable, un humour acide, parfois vulgaire, et enfin un esprit enfantin. Pour lui, le langage est une convention ridicule (« Je dis A et je m’étonne »). Il n’a pas édifié en théorie son amertume comme Cioran (Émile Cioran avait, la même année, reçu un prix pour Sur les cimes du désespoir). Nu est un point de départ, le document psychologique d’une génération et d’un auteur » (Reporter, Bucarest, 13 juin 1934).
Mircea Vulcănescu, tout en traitant Ionesco de « velléitaire dogmatique », le rapproche de Thibaudet (« une critique de combat ») et des dialogues socratiques de Platon (Hippias Mineur ou Sur le Mensonge) pour son ironie sophistique : « C’est une maïeutique de l’acte vraiment critique […] Il est malade de lucidité. Devenu pur il s’est retrouvé vidé de tout sens et de toute réalité. Il lance à ce vide "NON" » (Familia, Bucarest, sept.-oct. 1934).
Avant de lui donner le conseil visionnaire de s’orienter vers le théâtre, Şerban Cioculescu l’avait traité de « Gavroche des coulisses littéraires » et l’avait accusé de vouloir « parvenir par le scandale » (Revue des Fondations Royales, Bucarest, 9 sept. 1934).
La sévérité doublée de compréhension avec laquelle la critique roumaine a accueilli ce volume a pu être bénéfique, pensons-nous, pour la carrière littéraire de ce franco-roumain qui habitait mal le nom (et le prénom) de son père, comme son pays, ce « Gorgias de Bucarest » qui jouait au malin pour cacher ses blessures : « Ce qui a été dit alors, j’ai continué à le dire et l’écrire tout au cours de ma vie et je le dirai encore aujourd’hui. Il faut oser ne pas penser comme les autres, oser vivre l’expérience limite qui permet de tout remettre en question », dira l’académicien Ionesco à Paris, en 1986, dans l’« Avant- propos » à la version française de ce volume de jeunesse qui avait suscité un tel débat à Bucarest.
Dans la « Postface » de ce volume, Ileana Gregori pouvait constater après-coup : « Essais critiques entrecoupés de passages où l’on reconnaît les grands thèmes d’Ionesco – dans une sorte de journal, des réflexions sur la vanité de la critique, et même son impossibilité. Et aussi l’impossibilité et l’absurdité de l’art. Il retrace de façon caricaturale la carrière d’un écrivain en Roumanie. Il avance des paradoxes sur le roman et sur le génie littéraire. Dès qu’on s’exprime, on cesse d’être soi-même. Dans la Roumanie d’alors, le jeune Ionesco était ce qu’on appelait "négativiste." Le lecteur français y reconnaîtra ce regard clownesque et angoissé à la fois devant l’évidence de l’absurde, qui est au cœur même de son théâtre» (Postface à Non, Gallimard, 1986).
Dans le volume Notes et contre-notes (Gallimard, 1962) qui réunit essais, conférences, notes et articles, l’auteur déjà célèbre pose explicitement la question de l’avant-garde : « Il y a eu vers 1920 un vaste mouvement d’avant-garde universel dans tous les domaines de l’esprit et de l’activité humaine. Un bouleversement dans nos habitudes mentales, une nouvelle vision du monde. La littérature et le théâtre – d’André Breton à Maïakovski, de Marinetti à Tristan Tzara ou Apollinaire, du théâtre expressionniste au surréalisme, jusqu’aux noms de Faulkner, Dos Passos, Nathalie Sarraute, Michel Butor – ont participé de ce renouveau. Mais toute la littérature n’a pas suivi le mouvement et le théâtre semble s’être arrêté à 1930. L’avant-garde a été stoppée au théâtre, sinon dans la littérature. Les guerres, les révolutions, le nazisme et les autres formes de tyrannies, le dogmatisme, la sclérose bourgeoise aussi dans d’autres pays, l’ont empêché de se développer pour le moment. Cela doit reprendre. Pour ma part, j’espère être un des modestes artisans qui tentent de reprendre ce mouvement ».
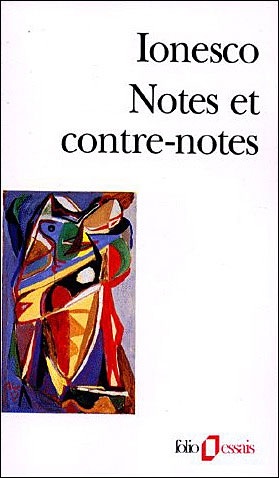 L’auteur revendique pour le théâtre, comme pour le cinéma et les sciences, des lieux d’expérimentation, des salles laboratoires. Son article « Toujours sur l’avant-garde », publié dans Arts en janvier 1958 (repris dans Notes et contre-notes), est un plaidoyer pour ce théâtre nouveau, menacé par l’apathie, la politique, la jalousie, la méchanceté. « L’avant-garde c’est la liberté », lance-t-il l’année suivante dans le discours inaugural aux Entretiens d’Helsinki sur le théâtre d’Avant-Garde. « Je préfère définir l’avant-garde en termes d’oppositions et de rupture. On ne peut s’apercevoir qu’il y a eu avant-garde que lorsque l’avant-garde n’existe plus en tant que telle, lorsqu’elle est devenue arrière-garde…Tandis que la plupart des écrivains, artistes, penseurs s’imaginent être de leur temps, l’auteur rebelle a conscience d’être contre son temps. Le théâtre d’avant-garde ou théâtre nouveau se dresse contre les conformismes et la paresse mentale […] Une création artistique est, par sa nouveauté même, agressive, spontanément agressive. Elle indigne le public par son insolite qui est lui-même une indignation […] On peut tout oser au théâtre et c’est le lieu où l’on a osé le moins. Je ne veux avoir d’autres limites que celles des possibilités techniques de la machinerie » (« Discours sur l’avant-garde », in Notes et contre-notes, p. 26, 31-32).
L’auteur revendique pour le théâtre, comme pour le cinéma et les sciences, des lieux d’expérimentation, des salles laboratoires. Son article « Toujours sur l’avant-garde », publié dans Arts en janvier 1958 (repris dans Notes et contre-notes), est un plaidoyer pour ce théâtre nouveau, menacé par l’apathie, la politique, la jalousie, la méchanceté. « L’avant-garde c’est la liberté », lance-t-il l’année suivante dans le discours inaugural aux Entretiens d’Helsinki sur le théâtre d’Avant-Garde. « Je préfère définir l’avant-garde en termes d’oppositions et de rupture. On ne peut s’apercevoir qu’il y a eu avant-garde que lorsque l’avant-garde n’existe plus en tant que telle, lorsqu’elle est devenue arrière-garde…Tandis que la plupart des écrivains, artistes, penseurs s’imaginent être de leur temps, l’auteur rebelle a conscience d’être contre son temps. Le théâtre d’avant-garde ou théâtre nouveau se dresse contre les conformismes et la paresse mentale […] Une création artistique est, par sa nouveauté même, agressive, spontanément agressive. Elle indigne le public par son insolite qui est lui-même une indignation […] On peut tout oser au théâtre et c’est le lieu où l’on a osé le moins. Je ne veux avoir d’autres limites que celles des possibilités techniques de la machinerie » (« Discours sur l’avant-garde », in Notes et contre-notes, p. 26, 31-32).
L’auteur connaît donc et utilise dans son théâtre toutes les attitudes et trouvailles de l’avant-garde depuis Jarry. Le critique italien Vito Pandolfi affirme, non sans raison, que Ionesco « a recueilli le meilleur de l’expérience avant-gardiste française », et roumaine voudrions-nous ajouter. Né en Roumanie, vivant à Bucarest de 13 à 30 ans, Ionesco s’y est formé (Lycée Saint-Sava et Faculté de Lettres et Philosophie de l’université de Bucarest). C’est là qu’il a été professeur de français, journaliste, critique littéraire et auteur au début de sa carrière.
La Grande Roumanie – ainsi appelée après l’Union du 1er décembre 1918 – connaissait une activité culturelle intense, effervescente. Les cénacles et les revues littéraires se multipliaient et toutes les tendances se faisaient jour : la tradition populiste paysanne avec La Vie Roumaine (Viaţa Românească) qui réunissait de grands écrivains, Garabet Ibrăileanu, Mihaïl Sadoveanu, Ionel Teodoreanu, Alexandru Philippide (excellent traducteur de Baudelaire), George Călinescu (célèbre pour son Histoire de la littérature roumaine, 1941, une approche esthétique où le jeune Eugen Ionescu a droit à un jugement favorable) ; la revue La Pensée (Gândirea) d’orientation orthodoxe ; Semănătorul (Le Semeur) du grand historien Nicolae Iorga où collaborent le poète et philosophe Lucian Blaga, les poètes Tudor Arghezi, Ion Pillat, Vasile Voiculescu, puis Mateiu Caragiale auteur des Seigneurs de l’ancienne cour, un décadentiste qui rappelle V. de l’Isle Adam (Mateiu était le fils de Ion Luca Caragiale – créateur du théâtre roumain – dont les pièces resteront pour Ionesco des hypotextes avoués).
 Parmi les revues plus modernistes, La Pensée roumaine (Cugetul românesc, 1922-1924) publie les textes bizarres d’Urmuz (traduit par Ionesco en français), à l’humour absurde et aux paraboles intelligentes ; Contemporanul (Le Contemporain), qui, fondée par Ion Vinea et Jean Jacques Costine, focalise les énergies de l’avant-garde, est une revue au programme constructiviste à laquelle collaboraient des noms bien connus plus tard en France : Bebe Fundoianu (le poète Benjamin Fondane), le peintre Victor Brauner, le sculpteur Constantin Brâncuşi. Cette publication exclusivement consacrée à la littérature et à l’art modernes est rédigée en roumain et en français, mais d’autres langues y ont droit de cité. Dans la revue Integral (1925-1927) dirigée par Ilarie Voronca, écrivait Tristan Tzara. Le même Voronca, avec Sacha Pană et B. Fondane, a fait paraître Unu (Un) entre 1928 et 1932, une revue très favorable au modernisme futuriste. Un autre grand poète roumain, devenu français plus tard, Gherasim Luca, collaborait vers 1930 à la revue Les Algues (Alge). La Vie Littéraire (Viaţa Literară, 1926-1938), d’orientation plus éclectique, réunit la plupart des écrivains et critiques, alors que la revue en format de poche Bulletins du perroquet de Tudor Arghezi a accueilli les débuts poétiques d’Eugen Ionescu.
Parmi les revues plus modernistes, La Pensée roumaine (Cugetul românesc, 1922-1924) publie les textes bizarres d’Urmuz (traduit par Ionesco en français), à l’humour absurde et aux paraboles intelligentes ; Contemporanul (Le Contemporain), qui, fondée par Ion Vinea et Jean Jacques Costine, focalise les énergies de l’avant-garde, est une revue au programme constructiviste à laquelle collaboraient des noms bien connus plus tard en France : Bebe Fundoianu (le poète Benjamin Fondane), le peintre Victor Brauner, le sculpteur Constantin Brâncuşi. Cette publication exclusivement consacrée à la littérature et à l’art modernes est rédigée en roumain et en français, mais d’autres langues y ont droit de cité. Dans la revue Integral (1925-1927) dirigée par Ilarie Voronca, écrivait Tristan Tzara. Le même Voronca, avec Sacha Pană et B. Fondane, a fait paraître Unu (Un) entre 1928 et 1932, une revue très favorable au modernisme futuriste. Un autre grand poète roumain, devenu français plus tard, Gherasim Luca, collaborait vers 1930 à la revue Les Algues (Alge). La Vie Littéraire (Viaţa Literară, 1926-1938), d’orientation plus éclectique, réunit la plupart des écrivains et critiques, alors que la revue en format de poche Bulletins du perroquet de Tudor Arghezi a accueilli les débuts poétiques d’Eugen Ionescu.
Le groupe « Criterion » – formé par les élèves du professeur de métaphysique Nae Ionescu (aucun lien de parenté) et réunissant Mircea Eliade, Emile Cioran, Mircea Vulcănescu, Constantin Noïca – promeut « le fait concret », « l’expérience directe » et adopte une vision tragique de l’univers. On a nommé « expériencisme » cette variante roumaine de l’existentialisme. Ionesco a d’abord publié dans ses revues : La Parole (Cuvântul), Le Courant (Curentul), Axa, Criterion, avant de rejoindre le groupe. L’école de poésie hermétisante de Ion Barbu, influencée par la spiritualité hellène, fait publier le recueil Vues (Privelişti) de B. Fondane, illustré par un portrait de Brâncuşi. En 1935, Ionesco publie dans la revue L’Idée roumaine (Ideea românească) la biographie sarcastique de Victor Hugo en qui il voit « un immense farceur » (Hugoliade, pour la version française, Gallimard, 1980).
 L’exil linguistique de Panaït Istrati, Tristan Tzara, Mircea Eliade, Emile Cioran, Benjamin Fondane, Gherasim Luca, Ionesco lui-même, de Vintilă Horia (Goncourt 1960), Dumitru Tsepeneag, de Georges Astalos et Matei Vişniec aujourd’hui a apporté au patrimoine français du XX° siècle un pilier soutenant tout un pan de la modernité.
L’exil linguistique de Panaït Istrati, Tristan Tzara, Mircea Eliade, Emile Cioran, Benjamin Fondane, Gherasim Luca, Ionesco lui-même, de Vintilă Horia (Goncourt 1960), Dumitru Tsepeneag, de Georges Astalos et Matei Vişniec aujourd’hui a apporté au patrimoine français du XX° siècle un pilier soutenant tout un pan de la modernité.
Pourquoi tant de Roumains dans les avant-gardes ? Je n’ai pas de vraie réponse, juste quelques modestes suppositions. Les Roumains ont été mal placés dans l’espace et dans l’histoire. Trois grands empires, ottoman, austro-hongrois, russe, ont convoité, entre autres, cet espace carpato-danubiano-pontique et, face aux invasions successives, le peuple a dû se retirer dans les montagnes, dans les forêts, se retirer de l’Histoire pendant des années ou des décennies. Les rebondissements, après ces phases anhistoriques, allaient être fracassants, tumultueux, créateurs. On vivait dans l’immédiat et on ornait ses vêtements, sa maison, ses petites églises. On composait des chants. La Roumanie a donc progressé par à coups, la stagnation alternant avec l’accélération forcée.
La modernisation accélérée au début du XX° siècle, le jeu des alliances pendant et entre les deux guerres (le pétrole roumain presque tari aujourd’hui polarisant les envies et alimentant non seulement le progrès mais les engins de guerre), ont accentué les clivages, aiguisant peut-être l’esprit de contradiction inné qui va devenir à la mode en Europe. La machine démocratique qu’on a voulu mettre en place, le développement d’une classe moyenne furent sabotés, détraqués avant même d’avoir pu fonctionner. Il y eut d’autre part les activismes, des Mères Pipe évangélisant les foules, des nihilismes lorsque les jeux étaient vraiment faits ; un certain esprit balkanique tenté par l’aventure, la grivoiserie, l’humour absurde. Nous sommes aux portes de l’Orient, même si notre visage est tourné vers l’Occident.
N’oublions pas que les plus révoltés s’exilèrent (d’abord en France) et que « l’émigrant atteste son existence par la révolte » (B. Fondane). Toute la poétique de cet évadé de Drancy mort à Auschwitz est l’humiliation des hommes en exil. « J’emporte comme vous, ma vie dans une valise », disait St-J. Perse. Ionesco, lui, écrit L’Homme aux valises. L’émigrant vit dans un entre-deux et son ethos discursif devient une expression qui corrompt les définitions identitaires stables. Capter l’énergie libérée par les chocs culturels et développer à partir d’elle un espace de coexistence, voilà l’enjeu pour les écrivains venus d’ailleurs.
Les Roumains font-ils plus que d’autres partie de la constellation dionysiaque à l’œuvre dans les programmes des avant-gardes historiques ? Leur participation panthéiste à toute joie et à toute peine est-elle plus accentuée ? La ballade Miorita (L’Agnelle voyante), qui est un peu notre Iliade, l’atteste, et le poète et philosophe Lucian Blaga parle même d’un « espace mioritique » de la culture roumaine : « La mort, par le fait d’être assimilée à une noce, cesse d’être un acte biologique, un épilogue ; elle est transfigurée, acquérant l’aspect élevé d’un acte sacramentel, d’un prologue. Elle est noce et la nature toute entière devient église » (Trilogie de la culture, Bucarest, 1979, p. 176). Cette participation panthéiste serait-elle plus sensuelle et plus cruelle que chez d’autres peuples ? Je n’en sais rien. Occultant en quelque sorte toute paternité, Ionesco ne s’explique pas, il se dévoile dans ses œuvres ; « Tel que j’étais / Moi je m’aimais » (Élégies pour êtres minuscules, Bucarest, 1931).
Se mettre en situation d’étrangeté devant la parole humaine, c’est la découverte d’Ionesco voulant apprendre l’anglais avec la méthode Assimil. Avec Engezeşte fără profesor (1943), traduit sous le titre L’Anglais sans peine et devenu La Cantatrice chauve en 1950, le langage est promu au rang d’objet théâtral, pouvant devenir, à partir des clichés de la conversation, une mécanique qui se détraque et explose, permettant par ailleurs la manipulation de la logique, mais aussi la découverte du monde avec des yeux tout neufs, dans un état d’étonnement profond. Les Smith et les Martin, coquilles vides d’êtres, on l’a dit, traversés par la multiplicité morte d’un texte qui vous aveugle, se battent à coups de mots, car ils ne parviennent à s’accorder ni sur le langage, ni sur le sens que l’on peut attribuer aux événements de la réalité. Quoi de plus concret aussi pour ruiner l’idée de famille prônée par les surréalistes : « Voilà ce que nous aurions voulu faire au théâtre. Dépayser le spectateur, troubler et violenter ses habitudes », s’exclamait André Breton à la sortie du spectacle au théâtre des Noctambules. « Surréalisme pas mort. Stop. Ionesco suit ».
En désarticulant le réel avec tant de précision dans l’inexactitude, tant de naturel dans le saugrenu, Ionesco se rapproche des peintres de « l’entre-mondes ».
En parlant d’Urmuz en 1965 dans Les Lettres Nouvelles, parmi d’autres "précurseurs roumains du surréalisme", Ionesco se dévoilait lui-même : « Au-delà de l’humour noir et de la critique des automatismes du langage il y a un fond tragique, un monde suffoqué par les conventions où les mots ne sont plus unis par des rapports de nécessité et de vérité. Le réel se prolonge dans le fantastique ».
Dans La Leçon, la découverte du sens ne peut qu’entraîner la mort du Sujet au profit du Verbe, ou bien la confusion, le Babel. Le langage est plus un masque qu’un moyen de communication. S’il était assassiné dans La Cantatrice chauve, dans La Leçon il tue : « Monsieur, surtout pas de philologie ; la philologie mène au pire ». Le sketch radiophonique Le Salon de l’automobile vu comme une foire d’animaux propose la confusion des caractères des différents règnes naturels. Une des fables urmuziennes, Fabula, mêlait dans un beau chaos conceptuel Aristote et Galilée et tout à la fois suivait un développement rhétorique rigoureux finissant par la morale « bonnet blanc et blanc bonnet ».
Comme Caragiale et comme Urmuz, Ionesco s’est proposé de percer le mur d’habitudes mentales et de routines qui nous empêche de percevoir l’univers autrement que dans les apparences : « L’expression m’uniformise, disait-il dans Notes et contre-notes ; elle est déjà la somme des mensonges anciens, organisés, fossilisés ». Il préfère l’exagération, quelquefois même l’exagération poussée jusqu’à l’insignifiance, et dans La Leçon elle a la fonction de dédramatiser le sujet.
Si nous revenons au jugement de Vito Pandolfi, « Ionesco a recueilli le meilleur de l’expérience avant-gardiste française », le critique italien continue : « Il l’a traduite dans une forme théâtrale cohérente. Son grand mérite est la maturation scéniquement fonctionnelle des affirmations passées ».
Le Maître tant acclamé qui apparaît, à la stupéfaction de ses adulateurs, tout simplement sans tête, nous fait penser à L’Acéphale de Georges Bataille, à l’Anti-tête de Tzara, à la phrase de Caragiale : « Tête tu as, la raison tu n’en as plus besoin », très courante pour se moquer de quelqu’un chez les Roumains. Mais maître Ionesco a visualisé comme nul autre ces idées et son langage scénique fait partie intégrante du texte, nous donnant la sensation physique de l’absurde. Par les techniques contrapunctiques qui opposent paroles et gestes, la polysémie poussée à l’extrême, par le jeu des enchaînements phonétiques, l’auteur essaie d’arriver, comme André Breton l’a voulu, à un dialogue de fous : « Ils étaient gracieux, les jeunes comédiens de la troupe Nicolas Bataille dans La Cantatrice chauve : du vide endimanché, du vide charmant, du vide fleuri, du vide à semblants de figures, du vide jeune, du vide contemporain. Ils étaient, malgré tout, eux-mêmes, charmants au-delà de rien » (Notes et contre-notes, 161).
 Le théâtre de la Huchette, avec les mêmes spectacles, La Cantatrice chauve et La Leçon tous les soirs depuis 1957, est son monument vivant – en raison d’une longévité unique dans l’histoire du théâtre. Ionesco ici « c’est l’avant-garde de cire », dit Giovanni Lista. Figé et neuf à chaque fois, comme aux premiers spectacles des Noctambules en 1950. Et ça marche : « à la source de La Cantatrice chauve sa lecture de L. Carroll et des surréalistes, de Caragiale et de Urmuz, les cabarets littéraires alignés à l’héritage de l’avant-garde, son déracinement linguistique, son expérience de professeur de français en Roumanie » (Ionesco, Paris, Henry Veyrier, 1989, p. 121 et 186).
Le théâtre de la Huchette, avec les mêmes spectacles, La Cantatrice chauve et La Leçon tous les soirs depuis 1957, est son monument vivant – en raison d’une longévité unique dans l’histoire du théâtre. Ionesco ici « c’est l’avant-garde de cire », dit Giovanni Lista. Figé et neuf à chaque fois, comme aux premiers spectacles des Noctambules en 1950. Et ça marche : « à la source de La Cantatrice chauve sa lecture de L. Carroll et des surréalistes, de Caragiale et de Urmuz, les cabarets littéraires alignés à l’héritage de l’avant-garde, son déracinement linguistique, son expérience de professeur de français en Roumanie » (Ionesco, Paris, Henry Veyrier, 1989, p. 121 et 186).
On sait que La Cantatrice chauve est une traduction adaptée de sa pièce en roumain Englezeşte fără profesor (L’Anglais sans peine). Cette parodie de traduction appelée « anti-pièce » accentue la trahison en présentant au public un langage hybride et artificiel, à la frontière de deux langues. Ce palimpseste lui donne par ailleurs l’occasion de méditer sur l’état du langage après Babel. Parmi les procédés rendant difficile le décodage par un non roumanophone, se trouve l’insertion, souvent très discrète, de locutions et proverbes roumains mutilés ou d’expressions idiomatiques modifiées. « Nu te uita la curci » (« Arrête de regarder les dindons ») qui signifie « ne perds pas ton temps », devient dans La Cantatrice chauve « Ne soyons pas dindons ». De nombreux truismes, purs collages dadaïstes, sont introduits pour choquer par leur banalité. Le sentiment d’insécurité naît de ce dialogue en zigzag sur rien qui évoque, hyperboliquement, toute conversation courante. Les cadavres de mots, les syllabes, les homophonies et les cacophonies remplacent l’agression physique plus marquée dans la pièce roumaine. Plus concise, plus dense et plus violente, la version roumaine était elle aussi une parodie d’un théâtre de boulevard périmé, son objet dramatique étant la leçon d’anglais.
Dire « non » à la littérature est avant tout une réflexion sur la littérature, comme la sculpture de Brâncusi est, jugée par Ionesco, « une réflexion sur la sculpture ». Jean Anouilh voit dans l’Orateur des Chaises « un coup d’avant-garde un peu vieillotte ». Peut-être, mais pourra-t-on jamais oublier « Sémiramis, ma crotte » ? « Votre tremblante et dérisoire Sémiramis (interprétée par Tsilla Chelton) est entrée dans la mémoire du cœur », disait Jean Delay dans la réponse à son Discours de réception à l’Académie Française et il continuait : « La mise en scène de l’histoire – réduite à l’état d’illusion par les jeux de l’humour et du rêve, peut devenir une façon de vivre » (Gallimard, 1971).
Le rêve, constamment présent dans son théâtre (Le Piéton de l’air, Victimes du devoir, La Soif et la Faim, Amédée ou comment s’en débarrasser), dans ses journaux et ses entretiens (Entre la vie et le rêve), est-il simplement un écho des expériences surréalistes et dadaïstes ? « La vida es sueno », nous apprenait déjà Calderon de la Barca. Pour Ionesco le rêve est le drame lui-même, car dans le rêve on est toujours en situation : « C’est la pensée directement formulée en images […] Les rêves sont l’expression de la pensée intuitive elle-même » (Entre la vie et le rêve, Gallimard, 1977, 22-23). Dans Notes et contre-notes, le rêveur éveillé s’y réveille lucide et d’une vigueur polémique qui lui a fait des ennemis, à Paris, à Londres aussi, trente ans après le scandale de Nu à Bucarest. Entre temps « le miracle » attendu s’est produit. Comment a-t-il fait ? On pourrait le citer : « Je me suis dit que les auteurs de théâtre trop intelligents ne l’étaient pas assez. Il fallait non pas cacher les ficelles, mais les rendre plus visibles, aller à fond dans le grotesque, la caricature, au-delà de la pâle ironie des spirituelles comédies de salon. La farce, la charge parodique extrême. Pousser tout au paroxysme, là où sont les sources du tragique. Faire un théâtre de violence – violemment comique, violemment tragique ». Et, un peu plus loin : « Votre cri fait une trouée dans les habitudes mentales collectives. Après, les vérités deviennent des conformismes pétrifiés. L’étrange devient normal. L’auteur est assimilé, intégré. Et puis cela devient si naturel que cela semble banal » (Préface à Notes et contre-notes, p. XIII et XX).
Si ce « théâtre de la dérision » tentant le déchirement continuel du voile de l’apparence est en nous aujourd’hui, s’il a réussi mieux que celui d’Apollinaire, Vitrac, Tzara à l’époque, c’est que les formules que Ionesco, Beckett, Adamov ont trouvées pour rendre le théâtre visuel, primitif, enfantin, se sont révélées plus parlantes, en accord aussi avec un horizon d’attente. Pour Ionesco, « ce qu’on appelle avant-garde n’est intéressant que si c’est un retour aux sources, si cela rejoint une tradition vivante, à travers un traditionalisme sclérosé, à travers des académismes réfutés […] Les œuvres d’art les plus jeunes, dit-il, les plus neuves se reconnaissent et parlent à toutes les époques ».
L’iconoclaste en habit vert entendait dire à cette fameuse et bizarre réception sous la Coupole de l’Institut : «Vous avez su rejoindre à travers des mythes simples quelque chose d’essentiel » (Jean Delay). NON, aurait-il pu penser, ne fut-ce que pour contrarier le da-da (« da » = « oui » en roumain et dans les langues slaves). Au roulement des tambours il aurait préféré « la clarinette d’un clown mélancolique ami du rire, du rêve et des étoiles » (Jean Delay).
Bibliographie complémentaire :
CLEYNEN-SERGHIEV, Ecaterina, La Jeunesse littéraire d’E. Ionesco, Paris, PUF, 1995.
COSTINE, Jacques, « Urmuz, le fabulateur des années folles », in Les Lettres nouvelles, sept.-oct. 1969.
PLAZY, Gilles, Eugène Ionesco, Paris, Julliard, 1994.
PERIŞANU, Mariana, « Peurs et antidotes dans les écrits d’Ionesco », in Travaux de littérature, XVII, Droz, Genève, 2004.
LEONARD-ROQUES, Véronique & VALTAT, Jean-Charles, Les Mythes des avant-gardes, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2003.
![[Manières de critiquer] Ionesco : du <em>Non</em> de Bucarest à l'](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)