C’est libr-critiquement qu’en cette "Rentrée littéraire" nous avons choisi d’ouvrir un dossier intitulé "Autour de 68", histoire de montrer notre décalage par rapport à l’actualité immédiate – et aussi qu’il ne saurait y avoir de Rentrée que critique. On ignorera donc bon nombre de productions diverses, des dossiers de magazine aux films documentaires, en passant par les nombreux ouvrages de circonstance, pour traiter le sujet par les marges.
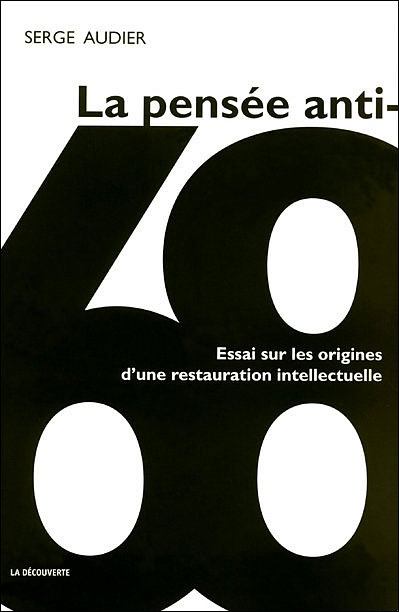
En fait, puisque seule importe aujourd’hui la nécessité de mieux saisir en quoi mai 68 demeure un enjeu stratégique, il convient de situer le spectre doxologique dans le champ du pouvoir. Plutôt que de prendre pour objet "la pensée anti-68", on préférera dès lors poser ce type d’interrogation : "Comment le rejet de mai 68 sert-il une contre-révolution multiforme ?" Ou, plus précisément : "Dans quelle mesure les diverses contestations de mai 68 ressortissent-elles à une révolution conservatrice au service d’un totalitarisme néo-libéral auquel les sphères publicitaire, politique et culturelle confèrent un visage humaniste ?"
Notons tout d’abord que, depuis la fin du siècle dernier, le discours publicitaire véhicule de mai 68 des représentations diversement péjoratives et réductrices : "Mai 68 est une époque d’enfantillages que l’on a dépassée pour un monde sérieux d’affaires et de responsabilités", telle est la leçon qui ressort plus ou moins explicitement de la plupart des campagnes faisant référence ou allusion à cet événement majeur de l’histoire contemporaine. Analysant quelques panneaux publicitaires, dans La Société de consommation de soi (Verticales, 1999 ; cf. p. 85-103), Dominique Quessada montre qu’en s’attaquant à cet emblème du politique il s’agit pour l’idéologie dominante d’imposer le dépassement de l’ordre politique par l’ordre économique, seul apte à "changer la vie" pour l’ensemble de la collectivité.

Or, c’est bel et bien le même Nicolas Sarkozy qui, depuis la campagne aux élections présidentielles de 2007, a choisi d’atténuer son radicalisme en se réappropriant en partie ce néo-libéralhumanisme. C’est ainsi qu’il explicite la rupture nécessaire avec 68 : lorsque, emboîtant le pas à un Jean-Marie Le Pen qui associe laxisme et relativisme de 68 (discours du 20/02/2007), il lance à Metz le 17 avril 2007 la fameuse phrase sloganisée "Je veux en finir avec l’héritage de Mai 68", il se positionne clairement contre les valeurs symbolisées par cette révolte éthique (anti-autoritarisme, liberté de parole, esprit critique, dynamisme social, etc.), et donc pour le retour à certaines valeurs morales – qui, nettement à droite, certes, quand il s’agit de l’autorité, de la sécurité ou de la fierté nationale, se rattachent globalement à un certain humanisme. Et c’est là toute l’habileté du tacticien qui vise à rien moins qu’à recouvrir d’un voile néo-libéralhumaniste l’in-différence axiologique propre au nouvel ordre économique : afin de mieux ruiner les droits républicains et les acquis sociaux, celui qui doit essentiellement sa conquête du pouvoir à son charisme populiste se proclame le champion de la vraie égalité de tous les citoyens, de la liberté du travail, et plus généralement des libertés individuelles (contre la "racaille" et les "profiteurs" tous azimuts, le droit de grève, la durée légale du travail fixée à 35 heures, le droit d’asile…). À l’évidence, sa stratégie est adaptée à la démocrasimulacre : vu que, dans le monde spectaculaire, les discours se substituent aux actes comme les images à la réalité sociale, il importe d’éliminer l’adversaire par une captation idéologique sans précédent (d’où la convocation de figures aussi symboliques que celles de Jaurès et de Blum) et de réussir une inédite saturation doxologique (quelles que soient les topiques, l’homme providentiel se doit de mobiliser le maximum de lieux communs et d’effets rhétoriques pour convaincre et persuader les citoyens-spectateurs qu’il est le seul à pouvoir leur apporter le salut).
Cependant, objectera-t-on, n’y a-t-il pas matière à se réjouir d’un sursaut manifeste du peuple français ? Rien de moins sûr : la chute de popularité de l’actuel chef de l’état avant même la première année de son mandat n’est pas tant due à une quelconque réflexion politique ou à un retour effectif à la réalité sociale qu’à une contradiction flagrante entre le thème majeur de la campagne, le pouvoir d’achat, et un autre topos assez rapidement devenu très médiatique, la hausse réelle des prix qui a pour corollaire la chute effective du pouvoir d’achat. Le fait est que l’audace de cet expert en communication politique consiste justement à prendre le risque d’être confondu un jour ou l’autre, la rhétorique contre-révolutionnaire n’étant efficace que dans l’espace virtuel : dans l’espace social réel, quelle gageure que de prétendre améliorer le sort des salariés en les aliénant au pouvoir économique ; assurer l’égalité sur le territoire national en exacerbant l’individualisme, l’instabilité et la compétition sociale, le différencialisme, voire la ségrégation ; défendre la qualité des services publics par des suppressions d’effectifs et de moyens financiers qui ont pour conséquence inéluctable la dégradation des conditions de travail ; privilégier l’accueil d’immigrés qui ne seront en situation régulière que pour avoir été cyniquement choisis ! Même si l’on admettait l’hypothèse que, dans la république (res publica), le bon sens étant res communis, la majorité soit consciente de ces paradoxes, n’est-elle pas déjà résignée à une domination économique présentée comme une fatalité par les puissances dominantes ?
Dans l’espace social réel, la posture de celui qui n’est pas à un paradoxe près est intenable parce que poussant jusqu’à son ultime extrémité la contradiction inhérente au libéralisme français, creusant jusqu’à l’absurde l’antinomie entre révolution économique et conservatisme moral. D’une part, le brouillage idéologique va à l’encontre de toute revendication éthique et, partant, de tout humanisme, puisqu’il conforte l’anomie néo-libérale : l’équivalence politique rejoignant l’in-différence du Marché, le principe de l’échange généralisé prévaut désormais en politique comme en économie. D’autre part, le volontarisme du chef charismatique – lequel intervient pour sauvegarder les fleurons du capitalisme français ou pour fixer les fins de la télévision publique ou de l’enseignement, allant jusqu’à se prononcer sur ce qu’il faut enseigner ou non, décrétant par exemple que La Princesse de Clèves n’est plus étudiable en lycée – vient contredire l’anti-étatisme et l’absolue liberté économique affichés.
On comprend dès lors à quel point Nicolas Sarkozy ne peut que stigmatiser mai 68 : cette révolte éthique, comme le montre Jean-Luc Nancy dans Vérité de la démocratie (Galilée, 2008 ; voir la chronique à venir), rompt avec les paradigmes politiques et intellectuels dominants pour, non pas revendiquer un nouveau régime politique déterminé, mais en appeler à une nouvelle forme démocratique qui soit finalité sans fins – dans laquelle, l’infini venant ouvrir le fini, les individus attirés par cet ailleurs ont la possibilité d’inventer leurs propres fins.
Et quand on sait que le mentor du prince, Henri Guaino, est l’auteur de La Sottise des modernes (Plon, 2002), on comprend que la révolution conservatrice se soit traduite dans le champ intellectuel par la mise au pinacle des antimodernes (qu’on me permette ici de renvoyer à mes articles sur Antoine Compagnon et Richard Millet : cf. 06/07/2006 et 08/04/2008).
.jpg)
La même année, dans leur troisième tome de Philosophie politique, Des droits de l’homme à l’idée républicaine (PUF, 1985), ils avaient proposé de voir dans l’idée républicaine une conciliation légitimiste – une synthèse molle – d’une pensée libérale légaliste qui, privilégiant les droits-libertés, préconise une politique de l’entendement, et d’une pensée socialiste métaphysiciste qui, accordant la priorité aux droits-créances, opte pour une politique de la raison. La quête entreprise par Luc Ferry d’un humanisme non métaphysique le conduit à faire de positivité vertu : s’interroger sur le sens de la vie (cf. L’Homme-Dieu ou le sens de la vie, Grasset, 1996), c’est donner dans un humanisme spiritualiste qui "a ceci de commun avec le religieux qu’il reconnaît le mystère de l’homme, de sa conscience pour elle-même, son statut unique et hors nature, sa vocation morale, et fait de l’amour une expérience capable de donner un sens à la vie" – un humanisme spiritualiste qui a trouvé à s’épanouir dans un "univers laïque et individualiste, qui laisse à la liberté de l’homme toute sa place" (entretien dans Sciences Humaines, n° 25, sept. 1996). Lequel univers laïque est né à la fin du XVIIIe siècle, en même temps que l’idéologie des droits de l’homme et des valeurs individualistes : "L’humanitaire est inséparable de la naissance de la famille et de l’amour moderne, c’est-à-dire du mariage d’amour, qui introduit le sentiment entre les époux et entre les parents et les enfants. L’amour de ses proches peut servir de médiation pour accéder à l’universel". Son credo : l’homme est libre ; derechef, les sciences humaines sont coupables de réductionnisme… Et si d’aventure, au détour de phrases introductives (cf. Qu’est-ce qu’une vie réussie ?, Grasset, 2002), il déplore le triomphe de la raison instrumentale, de la logique de la concurrence au détriment de la logique du sens, ce n’est pas pour remettre en question le nouvel ordre économique, mais pour revenir sur la sagesse de l’Homme-Dieu. Dix ans plus tôt, c’était le nouvel ordre écologique qu’il dénonçait comme rétrograde (Grasset, 1992) : exalter la pureté de la nature, c’est oublier que l’homme, contrairement à l’animal, n’est pas déterminé par sa nature. S’ériger en chantre de l’Homme, c’est assurément se donner le bon rôle…
Ce moralisme néo-néokantiste est à mettre sur le même plan que les pensées néo-rationalistes. La pensée libérale, qu’elle soit d’ordre philosophique, sociologique ou économique (que l’on songe à l’individualisme méthodologique, aux théories rationnelles de l’action ou à l’économisme de Gary Becker, prix Nobel d’économie en 1992 et théoricien du "capital humain"), est par nature essentialiste et antigénétique. Se défiant de l’État – toujours suspecté de porter en soi le germe d’un collectivisme uniformisant et d’un dirigisme totalitarisant -, elle conçoit l’individu comme un être rationnel capable de se déterminer librement – ce qui est une façon de se démettre sur lui de toute responsabilité et, plus insidieusement encore, de le rappeler à l’ordre (un individu responsable est un être-de-devoir : l’ordre rationnel dissimule un ordre moral). Tout comme la liberté, la solidarité s’accompagne d’un garde-fou conservateur : le non-assistanat. On le voit, si, en théorie, ce libéralhumanisme qui prend pour appui une philosophie rationaliste et volontariste prône une liberté inconditionnée (tout individu est libre de ses choix et tous les individus sont libres en droit), dans les faits cette liberté doit souffrir de sérieuses restrictions normatives, psychologiques et socio-économiques : l’individu-citoyen doit indéfiniment prendre ses responsabilités et remplir ses devoirs ; l’individu-consommateur est à ce point un être autonome (rationnel et donc libre) que la société marchande s’adresse en permanence à l’homme pulsionnel, le stimulant sans cesse – avec succès ! – ; l’homo communis – c’est-à-dire l’exclu de toute méritocratie et de toute oligarchie – n’a pas l’opportunité de poser librement ses fins (non seulement il ne dispose pas des capitaux – économique, social et culturel – nécessaires à la réalisation de ses projets, mais en plus il est conditionné à "garder sa place").
Le moralisme, l’intellectualisme ou l’essentialisme sont des luxes – voire, des ruses – de dominant qui permettent d’en rester au "débat d’idées" et de faire l’économie d’une réflexion sur les rapports de force et sur l’individualisme contemporain : tandis que la pensée substantialiste se nourrit de grands principes (liberté, solidarité,…) sans se préoccuper des conditions de leur application et procède par réification, en posant par exemple que l’homme postmoderne est destructuré, la pensée génétique prend pour objet la structuration de l’espace social (la prédominance du champ économique sur tous les autres champs), le mode de fonctionnement du champ du pouvoir et les modalités d’exercice de la domination, les facteurs psychologiques, culturels, idéologiques et socio-économiques susceptibles d’expliquer certains invariants dans les comportements des acteurs, les conditions subjectives et objectives de différenciation entre les acteurs, ou encore le processus d’individuation qui dévoile la violence symbolique.
C’est ainsi que, en suivant la logique de Bourdieu – et en synthétisant à l’extrême -, on peut rendre compte de l’individualisme contemporain par le triomphe de la pensée néo-libérale : elle a en effet réussi à imposer "l’individualisation de la relation salariale" (Contre-feux, Raisons d’agir, 1998, p. 111) et, par le biais du vote et du sondage, la sérialisation "démocratique". Comme il l’affirme dans une conférence de 1973 : "Avec le sondage, ou le vote, comme avec le marché, le mode d’agrégation est statistique, c’est-à-dire mécanique et indépendant des agents" (Propos sur le champ politique, Presses Universitaires de Lyon, 2000, p. 85). Or, "le mode de production atomistique et agrégatif cher à la vision libérale est favorable aux dominants qui ont intérêt au laisser-faire et peuvent se contenter de stratégies individuelles (de reproduction) parce que l’ordre social, la structure, joue en leur faveur" (p. 87). Quant à la fameuse "crise des valeurs" et à la désagrégation du sujet, elles sont liées à un individualisme consumériste qui exalte le pulsionnel, à une situation d’anomie tout à fait particulière qu’on pourrait qualifier de pannomique : dans une société marchande hyperrelativiste, où les incitations au travail ne peuvent rivaliser avec les invitations au divertissement et où, parce que "tout se vaut", c’est à chacun de faire son choix, c’est-à-dire de se donner les moyens d’assouvir ses envies, c’est bien la déréglementation axiologique qui crée le malaise dans la civilisation. (Sans oublier non plus l’anomie économique, que Durkheim définit comme un décalage entre les aspirations matérielles des individus et leur situation).
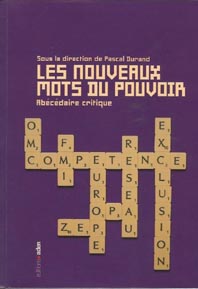
![[Dossier : Autour de 68] Pensée anti-68 ou révolution conservatrice ?](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)
![[Dossier : Autour de 68] Pensée anti-68 ou révolution conservatrice ?](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2008/09/band-68.jpg)