J’avais rendu compte ici, en juin dernier, des Variations de guerre publiées voici deux ans chez Ypsilon, dans la traduction de Marie Fabre ; voici que celle-ci récidive ce printemps, en nous offrant cette fois La Libellule (La Libellula, Panegirico della Libertà), chez le même éditeur et en version bilingue. C’est un travail splendide sur une œuvre de premier ordre.
Amelia Rosselli, La Libellule, traduction Marie Fabre, Ypsilon éditeur, 2014, 19 €, ISBN : 978-2-35654-035-5.
Agencement
Il s’agit là de la première traduction complète de ce vaste poème où Amelia Rosselli, rompant avec le vers libre, expérimente un travail total de la langue en toutes ses composantes, dans le cadre d’une métrique dont le principe est de mesurer chaque vers pour l’œil et pour la voix en tirant parti de la possibilité qu’offre la machine à écrire d’uniformiser la taille des espaces typographiques. Ainsi chaque vers présente à peu près le même nombre d’espaces (blancs et ponctuation compris), superposant une rythmique spatiale à la ligne accentuelle : l’excellente idée d’avoir repris en italien comme en français le caractère typographique utilisé par l’auteur, rend l’effet parfaitement clair. On se dit, du coup, que Rosselli est en somme l’inventrice de la métrique du « vers justifié » notamment pratiquée aujourd’hui en français par Yvan Ch’Vavar (Cf. Travail du poème, éd. des Vanneaux) ou Claude Favre (que précéda d’ailleurs Roger Giroux) :
L A P O I T R I N E j e E N L ‘ A B S E N
T E D E Q U I i m p o s s i b l e S I P
A R L E R c h u t ! N E F I G U R E L E
C O U T E A U S O L E I L m a n q u e u
n o s C E S S E M A I S A U S S I t o m
b a D A N S L E B L A N C t o u j o u r
s C O M M E L I T M A I N T E N A N T t
ê t e E T L E M U R b a h P U I S T O M
B A C O M M E V E R T E S E N T E N C E
R. Giroux, Poème (1969-1972), éd. « Théâtre typographique », 2007
Rédigé en 1958, La Libellula n’a été publié qu’en 1969 dans le recueil Serie ospedaliera, puis réédité à part en 1985. Rosselli était tout à fait consciente de la charnière décisive qu’il introduit dans son œuvre ; elle en parle comme d’un « délirant cours de pensée occidentale » déroulé comme un immense rouleau chinois que la version définitive condense au quart. Outre la rythmique du vers justifié, l’impétueux flux de langue du poème est constamment relancé par une poétique de la litanie incantatoire, progressant en vastes vagues anaphoriques, cellules syntaxiques répétitives, parallélismes ramifiés, motifs et thèmes récurrents « selon un procédé de répétition-variation, écrit Marie Fabre, qu’elle met ici au point en flux tendu avant de le comprimer dans ses Variations. »
Polyphonie
On sait qu’Amelia Rosselli est parallèlement investie, depuis sa jeunesse, dans la composition musicale et dans l’ethno-musicologie : Dalla-Picola, l’école de Darmstadt (autour de Stockhausen), le dodécaphonisme, etc. D’où son attention aux dynamiques des langues saisies dans le plan de la lettre, du son, du timbre, du « bruit » qu’elle écoute et travaille comme des « particules rythmiques » où se coagule pour elle une expérience à la fois éblouissante et déboussolante : « je suis une qui/expérimente avec la vie ». Détresse et violence, exaltation et déchirement, noyades aux abysses et envols d’écume à la crête de la vague : c’est une polyphonie cyclonique dont la dynamique errante se lie indissolublement – comme chez Van Gogh – aux assauts terrassants de la folie qu’on enferme :
Et le délire me prit à nouveau, me transforma
hébétée et usée en un vaste puits de peur,
m’appela par ses étendards blancs et violents,
me poussa à la porte de la folie. Me ruina
pour cette entière durée et ce jour tout entier.
M’étendit taquine à terre : incapable de bouger,
fatiguée à l’aube, incapable le soir : et l’agonie
toujours plus vive.
De basses eaux en hauts-fonds, le flot du poème brasse et rebrasse la langue italienne en sa diversité (les dialectes y demeurent une réalité très vivante, y compris sur le plan littéraire) comme dans son histoire hantée par de très grands Anciens – dont l’empreinte se découvre d’ailleurs à la pointe même de l’invention moderne, puisque si Rosselli affirme refuser de « soupirer après la sénilité des langues toscanes », elle s’étonne aussi de « rime[r] à l’ancienne avec une modernité/que je n’avais pas soupçonnée dans mes combines. » La traduction excelle, selon moi, à suggérer par un vocabulaire et des tournures inventives audacieusement réactualisés depuis les grands fonds de notre langue, les oscillations énergumènes de cet ouragan italien aussi raffiné que vulgaire à ses heures, instruit des racines latines et ouvert aux néologismes contemporains, mêlé d’archaïsmes et de décalques d’autres langues, etc.
découvre d’ailleurs à la pointe même de l’invention moderne, puisque si Rosselli affirme refuser de « soupirer après la sénilité des langues toscanes », elle s’étonne aussi de « rime[r] à l’ancienne avec une modernité/que je n’avais pas soupçonnée dans mes combines. » La traduction excelle, selon moi, à suggérer par un vocabulaire et des tournures inventives audacieusement réactualisés depuis les grands fonds de notre langue, les oscillations énergumènes de cet ouragan italien aussi raffiné que vulgaire à ses heures, instruit des racines latines et ouvert aux néologismes contemporains, mêlé d’archaïsmes et de décalques d’autres langues, etc.
Par exemple :
Et l’esthétique ne fera plus notre joie nous
yrons vers les vents, la queue entre les jambes
dans une vaste expérimentation.
Ou bien :
[…] donc quelle nouvelle liberté
cherches-tu parmi des mots usés ? Pas la suave tendresse
de qui reste à la maison bien rencardé par ses hauts
murs et pense à lui-même. Pas l’oublivion usée
du géant qui sait ne pouvoir rimer qu’à l’intérieur
du cercle fermé de ses fréquentations désolées […]
Ainsi lire Rosselli aujourd’hui, dans cette traduction fidèle à l’étrangeté foncière de tout idiome poétique authentique, mais aussi attentive à trouver notre oreille, c’est à la fois se réjouir du réaffleurement moderne d’un très ancien partage des langues romanes, et vérifier les ressources contemporaines du dialogue créatif des langues et des accents.
L’autre dimension de cette polyphonie qui « cherche les formes universelles » (Espaces métriques, 1962), c’est la littérature elle-même, et particulièrement la poésie occidentale moderne lue et maîtrisée en trois langues : français, anglais et italien. Dans une note jointe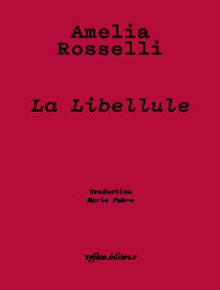 à son livre, Rosselli signale d’ailleurs les embrayeurs que lui ont fournis des vers de différents poètes, utilisés « comme points de départs, puis développés, manipulés dans un sens tout à fait subjectif, sur toute la durée du poème ». Les poètes cités sont Campana, Montale, Scipione et le Rimbaud de « H. » (Illuminations), mais il en est certainement bien d’autres, et dans d’autres langues. En effet, dans les années 1950-1958, elle écrit aussi bien en anglais (My clothes to the wind), en italien, en français (Le Chinois à Paris), que dans les trois langues mêlées (Diario in tre lingue). J’ai été sensible pour ma part à une forte présence de Lautréamont, pour son bestiaire (tarentule, requin, chauve-souris, rats, etc.), certaines images : « Souviens-toi de cette vie mienne attachée/à siroter le distillat ignoré de tes pupilles », certains tours de langue : « Et la voix rhétorique du bellâtre que je/vois sans amertume m’enrôle magiquement/et par luxure dans ses bons bras ouverts ». Je pense aussi possible un large dialogue avec le Rimbaud d’Une saison en enfer, notamment la séquence « Délires I » qui a l’air réécrite ici au point de vue de la « Vierge folle » :
à son livre, Rosselli signale d’ailleurs les embrayeurs que lui ont fournis des vers de différents poètes, utilisés « comme points de départs, puis développés, manipulés dans un sens tout à fait subjectif, sur toute la durée du poème ». Les poètes cités sont Campana, Montale, Scipione et le Rimbaud de « H. » (Illuminations), mais il en est certainement bien d’autres, et dans d’autres langues. En effet, dans les années 1950-1958, elle écrit aussi bien en anglais (My clothes to the wind), en italien, en français (Le Chinois à Paris), que dans les trois langues mêlées (Diario in tre lingue). J’ai été sensible pour ma part à une forte présence de Lautréamont, pour son bestiaire (tarentule, requin, chauve-souris, rats, etc.), certaines images : « Souviens-toi de cette vie mienne attachée/à siroter le distillat ignoré de tes pupilles », certains tours de langue : « Et la voix rhétorique du bellâtre que je/vois sans amertume m’enrôle magiquement/et par luxure dans ses bons bras ouverts ». Je pense aussi possible un large dialogue avec le Rimbaud d’Une saison en enfer, notamment la séquence « Délires I » qui a l’air réécrite ici au point de vue de la « Vierge folle » :
Lui pressait pour un nouveau rapport de plaisir,
lui courait à la poitrine de la femme aimée. Je répète
les leçons d’aïeux et de pères vieux comme les cages
d’escaliers ! À quoi me sert d’être faite de paille
si tu ne viens pas me déplacer avec ta fourche ? Si
tu ne viens pas me déplacer avec des pincettes? Avec
les pincettes de la violence me prier, me déplacer,
m’épouser ? Dans toute la lumière du soleil dans toute
l’oblique lumière du soleil dans toute la charité […]
– Ou encore, le désarroi du « compagnon d’enfer » à l’égard de l’ « époux infernal » : « Enfin sa charité est ensorcelée et j’en suis la prisonnière (…) On voit son Ange jamais l’Ange d’un autre », assez accordé avec la vaste litanie désespérée « j’entends les cris des anges … » des p. 29-31, que lance selon la note de l’auteur, un vers de Scipione :
[…] j’entends les cris anges
qui courent derrière moi, j’entends les stridences
des anges qui veulent mon salut, mais le sang
est doux au péché et il veut mon salut ; les
cris des anges qui veulent mon salut,
qui veulent mon péché ! qui veulent que je
tombe imberbe dans ton sang cri de l’ange.
J’entends les cris des anges qui disent adieu,
je l’ai déniaisé celui-ci, je reviens cet après-midi.
Au début du poème, c’est à Apollinaire que je pense : « Seul en Europe tu n’es pas antique ô Christianisme/L’Européen le plus moderne c’est vous pape Pie X » (Zone) – évidemment, s’il y a là clin d’œil ou complicité, c’est par l’antiphrase… Car en l’année 1958 où meurt Pie XII, après un règne commencé à l’aube de la seconde guerre mondiale :
La sainteté des saints pères était un produit si
changeant que je décidai d’écarter le moindre doute
de ma tête par trop trop claire et de prendre
l’élan pour un adieu plus difficile. Ce fut alors
que le saint siège fit brigue de s’élancer par-desssus
les fossés, comment ne sais, mais j’en restai hallucinée.
Apollinaire, encore : « C’est le Christ qui monte au ciel mieux que les aviateurs/Il détient le record du monde pour la hauteur […]/ Les anges voltigent autour du joli voltigeur/Icare Enoch Elie Apollonius de Thyane/Flottent autour du premier aéroplane ». Mais qui veut faire l’ange… Le voici parti en vrille et planté en flammes : la libellule, qui « fleuri[t] les vers d’autres altitudes », ne l’envoie pas dire à la sainte alliance démo-chrétienne :
Et la tournoyeuse langue des saints tombés avec les
allumettes allait incendier le vrai ciel
tant déchiré de sermons bien administrés à la meilleure
jeunesse.
Reste la crucifixion térébrante d’une mystique sauvage, comme un glaive plongé dans les vertèbres, entre les ailes :
Ma maladie est différente de la vôtre,
mon sanctuaire n’est pas celui du Christ, et il
l’est aussi, peut-être, si trop piègeuse l’épée entre
mes épaules.
Oppugner
La décennie 1950, c’est l’époque du fameux « boom » italien d’après-guerre dont l’intelligentsia italienne n’est pas vraiment prête à avaliser les valeurs sociales, morales et politiques, si l’on en juge par les romans passablement noirs et désenchantés des meilleurs écrivains de cette époque : par exemple Ragazzi di vita (Pasolini, 1955), Le Baron perché (Calvino, 1957), ou encore Le Guépard de Lampedusa (1958). Les idéaux de la Libération ont fait long feu, quoique le communisme et le syndicalisme constituent un pôle de résistance dynamique à la domination sans partage de la Démocratie chrétienne : relire ici, de Calvino, La Journée d’un scrutateur (1963). Quant à elle, Amelia Rosselli s’inscrit au parti communiste en 1958 et La Libellule est sous-titré : « Panégyrique pour la Liberté ».
On ne pleure pas si la jeunesse est dévoyée,
on ne rit pas si le père est un noble au chômage,
on ne rit pas si la joie est un manège au chômage.
[…]
Ne tombe pas.
Ne gagne pas ! Ne perds pas, – ne fatigue pas. Non
ne déverse pas de rires solennels ; ne te répands pas rebelle!
Dans sa note jointe, elle précise l’enjeu de ce panégyrique libertaire, en reliant le nom de l’insecte avec « les mots ‘libelle’ et ‘liberté’ » : « en effet le poème a pour thème central la liberté, et notre manière, et ma manière, de la « libeller ». Avant les Variazioni belliche, la dimension belliqueuse de la liberté poétique en acte est donc affirmée :
[…] Je ne sais ce que je veux tu ne sais
qui tu es, et nous sommes presque quitte. Mais qu’est-ce
que je recherche si la chanson de la faible pitié n’est
que cette invective inventée par moi, que je ne sais
oppugner dans aucun autre parti qui ne soit le tien,
le mien, nos internes lanternes, et aucune
forte lumière de la vérité, et le monde qui attend
avec ses yeux lumineux, et peut-être pleins de sable.
Sur ce plan, Marie Fabre montre très bien, dans sa postface, que c’est dans son agencement énonciatif même que le poème entier « oppugne », en particulier contre le mode d’adresse habituel, en poésie lyrique, du sujet masculin à la femme désirée ; ici le chiasme du je et du tu brouille constamment le jeu, déstabilisant les rapports sujet/objet, désirant/désiré, masculin/féminin. On vient de lire : « Je ne sais ce que je veux tu ne sais / qui tu es, et nous sommes presque quitte ».
Et on lira plus loin :
Je ne sais si ton visage sait répéter quelque
fêlure interne ou si mes sens savent mieux
que ma tête virile que c’est vrai, ou s’il est
faux celui qui est beau, beau parce que semblable.
Ou beau parce que bon ? Je cherche et cherche, tu cours et cours.
Cela dit, ce libellus-libelle n’a jamais rien de programmé a priori, et encore moins de quoi que ce soit de didactique, y compris pour une supposée bonne cause : il s’invente et se re(dé)compose à tous risques dans les remous et les heurts de ses contradictions sublimement insolubles ; c’est ainsi que le Christ s’y trouve amoureusement paganisé dans une sorte d’anticipation visionnaire de ce que réalisera Pasolini dix ans après, avec Théorème :
[…]
mon sanctuaire n’est pas celui du Christ, et il
l’est aussi, peut-être, si trop piègeuse l’épée entre
mes épaules.
Et en me suivant il sera doux et pur comme les
archanges.
Pour ses yeux si blancs, – pour ses
membres si limpides, je vais cherchant la gloire !
Pour ses membres si doux, pour ses yeux si
rapides, je vais cherchant des gens qui cachent
des armes dans les fourrés. Pour ses yeux si blancs,
pour sa peau si délicate et puis pour ses yeux
si rusés, je vais cherchant des gens qui cachent.
Pour ses yeux si légers et pour sa bouche si
forte, je cherche des gens si forts, qu’ils me nourrissent
moi et lui aussi dans la nuit entre les blanches ailes
des anges si forts si doux si légers.
Ainsi s’exalte l’intensité d’un dire qui ne distingue pas l’éros de la charité, ni la pitié de la séduction ; et quant au chiasme des genres, il n’a ici d’autre statut que d’une crise ouverte, d’une tension déchirante à l’échelle de l’ensemble du poème, de telle sorte qu’on lit aussi, vers la fin, une très belle relance de la thématique provençale et dantesque de l’amour de loin en version ‘masculine ‘, qui rejoint la mystique du Néant pour celle qui a écrit : « Je n’ai aucune sorte d’appel/et aucun credo par lequel commencer mon long/appel » :
Embrassée je l’avays dans une étreinte
sans amour, dans une nuit sans fond, sans
fond d’amour. Et je t’appelle t’appelle t’appelle
sirène, j’y suis seul. Et tu sonnes et résonnes et
résonnes et résonnes ô chimère. Et alors je t’appelle
et t’appelle et t’appelle chimère. Et je t’appelle
et t’appelle et t’appelle chimère.
– Et pour finir en énigme sur une rime dans l’entrelacs des temps, voici une devinette pour mes lecteurs : qui donc écrivit naguère, « Le pays des chimères est en ce monde le seul digne d’être habité, et tel est le néant des choses humaines, qu’hors l’Etre existant par lui-même, il n’y a rien de beau que ce qui n’est pas » ?
NOTE D’APPOINT
1. On trouvera sur le site de Poezibao une introduction d’Angèle Paoli à la vie et à l’œuvre d’Amelia Rosselli et sur celui de Terres de femmes une notice intéressante de Marie Fabre publiée en 2009 à l’occasion de l’anniversaire de sa disparition. Voir également le site des éditions Ypsilon.
2. La revue Europe n° 1996, avril 2012 a consacré un dossier à Amalia Rosselli, avec des articles de Marie Fabre, Antonella Anedda, Andrea Zanzotto, une anthologie de poèmes et une traduction de l’introduction d’Amelia Rosselli à Espaces métriques.
3. On trouve sur You tube divers enregistrements de lectures données par Amelia Rosselli ; écouter en particulier « Prosavox – Variazioni Belliche », ainsi qu’une interprétation vigoureuse de La Libellula par Consuelo Ciatti.
![[Chronique] Amelia Rosselli, La Libellule, par Jean-Nicolas Clamanges](https://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2014/05/RosselliBackG.jpg)
![[Chronique] Amelia Rosselli, La Libellule, par Jean-Nicolas Clamanges](https://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2014/05/LIBELLULE_BLEUE.jpg)