Depuis longtemps Sade, adopté comme le Vieux par Maupassant, pendant de Rousseau dans la généalogie d’André Breton, apprivoisé en bloc d’abyme poétiquement correct par Annie Lebrun, a cessé de remplir son office d’épouvantail à moinillons. « Attaquer le soleil » ? Au mieux, retarder d’un micron le big crunch dans notre banlieue stellaire.
Il a ses dévots qui ont achevé de le tirer d’enfer, Maurice Heine son premier éditeur moderne, Gilbert Lely surtout, auteur d’une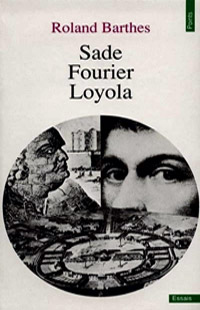 monumentale Vie de Sade, mais d’un lyrisme parfois désuet (« le chant zénithal de Sade » ou « La Coste, ô naissance, ô ruines ! poussières qui m’avez fait prince. Dans la vallée du Calavon tous les amandiers sont en fleurs. Vous êtes là, Sade. Je sens s’infléchir contre ma bouche les rais de votre invisible sourire », Ma civilisation, 1961). Il a ses séides médiocres tel Hugues Rebell (Le fouet à Londres, 1905), son cuistre nomenclateur (Krafft-Ebing), un pertinent lecteur célèbre, Roland Barthes relevant sa parenté avec Proust, de composition rhapsodique plutôt que suivie, et sa délicatesse toujours pensée et transgressive ; un autre disert, discursif, asséché par la prise de distance obligée, Maurice Blanchot lisant La nouvelle Justine comme le scandale absolu alors que cette dernière mouture, systématique, excessive, ne communique pas l’émotion des simples infortunes de la vertu ni surtout de Justine ou les malheurs de la vertu, la version centrale, plusieurs fois rééditée du vivant de l’auteur ; le « son » d’une cloche, celle de l’église de « Sainte-Marie-des-bois » où l’héroïne sera prise au piège de sa piété, résonne davantage en moi que les « mugissements » d’une voix de victime déformée par un casque.
monumentale Vie de Sade, mais d’un lyrisme parfois désuet (« le chant zénithal de Sade » ou « La Coste, ô naissance, ô ruines ! poussières qui m’avez fait prince. Dans la vallée du Calavon tous les amandiers sont en fleurs. Vous êtes là, Sade. Je sens s’infléchir contre ma bouche les rais de votre invisible sourire », Ma civilisation, 1961). Il a ses séides médiocres tel Hugues Rebell (Le fouet à Londres, 1905), son cuistre nomenclateur (Krafft-Ebing), un pertinent lecteur célèbre, Roland Barthes relevant sa parenté avec Proust, de composition rhapsodique plutôt que suivie, et sa délicatesse toujours pensée et transgressive ; un autre disert, discursif, asséché par la prise de distance obligée, Maurice Blanchot lisant La nouvelle Justine comme le scandale absolu alors que cette dernière mouture, systématique, excessive, ne communique pas l’émotion des simples infortunes de la vertu ni surtout de Justine ou les malheurs de la vertu, la version centrale, plusieurs fois rééditée du vivant de l’auteur ; le « son » d’une cloche, celle de l’église de « Sainte-Marie-des-bois » où l’héroïne sera prise au piège de sa piété, résonne davantage en moi que les « mugissements » d’une voix de victime déformée par un casque.
(Qu’Agnès Rouzier, de lyrisme exact, au plus près de « regarder le soleil ou la tache aveugle », qui a réinventé en genre le « nul part », d’écriture chauffée à blanc comme on tire à blanc à ballets rouges, ait pu se méconnaître jusqu’à envier la continuité de Barthes et Blanchot.)
Deux siècles ont passé. Désormais jubilatoire, brandes en feu et flammes, Sade est perçu tout en re dont danse, bien ivre sur l’escarpement de langue. Celle du siècle des Lumières qui culmine en lui rassure – déliée, alerte, gargantuesque en érotisme. De donjon en bastille une œuvre accomplie la tête contre les murs et le vit à la main, lais vite à l’âme, l’évite-alarme pour l’insatiable libertin, n’effraie plus et son idiome occulte ce qu’en son temps elle eut de tragique, de sulfureux. « Ce n’est pas ma façon de penser qui fait mon malheur, écrit-il de prison à sa femme, c’est celle des autres. »
Vivre à hauteur de pensée, dit Nietzsche. Ou penser en descente de vivre ? En vrille ascensionnelle de désir transmué en art obsidional ?
Comme tout grand poète ou presque, Sade est inégal. La charge érotique et langagière des cent vingt journées de Sodome, de 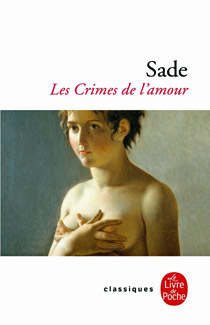 Justine ou les malheurs de la vertu, de l’Histoire de Juliette, sa sœur ou les prospérités du vice, ne se retrouve nulle part ailleurs dans son œuvre pourtant considérable. Rimbaud retour d’Abyssinie s’installe en homme de lettres, romancier, nouvelliste. Au début d’Aline et Valcour, un roman par ailleurs insipide, et dans maintes nouvelles des Crimes de l’amour ou esquisses des Historiettes, contes et fabliaux, l’autofiction fleurit avec une fraîcheur aussi naturelle que frelatée de nos jours, et en plusieurs versions l’on retrouve les aventures embellies d’un gentilhomme de bonne famille aux prises avec les parvenus fanatiques de la noblesse de robe. Quelques nouvelles font exception, surtout Augustine de Villeblanche (figurant on ne sait pourquoi dans les Historiettes) où impertinent d’un sexe en trompe-l’œil, pour une double séduction paradoxale Sade préfigure Wilde, et Eugénie de Franval dont l’héroïne éponyme, éduquée à dessein, est l’objet d’un amour plus total qu’incestueux où s’exprime toute la délicatesse relevée par Barthes.
Justine ou les malheurs de la vertu, de l’Histoire de Juliette, sa sœur ou les prospérités du vice, ne se retrouve nulle part ailleurs dans son œuvre pourtant considérable. Rimbaud retour d’Abyssinie s’installe en homme de lettres, romancier, nouvelliste. Au début d’Aline et Valcour, un roman par ailleurs insipide, et dans maintes nouvelles des Crimes de l’amour ou esquisses des Historiettes, contes et fabliaux, l’autofiction fleurit avec une fraîcheur aussi naturelle que frelatée de nos jours, et en plusieurs versions l’on retrouve les aventures embellies d’un gentilhomme de bonne famille aux prises avec les parvenus fanatiques de la noblesse de robe. Quelques nouvelles font exception, surtout Augustine de Villeblanche (figurant on ne sait pourquoi dans les Historiettes) où impertinent d’un sexe en trompe-l’œil, pour une double séduction paradoxale Sade préfigure Wilde, et Eugénie de Franval dont l’héroïne éponyme, éduquée à dessein, est l’objet d’un amour plus total qu’incestueux où s’exprime toute la délicatesse relevée par Barthes.
Théâtre de la cruauté, impossible si les victimes ne tiennent pas leur rôle de composition en gémissant au moment opportun. Dans les prospérités du vice Juliette monte un couvent dans son parc pour que son amant le ministre Saint-Fond et son ami aient le plaisir de le dévaster, y loge une famille qu’il a déjà persécutée pour de lubriques retrouvailles.
La couleur, la charge. Ce mauve, ce trébuchement de Thelonious Monk. Ce susurrement à pointes de feu de Miles Davis. Le fer rouge imprimant sur l’épaule de Justine une fleur de lys est celui même à mille rebours et retours qui inscrit les lettres de feu de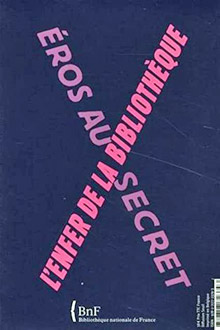 grâce perverse qu’exhale l’embastillé.
grâce perverse qu’exhale l’embastillé.
Sade l’homme pivot, dont les origines remontent aux croisades et à Laure chantée par Pétrarque, membre de la Section des Piques aux côtés de Robespierre (« Français, encore un effort si vous voulez être républicains ») ; son œuvre cardinale secouant l’aigrette tous azimuts, poussant ses antennes par delà Nietzsche, la psychanalyse et le surréalisme.
Tous à poil, dit-il, qui ne comprendrait rien au Japon.
Dans l’enfer des bibliothèques, un autre lui a succédé. La nouvelle ère glaciaire qui l’épargne et néglige les dits « scandales littéraires », telle Histoire à l’O de rose, telle lettre ouverte au colin froid, fusées d’artifice mouillées, qui préserve Céline et autres collabos de plume, y a précipité son descendant de moindre envergure, encore plus poète que lui, Tony Duvert.
Entretemps Alain Robbe-Grillet multiplie exhaustivement ses descriptions de minutie obsessionnelle avant d’abandonner le Nouveau Roman à son mauvais sort pour le cinéma, où il exerce plus efficacement sa filiation sadienne. Dès Portrait d’homme couteau (1969), Tony Duvert fissure cet univers implacable sous la poussée d’un désir de l’enfant qui répare l’enfant soi. Alternés, indissociablement fusionnels imparfait et présent toujours indicatifs, première et troisième personne, troisième et tierce d’un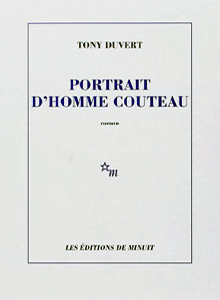 singulier singulier vitrifient au scalpel, délassent en poésie la prose la plus sèche. Le descriptif sans mode d’emploi déploie un mode d’envoi. Cette liberté a un prix : le récit est le meurtre, tout en reprises et variations, d’un garçonnet de dix ans attiré dans une vaste maison isolée, parfois en ruines, qui rédime la blessure de l’enfant soi dont barrant le ventre est tapie l’inamovible cicatrice dès les premiers paragraphes – bientôt tourne en quelques laisses contemporaines sans autre ponctuation que de blancs. La violence sourd, n’éclate pas, le descriptif clinique s’embue : « Un courant d’air passe sur son corps ; la peau frissonnante se granule puis s’apaise » ; « Je me suis penché, mes mains fouillent sous les chiffons souillés de crasse qui me cachent sa peau, son ventre, ses cuisses blanches. Je ne veux pas l’apprivoiser, mais lui faire mal » ; « Une image belle comme une vie à refaire passe dans la rue. »
singulier singulier vitrifient au scalpel, délassent en poésie la prose la plus sèche. Le descriptif sans mode d’emploi déploie un mode d’envoi. Cette liberté a un prix : le récit est le meurtre, tout en reprises et variations, d’un garçonnet de dix ans attiré dans une vaste maison isolée, parfois en ruines, qui rédime la blessure de l’enfant soi dont barrant le ventre est tapie l’inamovible cicatrice dès les premiers paragraphes – bientôt tourne en quelques laisses contemporaines sans autre ponctuation que de blancs. La violence sourd, n’éclate pas, le descriptif clinique s’embue : « Un courant d’air passe sur son corps ; la peau frissonnante se granule puis s’apaise » ; « Je me suis penché, mes mains fouillent sous les chiffons souillés de crasse qui me cachent sa peau, son ventre, ses cuisses blanches. Je ne veux pas l’apprivoiser, mais lui faire mal » ; « Une image belle comme une vie à refaire passe dans la rue. »
Dans Paysage de fantaisie (1973), une loupe concentre ses rayons sur « le dessous du gland l’échancrure en fer de lance que le  frein partage filet mince étiré par les vagues de peau qu’il retient et qui roulent sous les deux volutes de ce cœur à l’envers ». Indiqué comme roman, le livre est un pur poème où la pornographie enfantine, fixée à un âge que l’auteur n’a pas quitté, parle avec la musicalité de comptines d’Arrabal la langue que nous avons perdue à tout jamais, échouée sur la grève où s’entrecroisent guerre des boutons et retour à Roissy : « ils me tuent vraiment et je ne verrai jamais les poils de zizi que j’aurais eu sauf au paradis si ça y pousse » ; « il a des bras pleins de biceps il les arrondit un peu à la costaud » ; « il se tripote avec nous et sa mère crème fouettée monte entre ses cuisses ». Sur fond d’un pensionnat de prostitution garçonnière, deux voix principales alternent, de vieillard et de garçonnet, également torturés, récits frappés à la demi-volée de l’entre-deux songes. D’enfant qui « usine contre [des murs] d’urine », les « yeux de menthe gris ». Par antiphrase enfants tortionnaires, vieillards victimes dont le vice versicolore vers ça rampa.
frein partage filet mince étiré par les vagues de peau qu’il retient et qui roulent sous les deux volutes de ce cœur à l’envers ». Indiqué comme roman, le livre est un pur poème où la pornographie enfantine, fixée à un âge que l’auteur n’a pas quitté, parle avec la musicalité de comptines d’Arrabal la langue que nous avons perdue à tout jamais, échouée sur la grève où s’entrecroisent guerre des boutons et retour à Roissy : « ils me tuent vraiment et je ne verrai jamais les poils de zizi que j’aurais eu sauf au paradis si ça y pousse » ; « il a des bras pleins de biceps il les arrondit un peu à la costaud » ; « il se tripote avec nous et sa mère crème fouettée monte entre ses cuisses ». Sur fond d’un pensionnat de prostitution garçonnière, deux voix principales alternent, de vieillard et de garçonnet, également torturés, récits frappés à la demi-volée de l’entre-deux songes. D’enfant qui « usine contre [des murs] d’urine », les « yeux de menthe gris ». Par antiphrase enfants tortionnaires, vieillards victimes dont le vice versicolore vers ça rampa.
Las, Tony Duvert (1945 – 2008) ne s’est pas contenté d’être ce prosateur poète parmi les plus grands, il lui manquait d’être reconnu comme moraliste – d’un moralisme à rebours dénonçant « l’ordre hétérosexuel […] un système de mœurs fondé sur l’exclusion de presque tout plaisir amoureux et sur l’instauration d’inégalités, de falsifications, de mutilations corporelles et mentales chez les hommes, les femmes, les enfants » (Journal d’un innocent, 1976). À prétendre nous normaliser se dénonçant comme pathologique, sombré dans le militantisme pédo-pornographique, il est mort complètement délaissé depuis longtemps.
![[Chronique] Christophe Stolowicki, L'enfer des bibliothèques](https://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2020/05/EnfEROS.jpeg)
![[Chronique] Christophe Stolowicki, L’enfer des bibliothèques](https://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2020/05/band-EnfEROS.jpg)