Gertrude Stein, Tendres boutons, traduit de l’américain par Jacques Demarcq, postface d’Isabelle Alfandary, éditions Nous, Caen, automne 2018, collection « NOW », nouvelle édition en poche, 128 pages, 14 €, ISBN: 978-2-370840-59-2.
De briques et de broches, pour objets ses mots seuls, ses tendres boutons, en abyme toute, Gertrude Stein. À plusieurs jeux de miroir sans que rien ne distingue les mots « lexicaux et grammaticaux » (Isabelle Alphandary), cannibalesque incestueuse qui transgresse tous tabous syntaxiques, sémantiques, sans italiques ni guillemets. Ou d’un livre roboratif comme il en est peu, écrit (probablement) en 1911, (auto-)publié en 1915, la fracassante feutrée entrée en lice d’une géante de la poésie. Un taquinisme de l’absurde (tease récurrent, « La taquinerie est tendre et pénible et pensive »), une sourde jubilation transmutent la lumière, le mouvement.
 Gertrude, précurseur absolu. Des mots parasites s’infiltrent, allègent l’aporie (« Une protection mélangée, très mélangée avec la même inétrangeté intentionnelle et équitation ») ; des registres en grand écart, sous une même rubrique affichent un plain-pied moqueur (« un manque de langueur et davantage de blessures à l’aine »). Un humour d’appoint sans rire comprime compresse à rime qui voudra. Déconstruite, déjantée, écartelée la syntaxe, aplatie dérapant en parataxe, étalée écrasée la phrase au sol, amortie comme par un buvard – de ses miettes recollées le sens se reconstitue à l’encontre de tous les non-sens. L’absurde chancelle, du sens affleure dont la liaison s’est égarée. Sous les encombres sourd une comptine, se suspendent de latentes charades de peintre cubiste, le tout à étiage de ses parties. De « façon tordue » (a bent way), une métonymie fait oxymore, le discours hoquette son essence, décline ses substances molles. Chauffé à la loupe, écrit à la vitesse de l’éclair qui éclaire la lente ingestion d’une neuve culture picturale, le texte se décompose dans l’alentissement caudal. De conviction imperturbable, de drôlerie esquivée, en syncope hoquetée lisse de toute exclamation, lemmes et théorèmes ouvrent l’aporie, démonétisent le paradoxe. Son contemporain Tzara laissé bien en arrière, Breton n’en parlons pas, il faut remonter en France jusqu’à Gherasim Luca, en Amérique à Alice Notley qui insère des statistiques dans le poème, pour trouver de Gertrude un altère écho. Sinon Joyce – à moindre coût.
Gertrude, précurseur absolu. Des mots parasites s’infiltrent, allègent l’aporie (« Une protection mélangée, très mélangée avec la même inétrangeté intentionnelle et équitation ») ; des registres en grand écart, sous une même rubrique affichent un plain-pied moqueur (« un manque de langueur et davantage de blessures à l’aine »). Un humour d’appoint sans rire comprime compresse à rime qui voudra. Déconstruite, déjantée, écartelée la syntaxe, aplatie dérapant en parataxe, étalée écrasée la phrase au sol, amortie comme par un buvard – de ses miettes recollées le sens se reconstitue à l’encontre de tous les non-sens. L’absurde chancelle, du sens affleure dont la liaison s’est égarée. Sous les encombres sourd une comptine, se suspendent de latentes charades de peintre cubiste, le tout à étiage de ses parties. De « façon tordue » (a bent way), une métonymie fait oxymore, le discours hoquette son essence, décline ses substances molles. Chauffé à la loupe, écrit à la vitesse de l’éclair qui éclaire la lente ingestion d’une neuve culture picturale, le texte se décompose dans l’alentissement caudal. De conviction imperturbable, de drôlerie esquivée, en syncope hoquetée lisse de toute exclamation, lemmes et théorèmes ouvrent l’aporie, démonétisent le paradoxe. Son contemporain Tzara laissé bien en arrière, Breton n’en parlons pas, il faut remonter en France jusqu’à Gherasim Luca, en Amérique à Alice Notley qui insère des statistiques dans le poème, pour trouver de Gertrude un altère écho. Sinon Joyce – à moindre coût.
Précurseur. Davantage que d’aucun écrivain, du jazz à reprises, retouches, biffures en grappes de notes de Thelonious Monk, près d’un demi-siècle après Tendres boutons. De son piano solo (Thelonious Alone In San Francisco, 1959) tout en anacoluthes, syllepses, zeugmes – sans parler des évidentes anaphores et épistrophes (Epistrophy l’un de ses titres). Tout en rétropédalages, hoquets, regrets de peintre qui répondent à pas de chat, à pas de côté à l’interrogation, celle dont Gertrude a aboli le point. A no, a no since, a no since when, a no since when since, a no since when since a no since when since, a no since, a no, a no since a no since, a no since a no since, gonfle roule un jazz que fêlent ses temps faibles.
To be a wall with a damper « un mur avec sourdine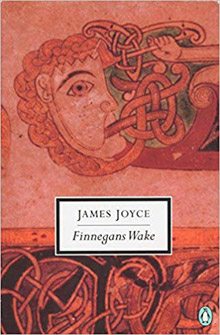 » a stream of pounding « un courant de martèlement » éthique, étique & tic encolle engramme la pure poésie mieux que l’association libre ou l’écriture automatique. Brièveté en sauts de puce, salves de monosyllabes pour un élargissement final – on pense au fourmillement de cymbales qui clôt en points de suspension maints morceaux de jazz. Une « harmonie de l’hésitation » surmultiplie dans l’américain la politesse anglaise. De brut alizé Gertrude écrit un américain enchérissant d’américain sur l’anglais, de l’américain exposant mille comme Finnegan’s wake est du concentré sucré salé d’anglo-irlandais pétri d’Europe ; elle est ce blanche nègre qui jaillira bientôt en jazz.
» a stream of pounding « un courant de martèlement » éthique, étique & tic encolle engramme la pure poésie mieux que l’association libre ou l’écriture automatique. Brièveté en sauts de puce, salves de monosyllabes pour un élargissement final – on pense au fourmillement de cymbales qui clôt en points de suspension maints morceaux de jazz. Une « harmonie de l’hésitation » surmultiplie dans l’américain la politesse anglaise. De brut alizé Gertrude écrit un américain enchérissant d’américain sur l’anglais, de l’américain exposant mille comme Finnegan’s wake est du concentré sucré salé d’anglo-irlandais pétri d’Europe ; elle est ce blanche nègre qui jaillira bientôt en jazz.
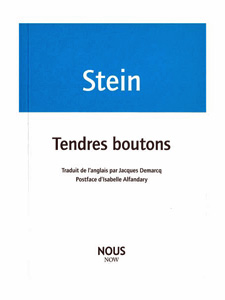 Eating he heat eating he heat it eating, he heat it heat eating. He heat eating excellemment rendu par Demarcq par « Manger en jet manger en jet j’ai mangé. En jet manger. » Ou It is so a noise to be is it a least remain to rest, is it a so old say to be, is it a leading are been. Is it so, is it so, is it so, is it soi s it soi s it so traduit par « C’est un tel bruit d’être, est-ce un moindre reste de reposer, est-ce si vieux disons d’être, est-ce un assenant ont été. Est-ce un si, est-ce un si, est-ce un si, est-ce un si ainsi ainsi ainsi », le martèlement final transposé avec une géniale hardiesse. Mais ce sont des exceptions. Si les hoquets d’anaphore ou d’épistrophe sont rendus avec inventivité, beaucoup d’allitérations sont perdues par une traduction textuelle. Ne pouvant rendre la rime anglaise facile de terminaisons en ing ou en er, rifs bottant en touche, il fait rimer quelques mots français rajoutés, d’effet moins entêtant. Dans un passage du chapitre Cuisine dont, après alas the wedding butter meat « hélas la viande au beurre du mariage », la chute est alas the back shape of of mussle, il ne rend pas le double sens de mussle entre muscle et mussel (moule), il aurait fallu augmenter le texte. On aimerait, n’aimerait pas être à sa place.
Eating he heat eating he heat it eating, he heat it heat eating. He heat eating excellemment rendu par Demarcq par « Manger en jet manger en jet j’ai mangé. En jet manger. » Ou It is so a noise to be is it a least remain to rest, is it a so old say to be, is it a leading are been. Is it so, is it so, is it so, is it soi s it soi s it so traduit par « C’est un tel bruit d’être, est-ce un moindre reste de reposer, est-ce si vieux disons d’être, est-ce un assenant ont été. Est-ce un si, est-ce un si, est-ce un si, est-ce un si ainsi ainsi ainsi », le martèlement final transposé avec une géniale hardiesse. Mais ce sont des exceptions. Si les hoquets d’anaphore ou d’épistrophe sont rendus avec inventivité, beaucoup d’allitérations sont perdues par une traduction textuelle. Ne pouvant rendre la rime anglaise facile de terminaisons en ing ou en er, rifs bottant en touche, il fait rimer quelques mots français rajoutés, d’effet moins entêtant. Dans un passage du chapitre Cuisine dont, après alas the wedding butter meat « hélas la viande au beurre du mariage », la chute est alas the back shape of of mussle, il ne rend pas le double sens de mussle entre muscle et mussel (moule), il aurait fallu augmenter le texte. On aimerait, n’aimerait pas être à sa place.
Une poète américaine trace traque fin la fin des fins afin que l’on devine ce qui se cache sous la faim : une soif de voir comme voient les peintres novateurs qu’elle découvre et dont elle collectionne les toiles dans son appartement parisien : Picasso, Matisse, Cézanne, Juan Gris. Aux traducteurs le dilemme : la transposer ou la traduire littéralement ? À lire la lumineuse postface d’Isabelle Alfandary (« La phrase s’auto-engendre s’auto-fertilise de la manière la plus singulière et la plus efficace qui soit. L’anaphore et l’allitération sont séminales à cet égard : les sons essaiment par accumulation ou par déclinaison agrammaticale. […] Par affinités sonores, analogies phoniques et contiguïté allitérative, se composent les pièces d’un puzzle improbable. Le poème est un morceau de pure jubilation orale […] Le son engendre l’image et aiguille le dire »), aucun doute, la transposer. Viendrait-il à l’idée de quiconque de traduire mot à mot Finnegan’s wake ? Or quand on lit, en avant-postface, les propos recueillis le 6 janvier 1946 (l’année de sa mort) à Paris par Robert Barlet Haas, on tombe des nues. Interrogée sur ce qui suscite ses poèmes, Gertrude ne répond que par des choses vues : « Je prenais des objets sur une table, comme un gobelet ou un autre, et je tentais d’en saisir l’image claire et distincte dans mon esprit et de créer une relation verbale entre le mot et les choses vues. […] Je tente de rappeler comment les choses apparaissent, notamment à l’œil d’un peintre. C’est difficile et demande pas mal de travail et de concentration. J’ai tenté de le montrer sans faire appel à rien d’autre. » Ou encore : « Il y a tant de choses à écarter pour garder constante la douceur de la suggestion. » Peut-on, épuisée il est vrai par l’épreuve (elle a vécu la guerre en France, en zone libre), être aussi inconsciente de son propre génie ? – Ou n’est-ce pas plutôt qu’il faut la prendre à la lettre, ici comme dans ses textes ? À ceci près que la traque de ce que voit en mouvement Matisse ou Picasso diffère de l’adéquation au regard d’Ingres ; et que tous les points en suspens que l’absurde creuse et dépareille, tout ce qu’il éveille et déconstruit et circonscrit, provoquent ce martèlement sourd à bout de vision, quand lâche la vision.
un autre, et je tentais d’en saisir l’image claire et distincte dans mon esprit et de créer une relation verbale entre le mot et les choses vues. […] Je tente de rappeler comment les choses apparaissent, notamment à l’œil d’un peintre. C’est difficile et demande pas mal de travail et de concentration. J’ai tenté de le montrer sans faire appel à rien d’autre. » Ou encore : « Il y a tant de choses à écarter pour garder constante la douceur de la suggestion. » Peut-on, épuisée il est vrai par l’épreuve (elle a vécu la guerre en France, en zone libre), être aussi inconsciente de son propre génie ? – Ou n’est-ce pas plutôt qu’il faut la prendre à la lettre, ici comme dans ses textes ? À ceci près que la traque de ce que voit en mouvement Matisse ou Picasso diffère de l’adéquation au regard d’Ingres ; et que tous les points en suspens que l’absurde creuse et dépareille, tout ce qu’il éveille et déconstruit et circonscrit, provoquent ce martèlement sourd à bout de vision, quand lâche la vision.
« Une banale colline, une qui n’est pas celle qui n’est pas blanche rouge et verte, une simple colline ne fait pas soleil et le montre sans aucune gêne. Donc la forme est là et la couleur et le contour, et le misérable centre. Il n’est pas très sûr qu’il y ait un centre, une colline est une colline et aucune colline n’est contenue dans une descente de lit rose tendre. » C’est une poésie descriptive (shows récurrent), dont les contradictions sont des nuances, dirait Nietzche. Mais descriptive en trompe-l’œil comme une peinture surréaliste expliquée aux grands enfants d’un coup de crayon à mine tendre. Se concentrant à visionner, l’œil feuillette le surréel, ce réel à valeur ajoutée – ce jeu de cartes, cet accordéon, cette pâte à modeler le temps. Isabelle Alphandary, de toute son intelligence n’y a vu que du feu et Jacques Demarcq est justifié, au prix de quelques juteux délices perdus, à avoir traduit pour l’essentiel en direct.
sans aucune gêne. Donc la forme est là et la couleur et le contour, et le misérable centre. Il n’est pas très sûr qu’il y ait un centre, une colline est une colline et aucune colline n’est contenue dans une descente de lit rose tendre. » C’est une poésie descriptive (shows récurrent), dont les contradictions sont des nuances, dirait Nietzche. Mais descriptive en trompe-l’œil comme une peinture surréaliste expliquée aux grands enfants d’un coup de crayon à mine tendre. Se concentrant à visionner, l’œil feuillette le surréel, ce réel à valeur ajoutée – ce jeu de cartes, cet accordéon, cette pâte à modeler le temps. Isabelle Alphandary, de toute son intelligence n’y a vu que du feu et Jacques Demarcq est justifié, au prix de quelques juteux délices perdus, à avoir traduit pour l’essentiel en direct.
Dans l’anagramme qu’entretient cette amphore l’idée d’anaphore fore son chemin de crêtes et de caroncules à qui traduit Gertrude en pintade, en pivoine, en pavane pour une in-fante de la poésie.
![[Chronique] Gertrude Stein, Tendres boutons (réédition, Nous), par Christophe Stolowicki](https://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2019/03/SteinBoutonsBackG.jpg)
![[Chronique] Gertrude Stein, Tendres boutons (réédition, Nous), par Christophe Stolowicki](https://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2019/03/band-steinBoutons.jpg)