Jacques Demarcq, La Vie volatile, éditions Nous, en librairie depuis le 20 août 2020, 400 pages, 30 €, ISBN : 978-2-370840-81-3
 « Le poète est semblable au prince des nuées » ? Pas tout à fait, cher Charles. C’est le poème, ou la page, qui est un vol (« de gerfauts » éventuellement, « aux bords mystérieux du monde occidental » : aux confins du hiéroglyphe et de l’idéogramme). Voilà pourquoi Jacques Demarcq zoziote, et toute la poésie « visuelle » ou « spatiale » avec lui. La Vie volatile prolonge Les Zozios : ni retombée, ni chute, accomplissement plutôt, et perfectionnement —dix ans de travail ! — d’un tour du monde spatial et temporel. Vie des volatiles (plus de 250 rassemblés dans un index avium) et nos vies volatiles se croisent, se font signe entre écriture, photo et peinture.
« Le poète est semblable au prince des nuées » ? Pas tout à fait, cher Charles. C’est le poème, ou la page, qui est un vol (« de gerfauts » éventuellement, « aux bords mystérieux du monde occidental » : aux confins du hiéroglyphe et de l’idéogramme). Voilà pourquoi Jacques Demarcq zoziote, et toute la poésie « visuelle » ou « spatiale » avec lui. La Vie volatile prolonge Les Zozios : ni retombée, ni chute, accomplissement plutôt, et perfectionnement —dix ans de travail ! — d’un tour du monde spatial et temporel. Vie des volatiles (plus de 250 rassemblés dans un index avium) et nos vies volatiles se croisent, se font signe entre écriture, photo et peinture.
Comme d’autres « Ni Dieu ni maître », Demarcq pourrait écrire : ni linéarité, ni filiation. Sauf des livres : « Qui lit descend au moins autant des auteurs qu’il a rencontrés que de son milieu (…). Je n’est pas tant un autre que plusieurs, une troupe de caméléons prenant les formes d’écritures les plus variées (…). Il faut être inculte, idiot, ou crétinisé par l’inculture de masse, pour penser qu’on écrit à partir de sa seule expérience. On peint mieux dans son atelier qu’à la campagne : Corot, Monet, etc. On change de monde dans sa bibliothèque : Montaigne… ». Demarcq écrit comme s’il peignait : il remonte de la linéarité de l’écriture à l’instantanéité du tableau, qui « se montre tout entier d’un coup, avant que l’esprit ne serpente dans le réseau de ses motifs, échos et tensions. Aucun poème, même bref, n’a cette instantanéité saisissante ». Même si les pages de la première et de l’avant-dernière partie du livre, « Aux Amériques » et « Du Sénégal », ressemblent à celles d’un journal, s’y insèrent des images et des poèmes où s’insèrent des images. Dans leur typographie même. Demarcq cite Barthes (Essais critiques) : « Toute secousse imposée par un auteur aux normes typographiques d’un ouvrage constitue un ébranlement essentiel […]. Attenter à la régularité matérielle de l’œuvre, c’est viser l’idée même de littérature ».
C’est « la nouveauté plastique des calligrammes » qui « a pu influencer Picasso », affirme d’abord Demarcq : «  Apollinaire insuffle de l’air entre les mots et les lignes ». Il revient un peu plus loin sur cette idée, car « une ligne d’écriture n’aura jamais l’intensité d’une droite tracée à la main, la fluidité d’une courbe, la sensualité d’une arabesque —surtout de Picasso — Des caractères typographiques séparés la font graphiquement bégayer, leur lisibilité parasitant leur visualité ». Mais c’est visuellement que les calligrammes de « Suite Apollinaire » et de « L’envol moderne » rendent hommage au rousseau, au picapo, à l’arp, aux delaunay, aux monet, aux brancusi, au kandinsky, au malevitch, aux mondrian, aux klee, au miró, à l’ernst, au giacometti, au léger, au matisse, délestés de toute majuscule, comme si Demarcq les traitait de noms d’oiseaux, leur ouvrait les cages des musées, celles de l’espèce : « J’ai feint de parler oiseaux par refus de l’anthropomorphisme, cette auto-idolâtrie de l’espèce ». Il dénonce l’ « incroyable prétention d’imaginer que, s’il y avait des dieux, ils s’intéresseraient d’abord à l’humanité ». Jaime Joycé le mène à Andrade, « porte-voix d’une conscience déchristianisée », où « l’esprit refuse de se concevoir sans corps ». Le Brésil a « découvert le bonheur avant que les Portugais découvrent le Brésil ».
Apollinaire insuffle de l’air entre les mots et les lignes ». Il revient un peu plus loin sur cette idée, car « une ligne d’écriture n’aura jamais l’intensité d’une droite tracée à la main, la fluidité d’une courbe, la sensualité d’une arabesque —surtout de Picasso — Des caractères typographiques séparés la font graphiquement bégayer, leur lisibilité parasitant leur visualité ». Mais c’est visuellement que les calligrammes de « Suite Apollinaire » et de « L’envol moderne » rendent hommage au rousseau, au picapo, à l’arp, aux delaunay, aux monet, aux brancusi, au kandinsky, au malevitch, aux mondrian, aux klee, au miró, à l’ernst, au giacometti, au léger, au matisse, délestés de toute majuscule, comme si Demarcq les traitait de noms d’oiseaux, leur ouvrait les cages des musées, celles de l’espèce : « J’ai feint de parler oiseaux par refus de l’anthropomorphisme, cette auto-idolâtrie de l’espèce ». Il dénonce l’ « incroyable prétention d’imaginer que, s’il y avait des dieux, ils s’intéresseraient d’abord à l’humanité ». Jaime Joycé le mène à Andrade, « porte-voix d’une conscience déchristianisée », où « l’esprit refuse de se concevoir sans corps ». Le Brésil a « découvert le bonheur avant que les Portugais découvrent le Brésil ».
Demarcq réécrit des tableaux comme il réécrit (et peint) « Le Corbeau » de Poe et « Zone » d’Apollinaire. Changement de décor à vue et en couleurs, l’Hourloupe de Dubuffet devient « D’Ubu fait dure loupe ». Le tableau s’éveille poème, le poème tableau :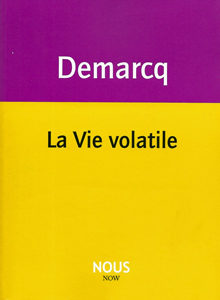 Demarcq réécrit et repeint en même temps, comme un jazzman s’empare d’un standard. L’improvisation en jazz ressemble à l’instantanéité photographique, à celle de la notation : « le feuillage frémit, telle la peau d’une caisse claire sous les balais de Max Roach (…) j’aurai vécu ce frisson de lumière, ce jazz de printemps ». Loin du « cratylisme dénicheur de racines naturelles », il retient « l’idée qu’a Meens d’un signifiant non sémiologique ». Les vols découpés, insérés dans sa page, ne sont pas auspices. Son écriture intègre « de plus en plus d’images », ses photos « souvent détournées, voire recomposées, sont des clins d’œil faussement documentaires », l’emprunt à la nature devenant « un signifiant parmi d’autres ». Le réel est « du vivant inarticulé », et effronté : quand le poète sort son appareil, la bergeronnette « regarde droit l’objectif ». Mais il y a quelque chose du geste définitif du peintre, du jazzman, dans « M’attire l’œil et vite le téléobjectif le vol stationnaire d’un martin-pêcheur ».
Demarcq réécrit et repeint en même temps, comme un jazzman s’empare d’un standard. L’improvisation en jazz ressemble à l’instantanéité photographique, à celle de la notation : « le feuillage frémit, telle la peau d’une caisse claire sous les balais de Max Roach (…) j’aurai vécu ce frisson de lumière, ce jazz de printemps ». Loin du « cratylisme dénicheur de racines naturelles », il retient « l’idée qu’a Meens d’un signifiant non sémiologique ». Les vols découpés, insérés dans sa page, ne sont pas auspices. Son écriture intègre « de plus en plus d’images », ses photos « souvent détournées, voire recomposées, sont des clins d’œil faussement documentaires », l’emprunt à la nature devenant « un signifiant parmi d’autres ». Le réel est « du vivant inarticulé », et effronté : quand le poète sort son appareil, la bergeronnette « regarde droit l’objectif ». Mais il y a quelque chose du geste définitif du peintre, du jazzman, dans « M’attire l’œil et vite le téléobjectif le vol stationnaire d’un martin-pêcheur ».
Car c’est maintenant ou jamais, now or « never more ». La biosphère a déjà rétréci pour les 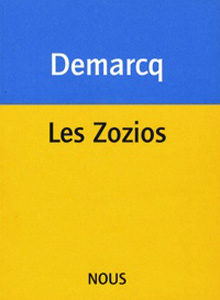 survivants que met en scène l’ « oziatorio » final, « et si une révolatilution ». Dilution, évaporation du vivant, d’où le titre du livre. Les vœux pieux font FLOP (onusien entre autres) : « Forum Limité aux Options de Prières ». Les mêmes nous bercent de « promesses de sauver la planète qu’ils bousillent chaque jour davantage ». On invite l’Indien, l’Océanien, « pour le folklore, pas pour (les) entendre ». Le Grand corbeau en appelle à Hitchcock, à Edgar Poe, pour éborgner « leur morgue aux idéologues ». Le Canard chipeau crie « vive la grève des z’ailes ». Pour Macounaïma l’Indien, « la nature, envahie d’humaines fictions, a pu se laisser contaminer jusqu’à se mentir ». Car « les hommes sont d’un naturel pervers : contre nature ». Assumée, la précarité devient allègement, et entre les interlocuteurs volent ces répliques : « vivons (…) avant de nous volatiliser (…) dans nos airs, prenons du champ, et dansons légers ! ».
survivants que met en scène l’ « oziatorio » final, « et si une révolatilution ». Dilution, évaporation du vivant, d’où le titre du livre. Les vœux pieux font FLOP (onusien entre autres) : « Forum Limité aux Options de Prières ». Les mêmes nous bercent de « promesses de sauver la planète qu’ils bousillent chaque jour davantage ». On invite l’Indien, l’Océanien, « pour le folklore, pas pour (les) entendre ». Le Grand corbeau en appelle à Hitchcock, à Edgar Poe, pour éborgner « leur morgue aux idéologues ». Le Canard chipeau crie « vive la grève des z’ailes ». Pour Macounaïma l’Indien, « la nature, envahie d’humaines fictions, a pu se laisser contaminer jusqu’à se mentir ». Car « les hommes sont d’un naturel pervers : contre nature ». Assumée, la précarité devient allègement, et entre les interlocuteurs volent ces répliques : « vivons (…) avant de nous volatiliser (…) dans nos airs, prenons du champ, et dansons légers ! ».
![[Chronique] Jacques Demarcq, La Vie volatile, par François Huglo](https://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2020/08/DemarcqBackG.jpg)
![[Chronique] Jacques Demarcq, La Vie volatile, par François Huglo](https://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2020/08/band-Demarcq.jpg)