On lit dans le premier numéro d’avril de la Nouvelle Quinzaine littéraire, un éloge sans retenue des performances de la critique génétique moderne qui a de quoi donner de l’humeur.
– Et fort noire, il faut bien l’avouer, au moins pour qui se soucie encore de ce que peut une œuvre d’art, et particulièrement une œuvre littéraire, pourvu qu’on ne la réduise pas à une simple variante de ce qu’elle aurait virtuellement pu être si l’auteur n’avait pas eu la naïveté de chercher le mot le plus définitivement juste, le phrasé le plus définitivement idoine, la composition de la phrase, du paragraphe, et de toutes les unités textuelles qu’on voudra – la plus définitivement parfaite possible, relativement à l’effet général visé.
C’est donc à propos de l’édition des OC II de Flaubert en Pléiade, et de la numérisation en cours de tous ses manuscrits disponibles, que Michel Pierssens s’extasie :
« Tout change en revanche radicalement dès que ce qui donne lieu à numérisation n’est plus seulement le texte des œuvres mais tout le dossier génétique dont elles finissent par n’être plus qu’une potentialité actualisée. (…) Si telle page a été dix fois réécrite par Flaubert, c’est à ces dix pages que la numérisation pourra donner accès, en version brute ou dans une transcription intégrale. (…) Toute œuvre dont les archives de la création ont été préservées donnera lieu ainsi à la construction d’une entité hybride dont toutes les composantes seront également indispensables : le texte de plaisir (Madame Bovary reste un merveilleux roman) et le texte de savoir (pas une ligne qui n’appelle une exploration encyclopédique démesurée). La version imprimée, si agréable à manier qu’elle soit, ne sera plus que la version physique allégée de la nébuleuse hypertextuelle dont elle n’est qu’une partie, aussi distincte qu’on la voudra. »
(« Flaubert dans le temps », Quinzaine littéraire, n°1002, p. 3-4, je souligne)
 De l’œuvre voulue et publiée comme dernier état (regrettablement donné pour terminé par l’artiste, en dépit de son caractère quasi aléatoire aux yeux de la génétique textuelle) d’une nébuleuse hypertextuelle qui sera sa vérité authentique enfin advenue pour les siècles des siècles : ou encore, de la dissolution programmée de la volonté de l’artiste de livrer non pas dix mille esquisses mais un objet achevé, voilà où nous en sommes ! Le travail d’une vie pour trouver le mot et la formule qui seuls convenaient, réduit à une variante des possibles progressivement éliminés.
De l’œuvre voulue et publiée comme dernier état (regrettablement donné pour terminé par l’artiste, en dépit de son caractère quasi aléatoire aux yeux de la génétique textuelle) d’une nébuleuse hypertextuelle qui sera sa vérité authentique enfin advenue pour les siècles des siècles : ou encore, de la dissolution programmée de la volonté de l’artiste de livrer non pas dix mille esquisses mais un objet achevé, voilà où nous en sommes ! Le travail d’une vie pour trouver le mot et la formule qui seuls convenaient, réduit à une variante des possibles progressivement éliminés.
Il suffit de transposer le raisonnement dans les arts plastiques pour constater la vanité de la démarche : qu’est-ce qu’on obtient en récupérant dans la poubelle de Rodin tous les éclats de son Balzac, sinon le bloc de pierre initial ? Et si l’on n’en récupère qu’une partie, car la quatrième poubelle est déjà partie aux ordures, qu’est-ce qu’on va pouvoir en faire, sinon imaginer sans génie ce que l’artiste n’a vraisemblablement jamais imaginé, parce que l’essentiel se passait dans sa tête et que personne ne peut y aller voir, quand elle est – cette tête-là – en phase de genèse créatrice.
Et puis tout lecteur de, par exemple Baudelaire ou Mallarmé, sait que toute grande œuvre est faite autant de ce qu’elle montre que de ce qu’elle dérobe, autant de ce qu’elle élimine que de ce qu’elle accueille : « La Destruction fut ma Béatrice » écrivit le second ; comme la lettre volée de la nouvelle de Poe, ce qu’on cherche dans la corbeille ou au grenier se trouve dans le texte, il suffit d’apprendre à lire – ce que précisément les œuvres d’art nous apprennent, non comme jeu sémiotique de variantes sur variantes à l’infini, mais comme confrontation à ce qui par excellence est leur quête – le réel même (qui n’est pas la "réalité") :
« Qu’est-ce que dessiner ? Comment y arrive-t-on ? C’est l’action de se frayer un passage à travers un mur de fer invisible, qui semble se trouver entre ce que l’on sent et ce que l’on peut. Comment doit-on traverser ce mur, car il ne sert à rien d’y frapper fort, on doit miner ce mur et le traverser à la lime, lentement et avec patience à mon sens. » (Van Gogh, lettre à son frère Théo, La Haye, 1882)
Allez donc chercher le sens d’un tel frayage et la portée humaine d’une telle patience dans les rognures laissées par la lime ou les vestiges de repentirs du geste ! À bas la prétention abusive à étouffer l’œuvre achevée par l’artiste sous la prolifération tentaculaire des traces de ses essais et de ses échecs recombinées a posteriori ! Ces « savants » peuvent bien travailler en équipes aussi nombreuses qu’on voudra et avec toutes les technologies présentes et à venir : ils devraient ne jamais oublier que les vrais brouillons de l’écrivain – qui sont mentaux et donc immatériels – leur manqueront toujours pour établir leur fameux « (hyper)texte de savoir » censé rivaliser d’intérêt avec un « texte de plaisir » dont l’achèvement rêvé en perfection fut toujours un calvaire pour tout écrivain digne de ce nom !
Je sais bien que les œuvres ont partie liée au désœuvrement dans leur essence, Blanchot l’a montré, et que cela se traduit parfois par de l’inachèvement ; pas seulement à notre époque, qui cultive l’art de l’esquisse (au moins en France) mais également au XVIIIe siècle par exemple, où certains romans, et non des moindres (La Vie de Marianne, de Marivaux ; Les Égarements, de Crébillon, par exemple) demeurent inachevés (mais aussi parce qu’ils se publiaient en feuilleton) ; en poésie, certaines œuvres demeurent en suspens, comme le Kubla Khan de Coleridge, dont l’inspiration fut à jamais détruite, dit-on, par une visite inopportune. Mais cela ne contredit nullement le fait que, pour les romans, l’horizon des possibles ainsi ouvert ne soit conditionné par la moindre phrase ou le moindre paragraphe des pages publiées, qui participent organiquement de l’œuvre projetée (comme la cellule participe du corps entier) et contiennent en quelque sorte son dess(e)in dans le leur ; et quant au poème de Coleridge, la présence filigranée du Tout disparu dans ce qu’il sauva du poème aperçu en rêve est lisible à mon avis dans ce que Kipling écrit des premiers vers : « De tous les millions de vers possibles, il n’y en a pas plus de cinq — cinq petites lignes — dont on puisse dire : "Ceux-là sont de la magie. Ceux-là sont de la vision" ».
Je sais bien aussi que Ponge a publié La Fabrique du pré, mais cette fabrique n’est pas un artefact : c’est une création intégrant des états du texte sélectionnés et voulus comme composantes de l’œuvre, selon un projet esthétique in progress ; en peinture aussi, on peut regarder certaines œuvres sous cet angle : de Braque à François Rouan, qu’un artiste rebatte autrement son propre jeu, dédouble ou détriple une œuvre pour en déplier les possibles à sa guise, c’est toujours et avant tout un geste esthétique et une prise de risque. Mais ce n’est pas le terrain du critique (ou des équipes) travaillant sur les manuscrits – sauf s’ils se prennent pour l’artiste… !
On sait comment tel fameux peintre de l’Antiquité accepta les remarques d’un cordonnier touchant la représentation d’une sandale sur un de ses tableaux ; mais lorsque le cordonnier voulut se mêler d’apprécier d’autres éléments du tableau, il le congédia d’un Ne sutor ultra crepidam – cordonnier, ne juge pas au-delà de la chaussure. Que la génétique textuelle en reste donc à l’étude des vestiges matériels des états anciens des œuvres et ne prétende pas en inférer l’hypertexte qui nous serait resté dérobé par on ne sait quelle perversité de l’artiste. Qu’on étudie les variantes, les brouillons disponibles, etc. : très bien, à condition de ne pas les poser comme alternatives enfin redécouvertes au texte voulu définitif (ou le moins indéfinitif possible) par l’écrivain ; et pourvu, enfin, qu’on ne se donne pas l’œuvre publiée comme une simple variante parmi toutes les autres, une « potentialité actualisée » parmi x potentialités. Contrairement au mythe, selon Lévi-Strauss, une œuvre d’art n’est pas constituée de l’ensemble de ses variantes, virtuelles ou non.
Pourquoi ? Parce que c’est précisément le fait d’une œuvre créatrice – sa définition pas moins, selon moi – que de nier le hasard des virtualités possibles à l’infini, par l’affirmation d’une décision esthétique qui ajoute au monde quelque chose là où il n’y avait rien. C’est 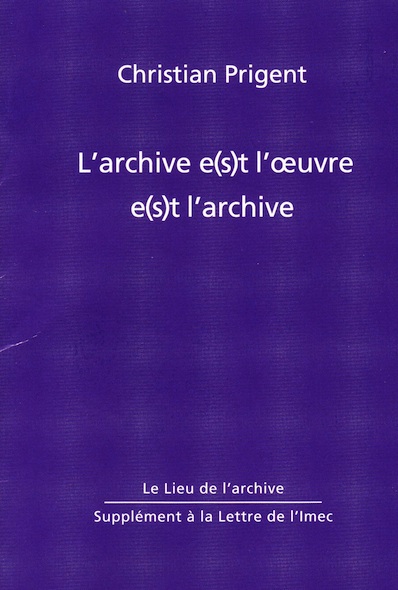 bien ce qu’affirme aujourd’hui Christian Prigent :
bien ce qu’affirme aujourd’hui Christian Prigent :
Je ne suis crispé sur rien d’autre que ceci : un livre de littérature est un objet d’art (au même titre qu’une peinture, un concerto, un ballet, etc.). Il pose dans le monde une entité formelle jusqu’à lui non-vue. C’est en tant que tel qu’il s’apprécie parce que c’est là tout le sens des opérations qui l’ont fait tel qu’il se donne à lire. Cette appréciation tient à la perception sensorielle d’un phrasé singulier : une certaine vitesse, une certaine allégresse et une certaine violence de la dynamique formelle (ça touche au détail rythmique, à la densité des coagulations lexicales, à la structure composée de l’ensemble). Quelque chose de d’abord sensuellement perceptible (comme la musique, comme la peinture), qui force le monde à se courber, à se former et à s’illuminer autrement — puis qui éveille la pensée à cet autrement : à la découverte d’une toujours possible altérité, d’une exception au lieu commun (au lieu idéologique commun, entre autres). Autant dire que l’intérêt est dans la transformation, l’altérité, l’exception, la différence stylistiquement formées et cinématographiées. Pas dans la conformité, l’adéquation, le rendu du matériau de vie que cela, inévitablement, traite.
(« Christian Prigent, un ôteur réeliste », entretien avec F. Thumerel, italiques de C. Prigent, je souligne)
Beaucoup d’appelés rêvent d’une œuvre potentielle (Barthes a rêvé d’un roman qu’il n’écrivit jamais), peu d’élus la réalisent en acte car cela exige leur vie même (qu’on relise les lettres de Van Gogh à Théo et le Van Gogh d’Artaud), et sans guère d’accueil ni d’écoute authentiques de leur vivant parce que là où cela advient, rien n’était attendu et que quasi personne n’est là pour l’accueillir, même si certains font semblant. Comme l’écrivait Mallarmé : « Des contemporains ne savent pas lire » (Variations sur un sujet) ; Marivaux l’avait déjà dit à sa façon, en pointant une sorte de suicide esthétique programmé par l’impact désastreux sur les auteurs du goût critique dominant : « je crois, (…) qu’en tout siècle, la plupart des auteurs nous ont moins laissé leur propre façon d’imaginer, que la pure imitation de certain goût d’esprit que quelques critiques de leurs amis avaient décidé le meilleur ; ainsi, nous avons très rarement le portrait de l’esprit humain dans sa figure naturelle » (Le Spectateur français, 21 août 1722).
Ainsi, l’irruption d’une œuvre digne de ce nom n’est pas l’actualisation d’une potentialité parmi d’autres : elle est choix radical ou n’est pas, elle est coup de foudre indéfiniment durable dans le temps humain ; c’est pourquoi elle est aussi rare que décisive parce qu’en ce domaine, comme en tout ce qui importe vraiment :
Ce qu’on attendait demeure inachevé.
À l’inattendu les dieux livrent passage.
(Euripide, derniers vers des Bacchantes)
![[Chronique] Jean-Nicolas Clamanges, De la dissolution programmée des oeuvres par la critique génétique : à propos de la numérisation des brouillons de Flaubert](https://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2014/05/BrFlaubertBackG.jpg)
![[Chronique] Jean-Nicolas Clamanges, De la dissolution programmée des oeuvres par la critique génétique : à propos de la numérisation des brouillons de Flaubert](https://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2014/05/band-genetiqueFl.jpg)