Jonathan Littell, Une vieille histoire, Fata Morgana, 2012, 128 pages, 16 €, ISBN : 978-2-85194-831-1 ; nouvelle version, Gallimard, mars 2018, 384 pages, 21 €, ISBN : 978-2-07-277684-7.
Littell écrit dans la première version d’Une vieille histoire (parue chez Fata Morgana en 2012) : « Je dépassai sans ralentir des ouvertures sombres, des embranchements ou juste des alcôves peut-être […]. Ici et là une partie plus sombre semblait ouvrir sur un réduit, voire même un tunnel, je passai mon chemin sans ralentir, suivant la courbe qui se prolongeait, et comme un enfant je tendis la main et laissai mes doigts traîner le long du mur, jusqu’à ce qu’ils heurtent un objet que je n’avais pas aperçu. C’était une poignée, je la poussai et ouvris la porte. Tout de suite, je sus que cet espace me convenait. »
Et, dans la version publiée chez Gallimard cette année, l’on peut lire (par exemple) :« Déjà je lançais mon cheval au galop à travers les champs, soulevé par un sentiment exaltant de liberté souveraine, l’air froid mordait mes joues et mes poumons et je m’en repaissais,  je me sentais grandir sur ma selle, jusqu’à devenir l’égal de la vaste plaine, de la neige, et du ciel au-dessus de moi. En fin d’après-midi nous atteignîmes une gare […]. Au fond de la pièce principale se trouvait une porte, je l’ouvris d’un coup de pied, elle donnait sur une galerie vide que je traversai en défaisant mon manteau et mon ceinturon, au bout il y avait une autre porte, […] rapidement je me défis […] de mes vêtements, ne gardant que le survêtement et enfilant les baskets que j’avais gardées en poche, la porte était ouverte et dès que j’eus franchi le seuil je me mis à courir. […] J’étais désorienté et je me cognai aux murs à plusieurs reprises avant de trouver un semblant d’équilibre qui me permette d’avancer d’une manière régulière, respirant avec aise, au rythme de ma course. Mais le couloir s’incurvait, je ne parvenais pas à rester au centre et de nouveau mon épaule heurta une paroi, je croyais distinguer des taches encore plus foncées, peut-être des bifurcations ou juste une dépression, et j’aurais pu me jeter dans une de ces ouvertures, obliquer ou changer ainsi de corridor, peut-être cela aurait-il servi à quelque chose, mais je me sentais envahi par un vaste sentiment de futilité, peut-être, me disais-je, si j’avais aperçu quelqu’un d’autre, une figure humaine, j’aurais pu la rejoindre, nous aurions cheminé ensemble et cela aurait peut-être un peu allégé nos pas, car même si nous ne nous étions pas parlé, si nous n’avions pas échangé une seule parole, nous aurions entendu nos souffles respectifs et le son de nos foulées, une présence, donc, elle aurait été là à côté de moi et moi à côté d’elle, cela aurait eu quelque chose de vaguement réconfortant, mais il n’y avait rien, même pas une ombre, et ainsi je continuai droit, car de toute façon tourner ou tenter un nouveau passage, dans l’état des choses, n’aurait servi à rien, j’évitai ces ouvertures […] ».
je me sentais grandir sur ma selle, jusqu’à devenir l’égal de la vaste plaine, de la neige, et du ciel au-dessus de moi. En fin d’après-midi nous atteignîmes une gare […]. Au fond de la pièce principale se trouvait une porte, je l’ouvris d’un coup de pied, elle donnait sur une galerie vide que je traversai en défaisant mon manteau et mon ceinturon, au bout il y avait une autre porte, […] rapidement je me défis […] de mes vêtements, ne gardant que le survêtement et enfilant les baskets que j’avais gardées en poche, la porte était ouverte et dès que j’eus franchi le seuil je me mis à courir. […] J’étais désorienté et je me cognai aux murs à plusieurs reprises avant de trouver un semblant d’équilibre qui me permette d’avancer d’une manière régulière, respirant avec aise, au rythme de ma course. Mais le couloir s’incurvait, je ne parvenais pas à rester au centre et de nouveau mon épaule heurta une paroi, je croyais distinguer des taches encore plus foncées, peut-être des bifurcations ou juste une dépression, et j’aurais pu me jeter dans une de ces ouvertures, obliquer ou changer ainsi de corridor, peut-être cela aurait-il servi à quelque chose, mais je me sentais envahi par un vaste sentiment de futilité, peut-être, me disais-je, si j’avais aperçu quelqu’un d’autre, une figure humaine, j’aurais pu la rejoindre, nous aurions cheminé ensemble et cela aurait peut-être un peu allégé nos pas, car même si nous ne nous étions pas parlé, si nous n’avions pas échangé une seule parole, nous aurions entendu nos souffles respectifs et le son de nos foulées, une présence, donc, elle aurait été là à côté de moi et moi à côté d’elle, cela aurait eu quelque chose de vaguement réconfortant, mais il n’y avait rien, même pas une ombre, et ainsi je continuai droit, car de toute façon tourner ou tenter un nouveau passage, dans l’état des choses, n’aurait servi à rien, j’évitai ces ouvertures […] ».
Ainsi, la « nouvelle version » est l’occasion d’un long (semblant parfois démesuré) développement, en suivant les méandres (infinis ?) d’un onirisme qui a, à notre égard, la morsure, la crudité, la cruauté du réel le plus implacable. Un onirisme qui pèse sur notre cœur au point d’éveiller en nous, bien souvent, un sentiment de nausée. De telle sorte que puisse jaillir du sol, fleur vénéneuse mais belle (d’une beauté irréelle), l’inquiétante étrangeté chère à Freud.
Ou plus exactement cette nouvelle version est l’occasion offerte à Littell d’un accroissement fort louable de sa palette de peintre, de coloriste. Quantité de gris jusque-là inaudibles (les couleurs, dans un texte, on les entend) font chemin jusqu’à notre entendement. Et aident notre imagination à prendre son envol (jusqu’à éveiller cette fois notre vision, depuis notre profond). Bien souvent (si l’on prend en considération l’ensemble du livre) en étant piquetée, – cette imagination que l’on ne reconnaît plus totalement comme étant nôtre –, avec les pointes si nombreuses, effilées de la sauvagerie, au point de s’en trouver endolorie comme un muscle ainsi malmené le serait.
Si Littell cite Blanchot en exergue de la nouvelle (et définitive ?) version d’Une vieille histoire, en réalité, c’est – quelle que soit la version de son histoire– de Bataille qu’il s’inspire le plus.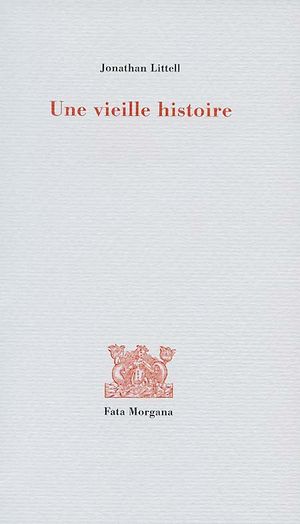
Littell (exemple n° 1): « Tout autour régnait une vaste confusion des corps ; en partie ou bien entièrement dévêtus, ils s’enlaçaient sur les divans et la moquette, s’ouvrant les uns aux autres en un joyeux communisme sauvage où les organes, les mains et les bouches avides prenaient le pas sur les individus, les éclatant, les brouillant, les mêlant en une marée de cris et de soupirs rauques, secouée de spasmes irréguliers. »
Marée de cris et de soupirs rauques… Comment ne pas songer aux spasmes de la mer décrite ci-après par Bataille ? « La mer faisait déjà un bruit énorme, dominé par de longs roulements de tonnerre, et des éclairs permettaient de voir comme en plein jour les deux culs branlés des jeunes filles devenues muettes. […] Ce qui apparaît à travers la fente, c’est le bleu d’un ciel dont la profondeur "impossible" nous appelle et nous refuse aussi vertigineusement que notre vie appelle et refuse la mort. »
Littell (exemple n° 2) : « La jeune femme blonde m’avait précédée et, son image redoublée dans les glaces, dansait presque nue devant la grande couche au tissu vert et doré. […] Arrivée devant la fille blonde, je la pris par les épaules et la couchai sur le ventre, posant sa poitrine menue et son visage dans les longues herbes brodées du tissu. Comme involontairement, elle écarta les jambes, je m’agenouillai derrière elle sur le divan et caressai ses cuisses fines et nerveuses . […] Je glissai une main sous son corps étroit, le long du ventre puis de l’aine, repoussant le tissu mouillé de sa culotte pour rouler entre mes doigts sa petite verge molle et ses bourses recroquevillées. »
Bataille : « À d’autres, l’univers paraît honnête. Il semble honnête aux honnêtes gens parce qu’ils ont des yeux châtrés. C’est pourquoi ils craignent l’obscénité. Ils n’éprouvent aucune angoisse s’ils entendent le cri du coq ou s’ils découvrent le ciel étoilé. En général, on goûte les "plaisirs de la chair" à la condition qu’ils soient fades. »
Littell (exemple n° 3) : « Dans la pièce au hamac, le jeune homme suspendu se trouvait maintenant seul, affalé la tête en arrière, les jambes ballantes, le corps maculé de sperme et marbré de traces de coups ou de brûlures de  cigarettes, vidé, inerte, perdu dans un autre espace. J’aurais pu lui relever les jambes et l’enfiler à mon tour, mais je préférai rester là à le regarder gémir doucement, replié en lui-même et parti très loin, je l’enviais et aurais bien aimé être à sa place, mais il semblait que je ne devais pas maîtriser les règles obscures de ce lieu car nul ne voulait de moi. »
cigarettes, vidé, inerte, perdu dans un autre espace. J’aurais pu lui relever les jambes et l’enfiler à mon tour, mais je préférai rester là à le regarder gémir doucement, replié en lui-même et parti très loin, je l’enviais et aurais bien aimé être à sa place, mais il semblait que je ne devais pas maîtriser les règles obscures de ce lieu car nul ne voulait de moi. »
Bataille : « L’être ouvert – à la mort, au supplice, à la joie – sans réserve, l’être ouvert et mourant, douloureux et heureux, paraît déjà dans sa lumière voilée : cette lumière est divine. Et le cri que, la bouche tordue, cet être tord peut-être mais profère est un immense alléluia, perdu dans le silence sans fin. »
Si Littell fait recours– délicatement et immensément – à l’obscénité (avec une exubérance que son style continûment corsète), c’est uniquement pour suivre le commandement proféré par Bataille dans Le Coupable, c’est uniquement pour « met[tre] l’être en face de lui-même ».
Et mettant l’être en face de lui-même, il compose, avec Une vieille histoire (ancienne et nouvelle versions) une – intense – œuvre poétique, au sens – exact – où l’entend Marie-Christine Lala (in Georges Bataille, poète du réel) : « [L]’œuvre poétique ouvre un accès renouvelé au symbolique en favorisant la projection d’un espace de possibles, là où le réel impossible qu’elle fait advenir (dans l’outrance du désir […]) libère le mouvement de translation du monde en son exubérance infinie. Ce qui advient comme le monde n’est que la mise à nu de ce qui est dans le rejaillissement de la vie. »
![[Chronique] Jonathan Littell, Une vieille histoire (ancienne et nouvelle versions), par Matthieu Gosztola](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)
![[Chronique] Jonathan Littell, Une vieille histoire (ancienne et nouvelle versions), par Matthieu Gosztola](https://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2018/06/band-littellVieilleHistoire.jpg)
La connivence avec Bataille est probable. Mais je pense aussi à Kazuo Ishiguro ou même à David Lynch (pour ce qui est de l’onirisme). Et puis il y a la dépersonnalisation du narrateur – sa position de spectateur dédoublé qui, à force de se regarder voyant, développe une conscience labyrinthique, débarrassée d’émotions. Pur formalisme ?