Victor Hugo, Les Misérables, édition d’Henri Scepi avec la collaboration de Dominique Moncond’huy, Paris, Gallimard, collection Bibliothèque de la Pléiade, n° 85, 1824 pages, 22 février 2018, 65 € (prix de lancement jusqu’au 30 juin 2018).
En octobre 1839, Hugo visite le bagne de Toulon et note peu de temps après cette phrase parmi d’autres qui seront prêtées à Mgr Myriel : « Je suis en ce monde non pour garder ma vie mais pour garder les âmes. » [1] En février 1846, alors qu’il se rend à la Chambre des pairs, l’auteur de Claude Gueux croise un homme « pâle, maigre, hagard », accusé d’avoir volé un pain, et accompagné en conséquence de deux soldats. Aussitôt, la scène se fait image, et le profil de l’homme accablé « se dote d’une lisibilité inédite », pour reprendre la formulation d’Henri Scepi dans sa passionnante préface. « Cet homme n’était plus pour moi un homme, écrit Hugo, c’était le spectre de la misère, c’était l’apparition, difforme, lugubre, en plein jour, en plein soleil, d’une révolution encore plongée dans les ténèbres, mais qui vient. » (Choses vues, souvenirs, journaux, cahiers[2])
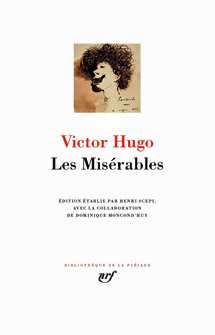 Dans « Ateliers nationaux », discours recueilli in Actes et paroles I. Avant l’exil en 1875, Hugo se fait encore plus disert : « la question […] est dans les détresses du peuple, dans les détresses des campagnes qui n’ont point assez de bras, et des villes qui en ont trop, dans l’ouvrier qui n’a qu’une chambre où il manque d’air, et une industrie où il manque de travail, dans l’enfant qui va pieds nus, dans la malheureuse jeune fille que la misère ronge et que la prostitution dévore, dans le vieillard sans asile, à qui l’absence de providence sociale fait nier la providence divine ; la question est dans ceux qui souffrent, dans ceux qui ont froid et qui ont faim. » Ces « pauvres êtres », confie Hugo dans Les Misérables, « la meule de l’ordre social les rencontre et les broie ».
Dans « Ateliers nationaux », discours recueilli in Actes et paroles I. Avant l’exil en 1875, Hugo se fait encore plus disert : « la question […] est dans les détresses du peuple, dans les détresses des campagnes qui n’ont point assez de bras, et des villes qui en ont trop, dans l’ouvrier qui n’a qu’une chambre où il manque d’air, et une industrie où il manque de travail, dans l’enfant qui va pieds nus, dans la malheureuse jeune fille que la misère ronge et que la prostitution dévore, dans le vieillard sans asile, à qui l’absence de providence sociale fait nier la providence divine ; la question est dans ceux qui souffrent, dans ceux qui ont froid et qui ont faim. » Ces « pauvres êtres », confie Hugo dans Les Misérables, « la meule de l’ordre social les rencontre et les broie ».
L’auteur de La Légende des siècles s’intéresse, dans les années qui le voient résolument se tourner vers les questions humanitaires, à la façon dont les sociétés modernes favorisent – éperdument – l’éclosion de la misère, en faisant naître, « d’un même geste pour ainsi dire, la faute et l’expiation, le crime et le châtiment ». Il le dira dans un autre discours, celui sur la misère prononcé à l’Assemblée le 9 juillet 1849, résumé ainsi par Henri Scepi : « tout est affaire de conditions, la plongée dans l’abîme du mal résulte d’une conjoncture qui s’est raidie en mécanisme inexorable et convertie en loi inflexible. » L’écriture hugolienne se met à l’écoute de cette irrespirable scansion du néant ; elle scrute les instillations programmées du pire dans la vie et la conscience des hommes.
Dans L’Atelier des « Misérables », volet documentaire apparaissant comme un complément nécessaire à la lecture des Misérables et regroupant des textes de la main de Victor Hugo (qu’ils soient achevés ou non) occupant un orbe proche du centre générateur du roman, l’on peut lire ceci : « J’ai tâché de raconter l’histoire d’une de ces fourmis que la loi sociale écrase sans le vouloir et sans le savoir. On ne s’en doute pas et l’on va toujours. Pour les uns ce livre sera une faute, pour les autres ce sera une bonne action. Ce n’est ni une bonne action, ni une faute ; c’est un devoir accompli. […] Souvent le peuple tout entier se personnifie dans ces êtres imperceptibles et augustes sur lesquels on marche. Souvent, ce qui est fourmi dans le monde matériel est géant dans le monde moral. » Et Hugo précise – ailleurs – sa visée : « Montrer l’ascension d’une âme, et à cette occasion peindre dans leur réalité tragique les bas-fonds d’où elle sort, afin que les sociétés humaines se rendent compte de l’enfer qu’elles ont à leur base, et qu’elles songent enfin à faire lever une aube de ces ténèbres ; avertir, ce qui est la façon la plus directe de conseiller ; tel est le but de ce livre. »
Avertir, c’est-à-dire enseigner. C’était déjà le sous-texte de Claude Gueux : « Messieurs, il se coupe trop de têtes par an en France. Puisque vous êtes en train de faire des économies, faites-en là-dessus. Puisque vous êtes en verve de suppressions, supprimez le bourreau. Avec la solde de vos quatre-vingts bourreaux, vous paierez six cents maîtres d’école. »
Avant Les Misérables, Claude Gueux (1834), Le Dernier Jour d’un condamné (1829), sans omettre Notre-Dame de Paris (1831), forment le templum où se projette l’empreinte angoissée de l’humanité. Ces récits attestent, ainsi que le souligne Henri Scepi, « que l’œuvre romanesque entreprend, sur des modes divers, de faire jouer les facettes diffractées d’un même prisme anthropologique et politique : y domine la peinture de l’homme dans la cité, non pas l’homme abstrait, chimère des philosophes et des moralistes, mais l’individu assujetti aux lois et aux dogmes, soumis à l’injustice institutionnelle, livré à l’indifférence publique, condamné enfin par la rigueur impitoyable de la machine juridique à la peine capitale. »
Heureusement, il est des présences providentielles, veillant sur les enfants et les pauvres, sur les faibles et les déshérités, tel Jean Valjean, qui sauve aussi bien Cosette que Marius, de sa même poigne vigoureuse. Nous pouvons identifier, dans le massif touffu et ramifié des Misérables, cette silhouette parente dont il conviendrait d’épouser le profil progressivement révélé en un acte de reconnaissance irrécusable.
pouvons identifier, dans le massif touffu et ramifié des Misérables, cette silhouette parente dont il conviendrait d’épouser le profil progressivement révélé en un acte de reconnaissance irrécusable.
Sorti comme un fantôme de l’épaisseur des bois, au moment même où Cosette, « harassée de fatigue » et désespérée par tant d’ombre, s’écrie « Ô mon Dieu, mon Dieu », Jean Valjean intervient : « En ce moment, elle sentit tout à coup que le seau ne pesait plus rien. Une main, qui lui parut énorme, venait de saisir l’anse et la soulevait vigoureusement. Elle leva la tête. Une grande forme noire, droite et debout, marchait auprès d’elle dans l’obscurité. »
Et, beaucoup plus tard dans le roman : « Marius était resté dehors. Un coup de feu venait de lui casser la clavicule ; il sentit qu’il s’évanouissait et qu’il tombait. En ce moment, les yeux déjà fermés, il eut la commotion d’une main vigoureuse qui le saisissait [c’était celle de Jean Valjean], et son évanouissement, dans lequel il se perdit, lui laissa à peine le temps d’[une] pensée mêlée au suprême souvenir de Cosette […]. »
D’autres exemples pourraient être convoqués, arrachés à cette somme, à ce livre-monde qu’est Les Misérables. Si Les Misérables est une somme, il ne faut pas oublier que sa publication fut, pour son auteur, l’aboutissement qui couronna plus de deux années d’un travail intense et assidu, si l’on s’en tient à la seule période de reprise et d’achèvement de l’œuvre pendant l’exil. Mais c’est en réalité une temporalité beaucoup plus vaste qui doit être prise en compte. Elle est déterminée par trois moments décisifs : 1845-1848 (amorce de la rédaction des Misères, interrompue « pour cause de révolution »), décembre 1851 (coup d’État et début de la période de l’exil) et 1860 (reprise des Misérables), ainsi que le résume Henri Scepi. Néanmoins, la période qui court de février 1848 à avril 1860 ne doit pas être considérée comme exempte de toute préoccupation ou de toute réflexion directement rattachée à l’œuvre interrompue, ajoute l’exégète. Maints indices démontrent en effet que dans l’effervescence créatrice des années 1850, qui verra émerger des recueils tels que Les Contemplationsou La Légende des siècles (Iresérie), à aucun moment Hugo ne renonce : le roman passe au second plan mais ne s’efface pas ; il hante sourdement l’esprit d’un écrivain qui, en mai 1856, inclura dans la liste des ouvrages nouveaux susceptibles d’être publiés par son éditeur d’alors, Hetzel, « Les Misérables, roman en six volumes ».
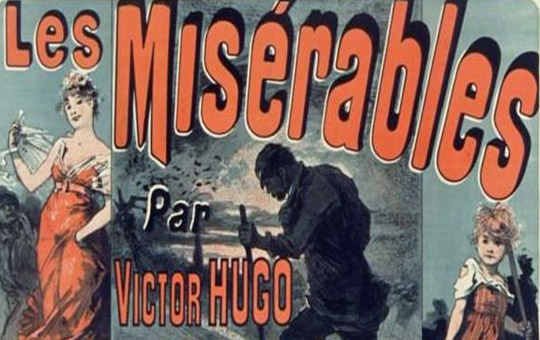
[1] Voir René Journet et Guy Robert, Le Manuscrit des « Misérables », Presses Universitaires de Franche-Comté, collection Annales littéraires, 1963.
[2] Édition d’Hubert Juin, Gallimard, collection Quarto, 2002.
![[Chronique] Les Misérables : nouvelle édition en Pléiade, par Matthieu Gosztola](https://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2018/06/Miserables2.jpg)
![[Chronique] Les Misérables : nouvelle édition en Pléiade, par Matthieu Gosztola](https://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2018/06/band-Miserables.jpg)