Stanislas Rodanski est de retour. J’avais chroniqué ici, l’an passé, la splendide exposition dont cet écrivain avait fait l’objet à la bibliothèque de Lyon Part-Dieu, en révélant l’ampleur et le potentiel d’une œuvre qui pour l’essentiel nous précède, s’il est vrai que « la route 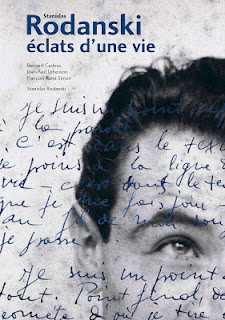 est encore longue pour qui est loin devant » (Tomas Tranströmer) : qui se trouve intéressé n’a qu’à cliquer pour y retrouver les éléments bio-bibliographiques utiles, ainsi que le lien vers le site remarquable de l’Association Stanislas Rodanski.
est encore longue pour qui est loin devant » (Tomas Tranströmer) : qui se trouve intéressé n’a qu’à cliquer pour y retrouver les éléments bio-bibliographiques utiles, ainsi que le lien vers le site remarquable de l’Association Stanislas Rodanski.
Si Rodanski (1927-1981) a d’emblée été reconnu comme poète, ce qui émerge depuis quelques années c’est l’importance de ses écrits narratifs : La Victoire à l’ombre des ailes, édité au Soleil noir et préfacé par Gracq (1975) puis repris chez Bourgois, a très vite été un roman culte ; mais on connaît maintenant son journal et on découvre ses autres fictions narratives. Ainsi, après avoir édité Requiem for me aux « Éditions des cendres » (en liaison avec la Bibliothèque Jacques Doucet où est conservé le fonds Rodanski), François-René Simon récidive cette année avec ce Substance 13 – dont l’établissement du texte avait une allure de ‘mission impossible’ on va le voir –, en publiant parallèlement, cette fois chez Gallimard, un important volume de poèmes largement inédits : Je suis parfois cet homme.
Stanislas RODANSKI, Substance 13, éditions des cendres, 2013, 187 pages, 24 €, ISBN : 978-2-86742-214-0.
Parcours fléché
C’est de Substance 13 qu’il s’agira ici. Ce sont trois cahiers manuscrits (peut-être un quatrième s’est-il perdu ?), laissés à Julien Gracq par Rodanski en mai 1951, au cours de son internement psychiatrique à Villejuif (1950-1952), et qu’il n’a jamais relus ensuite. Ils sont écrits comme un chemin de ronde qui commencerait à n’importe quelle page pour revenir sans cesse au même, mais ailleurs, en d’autres pages, d’autres cahiers – ce qui a fort compliqué la tâche de leur scrupuleux éditeur, qui présente ainsi le premier cahier :
« La page de garde porte le titre, encadré : substance 13. La suite est un véritable parcours fléché. Le texte principal commence … p. 49, connaît une dizaine de renvois éparpillés dans le cahier et bien indiqués par Rodanski, comme s’il reprenait sa rédaction en ouvrant chaque fois son cahier au hasard : suite page 33, et au milieu de ladite page 33, suite de la page 19 ; au bas de la page 137, suite page 73 ; page 22, suite de la page 46 ; page 138, on est suite de la page 73, mais au milieu on se retrouve suite de la page 87. Ne multiplions pas les exemples : ils donnent des sueurs froides. » (‘Avant propos’, p. 8)
En outre, les cahiers intègrent des fragments variés : poèmes, lettres, graphismes… « comme des notes impérieuses » au fil des pages, écrit F.-R. Simon, que l’on trouvera rassemblés en annexe mais dont le texte imprimé ne  rend pas le côté proliférant, comme on peut s’en aviser dans le fragment ci-joint : « Le rayon invisible », qu’on retrouvera transcrit ‘en clair’ à la page 179. Avec des œuvres de cette nature, l’édition devient un sport extrême !
rend pas le côté proliférant, comme on peut s’en aviser dans le fragment ci-joint : « Le rayon invisible », qu’on retrouvera transcrit ‘en clair’ à la page 179. Avec des œuvres de cette nature, l’édition devient un sport extrême !
Tout se passe comme si Rodanski s’était trouvé à tel point possédé par son film mental qu’il pouvait le reprendre et le poursuivre à son gré dans tous les sens. Il n’est pas le premier écrivain à se trouver dans ce cas : Nabokov ne composait pas autrement (il n’écrivait qu’après avoir tout imaginé dans le plus grand détail), et Thomas d’Aquin pouvait dicter en alternance plusieurs traités à ses secrétaires: ces têtes-là savaient travailler sans les livres en toutes circonstances. Or à l’époque où s’écrit Substance 13, les circonstances externes et internes sont absolument chaotiques pour Rodanski ; mais s’il semble lui aussi avoir su par cœur sa bibliothèque virtuelle, ce fut pour la déranger de fond en comble sous l’exigence d’une esthétique supérieure de composition des faits :
« il est vrai que l’on compare une certaine forme de trouble mental à un livre aux cahiers mêlés comme les cartes d’un jeu, quoiqu’il soit correctement rédigé, que rien ne manque, on a perdu le fil. […] Qu’on se représente un roman qui ne serait pas fait pour
être
mais relier les faits entre eux. »
Requiem for me, (rédaction en 1950-1952) éditions des cendres, 2009, p. 27-28.
Écrire par gros temps
Rodanski mène en effet ses tentatives narratives comme des romans d’enquête où il joue sa peau à déchiffrer certaines situations dramatiques où il est impliqué avec d’autres, en les recomposant selon d’autres grilles que celles de la logique ordinaire. Il applique là une méthode ‘analogique’ pratiquée par Breton dans Poisson soluble (1924) et L’Amour fou (1937), mais sur un tout autre matériel puisque les faits en question ressortissent au domaine relevant de la presse criminelle et de ce qu’on appelle à l’époque le « roman-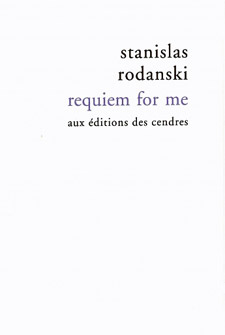 détective ». Subissant, à cette période de sa vie, de violentes crises hallucinatoires (elles sont précisément décrites dans Requiem for me, p. 44-51), il écrit par gros temps dans l’urgence, quand la vitesse de la jeunesse (il n’a pas vingt-cinq ans) prend de court les neuroleptiques, s’aidant des techniques de l’improvisation moderne où il est passé maître (ce grand plagiaire ducassien imite tout ce qu’il veut), sans craindre l’ellipse ni la redite: c’est un peu comme si Nadja avait réécrit Nadja en court-circuitant la prose classique de Breton par les procédés du roman policier, du montage cut et de la surimpression – avec Tandis que j’agonise en arrière-plan pour les transferts d’identité et le monologue intérieur, et peut-être un côté Molly Bloom pour certaines pages au féminin. À quoi s’ajoute l’art du détournement, notamment ces « Textes Tout Prêts » qu’il prélevait dans la presse courante pour leur affreuse beauté.
détective ». Subissant, à cette période de sa vie, de violentes crises hallucinatoires (elles sont précisément décrites dans Requiem for me, p. 44-51), il écrit par gros temps dans l’urgence, quand la vitesse de la jeunesse (il n’a pas vingt-cinq ans) prend de court les neuroleptiques, s’aidant des techniques de l’improvisation moderne où il est passé maître (ce grand plagiaire ducassien imite tout ce qu’il veut), sans craindre l’ellipse ni la redite: c’est un peu comme si Nadja avait réécrit Nadja en court-circuitant la prose classique de Breton par les procédés du roman policier, du montage cut et de la surimpression – avec Tandis que j’agonise en arrière-plan pour les transferts d’identité et le monologue intérieur, et peut-être un côté Molly Bloom pour certaines pages au féminin. À quoi s’ajoute l’art du détournement, notamment ces « Textes Tout Prêts » qu’il prélevait dans la presse courante pour leur affreuse beauté.
Rodanski pensait pourtant que son état psychique lui avait fait commettre « quelques erreurs de principe » sur le plan de l’esthétique littéraire, comme il l’écrivit au peintre Jacques Hérold (‘Avant-propos’ de l’éditeur, p. 12). Mais il se jugeait avec les critères de son époque où la fragmentation, le mélange des genres et la composition sérielle sont encore rarissimes dans le roman français. Ce qu’il tente dans Substance 13 (y compris par défaut puisque l’œuvre l’intéresse moins que l’écriture dans l’œil du cyclone), s’inscrirait aujourd’hui assez naturellement dans le champ esthétique des écritures de montage, voire de cut-up à la Burrough (The Naked Lunch sort en 1959). Du coup, une fois révélée par le remarquable travail éditorial de François-René Simon, la construction cyclique et parfois aléatoire du récit n’est finalement pas plus déroutante pour le lecteur actuel qu’une intrigue moderne sciemment déconstruite à la Robbe-Grillet (La Reprise) ou à la Roubaud (Le grand incendie de Londres) ; et si l’on s’y perdait quelquefois (on peut aimer se perdre …), cette braise de lave ranimée par le génie du dépaysement des clichés qu’est la langue de Rodanski ramène de toute façon au vif du sujet : tellement que la brève approche du propos qui suit sera composée à partir de fragments du texte où le récit se présente en abyme, remontés et liés d’une certaine façon pour que l’on entende un peu de quoi il retourne.
Un polar narcoleptique
Il s’agit d’une histoire « où se modifient les faits en cours dans l’esprit » et « dont l’auteur n’existe pas » car le scénario en est rédigé par un comité d’inconnus (les Treize) après la projection d’un film éclairant une mentalité de tueur. C’est « une sorte de reportage narcoleptique » refondu en polar par anticipation, qui aurait été filmé par Léos Carax à l’époque où il était encore à naître, et rendant compte de faits égarés entre la Place Blanche, la rue du Dragon, la tour Saint-Jacques et les Halles, Saint-Nazaire, le Vercors de la Résistance et une fameuse station de sports d’hiver; ce qui donne un long métrage en boucles aléatoires sur la sexualité criminelle en milieux mêlés: comme dans M. le Maudit ou Jack l’éventreur, quelqu’un assassine (ou risque de le faire) dans l’absence à soi, par pulsion ou peut-être par impuissance ; et comme dans Les Trois couronnes du matelot de Ruiz, les marins ont des doubles de par le monde, qu’ils doivent tuer ou sinon les fiancer à une dame de pique qui les perdra.
Le premier rôle masculin est joué par Jacques Vaché, alias Stan, un tueur à gages spécialiste du calibre 45 et du cran d’arrêt homologué par l’armée d’Indochine : un déserteur. À son insu, le gang de l’existentialisme l’utilise, dans le cadre d’un chantage aux sentiment troubles de certains hommes pour certaines femmes, afin de rectifier une ou deux pointures d’État ; celui des surréalistes, emmené par un psychiatre sans clientèle, suit l’affaire de près au point de vue de l’humour noir. Il s’agit d’élucider là un « concours de circonstances » qui sonne comme un accord de quarte augmentée (alias triton, alias diabolus in musica) : c’est le ton be-bop des années cinquante et ça finit en sirène d’alarme car « l’époque est démentielle », Lafcadio planque son danger derrière des lunettes noires, les sombres dimanches poussent au suicide et les Tractions épousent les arbres. Si Stan n’était pas l’absent en personne, il serait la synthèse prémonitoire de Bob et Alain (pour ainsi dire fondus au pire) dans Les Tricheurs : voyez les pages sur le jeu de la vérité dans Requiem for me. La blonde Anik « aux yeux de steppe immense » est sa principale partenaire affolante quand il s’appelle Tristan, et les sorcières de la lande sont le septénaire étoilé de ses amantes saphiques, autrement dites Anges des ténèbres et belles liseuses aux jambes gainées Scandale sur les moleskines de Saint-Germain des Prés. Stan mène ce bal à la vitesse d’une 16 mm gonflée au cyanure caché dans le soutien-gorge de Flore – qui en meurt à la place d’un autre.
dans le cadre d’un chantage aux sentiment troubles de certains hommes pour certaines femmes, afin de rectifier une ou deux pointures d’État ; celui des surréalistes, emmené par un psychiatre sans clientèle, suit l’affaire de près au point de vue de l’humour noir. Il s’agit d’élucider là un « concours de circonstances » qui sonne comme un accord de quarte augmentée (alias triton, alias diabolus in musica) : c’est le ton be-bop des années cinquante et ça finit en sirène d’alarme car « l’époque est démentielle », Lafcadio planque son danger derrière des lunettes noires, les sombres dimanches poussent au suicide et les Tractions épousent les arbres. Si Stan n’était pas l’absent en personne, il serait la synthèse prémonitoire de Bob et Alain (pour ainsi dire fondus au pire) dans Les Tricheurs : voyez les pages sur le jeu de la vérité dans Requiem for me. La blonde Anik « aux yeux de steppe immense » est sa principale partenaire affolante quand il s’appelle Tristan, et les sorcières de la lande sont le septénaire étoilé de ses amantes saphiques, autrement dites Anges des ténèbres et belles liseuses aux jambes gainées Scandale sur les moleskines de Saint-Germain des Prés. Stan mène ce bal à la vitesse d’une 16 mm gonflée au cyanure caché dans le soutien-gorge de Flore – qui en meurt à la place d’un autre.
L’énigme des signes
« … quelque chose de pareil à ces cercles du purgatoire de Dante immobilisés dans un seul souvenir, et où se refont dans un centre plus étroit les actes de la vie passée. »
Gérard de Nerval, Promenades et souvenirs
Comme dans la plupart des fictions de Rodanski, l’attente de Tristan au rochers de Penmarc’h s’inscrit au détour d’une page où une rame abandonnée et une aile sanglante sur une plage bretonne sont saisis comme l’intersigne d’une élection énigmatique, éperdument scrutée en d’autres signes affleurant dans la prose de l’existence commune ; une élection au pire aussi bien, par inversion des signes ; à cet égard, Gracq a bien vu qu’il s’agit là d’ « une des aventures les plus chargées d’enjeu qui aient été poursuivies dans la lumière 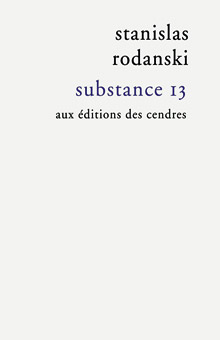 du surréalisme, une des très rares qui n’aient pas reculé devant la traversée de ses paysages dangereux et qui en aient affronté les derniers risques » (préface à La Victoire à l’ombre des ailes). En effet, si l’amour électif s’exalte comme « explosante fixe » chez Breton, il s’inscrit dans Substance 13 en étoile sanglante sur un drap d’hôtel : tel est le jeu du destin pour un héros piégé dans un nœud de faits aux allures de manipulation concertée : « quelqu’un s’était silencieusement emparé de son ombre ».
du surréalisme, une des très rares qui n’aient pas reculé devant la traversée de ses paysages dangereux et qui en aient affronté les derniers risques » (préface à La Victoire à l’ombre des ailes). En effet, si l’amour électif s’exalte comme « explosante fixe » chez Breton, il s’inscrit dans Substance 13 en étoile sanglante sur un drap d’hôtel : tel est le jeu du destin pour un héros piégé dans un nœud de faits aux allures de manipulation concertée : « quelqu’un s’était silencieusement emparé de son ombre ».
Le récit essaie d’en dénouer les fils, en déchiffrant de mémoire une partition en clef de treize, enroulée sur elle-même comme les cercles de l’enfer, et dont les portées cryptées décalquent celles des Nuits d’octobre et des Chimères : une rose de boucherie est la rose au cœur violet du sonnet d’Artémis pour signifier peut-être un meurtre sibyllin, la treizième revient en rêve pour la première envolée à l’éther quand le temps est « triste à n’en plus finir », la mort passe pour une morte parfumée Shalimar qui « se voit au passé » dans la rue, et la fin file le recommencement de quelques redites fastueuses indéfiniment modulées. Telle est la spirale éperdue d’une mémoire à perte de vue, dans une chambre sans numéro où un miroir dans un miroir dessine une silhouette mitraillée en surimpression de la Madeleine La Tour, tandis que Stan et Béatrice se rencontrent au square Saint-Jacques pour un rendez-vous du soir « chez Nicolas Flamel ».
Un rendez-vous élégamment subversif : à Paris, alors que la rumeur d’une émeute monte dans l’aube, un type vêtu d’un imperméable de cheval ou d’une veste de marin américain rôde d’un pas de rêve dans les rues, cherchant la bagarre aux bouchers des Halles ou aux dockers, en une sorte de rituel fantastique dont le scénario semble écrit d’avance pour une danse des morts post-moderne : il recherche la treizième syllabe à certain sonnet qui est la clef en double de tout ce qui manque à cette histoire pour être un roman de gare. À proximité, une fillette assez zazou graffite sa dévotion À LULU qui se souvient des oratoires et du temps des amies, sur une passerelle du temps entre Shangri-la et l’Hôtel Terminus où papillonne un sphinx auprès d’une fine sandale de daim. Sur la Place Blanche, qui est le point de fuite de toute l’affaire, quelqu’un téléphone à l’inconnu dans la nuit, alors que la neige tombe de plus en plus belle : « il semble que la durée qui emmène les êtres ait craqué quelque part ». Quant à la jeunesse « qui s’ignore dans les villes », Rodanski lui propose « l’aventure comme une morale hautaine » – tellement qu’elle s’avère à l’évidence impossible ; c’est son côté « annihiliste »:
alors que la neige tombe de plus en plus belle : « il semble que la durée qui emmène les êtres ait craqué quelque part ». Quant à la jeunesse « qui s’ignore dans les villes », Rodanski lui propose « l’aventure comme une morale hautaine » – tellement qu’elle s’avère à l’évidence impossible ; c’est son côté « annihiliste »:
« Lentement la brume était retombée et le cargo qui avait pour un instant resplendi, avec ses multiples mâts, sa coque basse et trapue, s’était évanoui où la brume s’était refermée. À peine si l’on voyait le numéro d’immatriculation du remorqueur qui se dandinait à l’entrée du port, assombrissant le cafard d’un torrent de fumée noire, il revenait pour rien au quai où Anik et Stan, appuyés à une grue, le regardaient. Le temps s’était un peu levé sur la mer, mais à nouveau la brume avait rebouché le port où de grands oiseaux blancs tombaient des nues trop hautes dessinant le noir des mâts. » (p. 101).
Dans le genre looser, Jarmusch ou Manchette n’ont sans doute jamais fait mieux (Rodanski est aussi l’auteur d’un Club des ratés de l’aventure) ; certains dialogues ont d’ailleurs l’air de sortir d’À bout de souffle ou de Pierrot le fou.
Well. Lectrice ou lecteur, voici un beau ciné-roman d’amour et de mort (ou d’amour à mort ?) pour écran déchiré ; le grand public ne le verra jamais (même si Polanski, Carax ou Lynch voulaient tenter le coup), mais possibilité t’est offerte de le projeter en ta chambre obscure, au risque (ou est-ce ta chance ?) d’y voir ta propre image te tenter au miroir.
Extrait
Très loin sur la route du retour, la voiture a percuté le rond-point. Un projecteur braqué sur le ciel n’éclaire rien. Le faisceau d’ambre dans le brouillard se meurt de solitude. La voiture a volé en éclats et s’éparpille sur le gravier qui entoure le faisceau immobile où deux silhouettes paraissent monstrueusement grandir et se confondre en une seule ombre, l’archangélique. Le château tombe en poussière et le faisceau glacé d’un coup se dissout en neige dans la nuit. Les personnages se dispersent. Anik, le cœur serré, suit ses amis. Stan s’éloigne dans l’inquiétude pour attendre l’aube du énième jour. Pâlir. Voir se lever un linge au linteau du malheur. Vider la nuit de sa substance et connaître dans l’absence le pur néant de la douleur où se dissolvent les ombres en un seul rayon : le désir étendu dans le matin hâve où le soleil fond un glaçon pour s’en aller dans la brume. Un linceul. Le temps de s’aimer en dépit du jour grâce à la pluie, décevoir l’aveu du matin en souvenir de l’altitude scintillante où volent les aigles par fragments de génie. Violence libératrice d’un meurtre, une lance au viol de la pensée perce l’angoisse par la grâce du meurtre. La solitude atteinte par le criminel, là où se figent les larmes pour iriser la lance enluminée comme les dix mois de la nuit rouge.
Stanislas Rodanski, Substance 13, p. 61
![[Chronique] Stanislas Rodanski, Substance 13, par Jean-Nicolas Clamanges](https://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/12/rodanskicahierIBackG.jpg)
![[Chronique] Stanislas Rodanski, Substance 13, par Jean-Nicolas Clamanges](https://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/12/band-RodanskiSubst.jpg)