 Suite à la parution du Jourde & Naulleau, puis de Littérature monstre, essai que nous avons présenté il y a quelques semaines après en avoir publié un chapitre entier ("Le Critique et son Double"), nous proposons en deux temps à votre esprit libre & critique ce dialogue avec Pierre Jourde : le terrain miné dans lequel évolue le critique aujourd’hui est double, jouissif lorsqu’il s’agit de la littérature monstre, celle des excès loufoques, mais dangereux dès lors qu’il concentre ces deux explosifs que sont l’académisme et l’hyperrelativisme marchand.
Suite à la parution du Jourde & Naulleau, puis de Littérature monstre, essai que nous avons présenté il y a quelques semaines après en avoir publié un chapitre entier ("Le Critique et son Double"), nous proposons en deux temps à votre esprit libre & critique ce dialogue avec Pierre Jourde : le terrain miné dans lequel évolue le critique aujourd’hui est double, jouissif lorsqu’il s’agit de la littérature monstre, celle des excès loufoques, mais dangereux dès lors qu’il concentre ces deux explosifs que sont l’académisme et l’hyperrelativisme marchand.
FT : Moi qui, depuis mon volume sur la critique (Armand Colin, 1998) et la publication, avec Francis Marcoin, du colloque inaugurant la collection "Manières de critiquer" (Artois Presses Université, 2001), m’intéresse de près à ce domaine, j’avoue que je suis impressionné par cet ouvrage qui est à la fois une somme érudite, une méditation critique et une déambulation, comique ou satirique, parmi les littératures des XIXe au XXIe siècles.
Vu qu’elle se focalise sur « le loufoque comme exercice d’épuisement » (p. 213), sur la singularité littéraire et la critique polémique, cette impressionnante somme réunit en un seul volume les centres d’intérêt de La Littérature sans estomac (2002) et de Littérature et authenticité (2001-2005)… non ?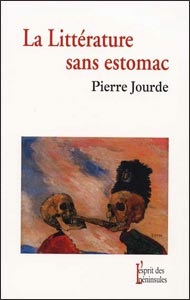
PJ : En fait, ce livre est au carrefour d’un peu tout ce que j’ai écrit en matière théorique : l’essai sur les géographies imaginaires, celui sur l’incongru à travers, en effet, la loufoquerie. On peut y ajouter les livres sur Vialatte et Huysmans, qui apparaissent dans Littérature monstre, le livre sur le double que j’ai écrit avec Paolo Tortonese, prolongé ici par une recherche sur ce thème dans la psychiatrie de la fin du XIXe siècle, et bien sûr L’Alcool du silence, qui se consacre au thème de l’esthétique décadente à la même période. Si on y trouve, dans une partie, la veine polémique de La Littérature sans estomac, c’est de manière beaucoup moins centrale. Le propos est de montrer comment, dans la perspective de la singularité, placée au cœur de la réflexion, un texte paraît fonctionner ou pas. Cela vaut pour le XIXe siècle comme pour notre temps : Francis Poictevin échoue dans sa quête de singularité comme Yannick Haenel dans la sienne. Mais, sur ce point, il s’agit principalement de réfléchir à la possibilité et à la fonction d’une critique polémique aujourd’hui.
Littérature et authenticité se situe apparemment très loin. C’est un livre théorique, plus philosophique que littéraire, qui porte sur la relation entre littérature et expérience. Contrairement à Littérature monstre, qui est plus historique et plus stylistique à la fois, je n’y examine pas de très près les textes littéraires eux-mêmes. Reste qu’en effet, il y a un point commun : l’idée que la littérature, d’une part, n’a pas pour fonction essentielle de représenter ce qui préexisterait au langage, mais de rendre possible notre expérience ; d’autre part qu’elle n’est en rien justifiée, ni juste, ni bonne a priori, ce serait même le contraire, comme le voulait Bataille, et que c’est à force de travailler la langue qu’elle peut éventuellement se tirer de son erreur originelle.
Littérature monstre n’est pas un cheminement aussi construit que Littérature et authenticité. C’est un recueil d’articles. Reste que je me suis aperçu que ces textes très divers parlaient en fait tous de la même chose, et qu’ils faisaient sens ensemble. J’ai alors rédigé quelques textes spécialement pour le livre, qui permettent de souligner le lien entre ces études parfois très détaillées.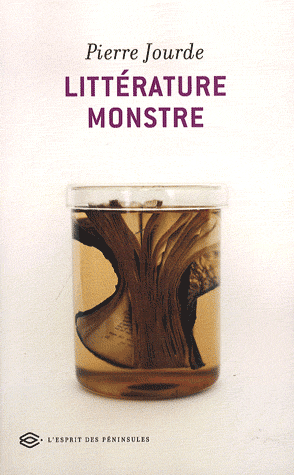
FT : Le titre de ton essai sur la modernité littéraire ne se comprend pas de la même façon selon les époques concernées : à l’excès formel des années 1880-1914 s’oppose l’excès commercial et discursif d’aujourd’hui, comme au loufoque l’esprit de sérieux…
PJ : Ce n’est pas exactement de cette façon que je prendrais la relation entre ces deux moments. En tous cas, qu’il n’y ait pas d’ambiguïté : ce livre ne consiste pas à prétendre que « c’était mieux avant », mais à essayer de montrer le lien entre les deux tournants du siècle. Notre modernité vient de là, dans presque tous ses aspects, industrialisation de la littérature, dont toutes les données sont en place dans la deuxième moitié du XIXe siècle, éclatement des formes, transgressions, autonomisation de la littérature, pullulement des micro-avant-gardes, « idiotie » littéraire, non-sens, poésie graphique, etc. L’esprit loufoque, qui naît vers 1850, avec les premières opérettes de Hervé, est parfaitement représenté aujourd’hui, chez Novarina notamment.
Ce qui est instructif, c’est à quel point la modernité a construit une petite histoire sainte dans l’oubli de ses origines. Par exemple, les « incohérents » ont inventé à peu près tout l’art moderne, ready made et monochromes compris, aux alentours de 1880. Mais ils ne sont pas intégrés à l’histoire sainte, parce qu’ils ne sont pas assez sérieux. Il faut être sérieux pour être recevable. Etre moderne, aux yeux de certains critiques d’aujourd’hui, est une exigence et une valeur. Soit. Et ils associent modernité et nouveauté. Le problème est que le brevet de modernité est bien souvent décerné par ignorance totale de ce qui existait il y a un siècle. Par bien des aspects, 1880 est plus audacieux que 2008. Et puis, la lutte y était partie intégrante de la vie littéraire. Aujourd’hui, c’est plus difficile, la critique de combat est rare, a du mal à s’imposer. Il faut être gentil. Moderne, mais institutionnel.
Les écrivains qui comptent aujourd’hui sont en grande partie ceux qui savent se colleter avec cette naissance de la modernité, construire leur identité par rapport à elle : Michon, Prigent, Novarina, Chevillard, Millet, Louis-Combet, etc. Schwob place au cœur de sa réflexion esthétique la question de la singularité. Toute son œuvre est une illustration et un dépassement du singulier. Là où il me semble y avoir problème aujourd’hui, c’est lorsque la singularité (de l’objet, de l’individu, de la culture) devient l’horizon du texte, et non le matériau avec lequel il lutte. Alors, il se conforme à l’esthétique publicitaire. Il faut relire les grands textes de Schwob sur l’anarchie, le journalisme, le naturalisme, etc., pour bien comprendre ces enjeux. Et si je m’en prends à Sollers, c’est en grande partie parce que son discours sur le XIXe siècle me paraît symptomatique d’une pensée littéraire faussée, d’une modernité factice.
FT : Le titre de ton « Avant-propos », « La Forme et le Feu », qui rend compte d’une conception de l’écriture comme tension entre formel et spirituel, création et imagination, travail et inspiration, vaut également pour tes propres écrits, non ? Car, dans tes essais comme tes récits, on est frappé par le contraste entre le caractère baroque des sujets comme des motifs et le classicisme de la forme…
PJ : J’écris (en matière de fiction et de poésie s’entend) dans une tension permanente entre architecture et abandon. Selon les textes, l’un ou l’autre domine. Festins secrets ou L’Heure et l’ombre sont des textes millimétrés. Dans mon chien ou La Cantatrice avariée ont été écrits, par moments, dans un état de semi-délire. Le « classicisme de la forme » me pose problème. Je l’ai déjà entendu comme un reproche, même si c’est un aimable reproche. Je ne suis pas très à l’aise avec cette question, étant donné que mon idéal serait plutôt le « livre sur rien » flaubertien, qui tient « par la seule force du style ». Et, comme tu décris les choses, j’ai bien conscience que, peut-être, je fais l’inverse. Je me demande donc toujours si je ne suis pas « trop classique ». Possible. Mais il y a encore des ressources dans la langue classique, des rythmes intéressants à exploiter. J’écris musicalement, et souvent pour la voix, je m’en suis rendu compte. Si classicisme il y a, cela ne concerne, à mon sens, que le niveau syntaxique, et, à un degré moindre, lexical. Ma langue, en apparence, est en effet relativement normée. A quelques détails près. Dans certains récits, le parler populaire s’immisce. Je ne peux pas employer le passé simple et le subjonctif imparfait, qui me paraissent des formes désuètes, trop marquées littérairement, sinon à des doses très mesurées, ici et là. Il y a une dimension légèrement parodique dans ce classicisme, notamment dans Festins secrets et Dans mon chien. Mais précisément, le regard de la critique semble s’arrêter au plus voyant : lexique, syntaxe, ponctuation. Peut-être parce que nous sommes scolairement formés à ces seules dimensions de l’écriture. Note, à ce sujet, que Pierre Michon a écrit quelques courts récits, dans une langue qui est presque un pastiche de celle du XVIIe siècle, et qu’ils ont, à mon sens, révolutionné le récit contemporain. On pourrait aussi évoquer le classicisme, très différent, de Ndiaye, Rouaud ou Echenoz. Et Littell, à qui Bourmeau fait le reproche d’être un écrivain désuet ! 
Ce qui n’est pas classique, en revanche, dans mes récits, c’est le système d’énonciation, qui en fait des intrications de discours. On retrouve là un caractère assez constant de la modernité (Des Forêts, Beckett…). En outre, ce sont presque toujours des discours piégés. Tout ramène à un « qui parle ? » qui à la fois détient le sens du texte et ne trouve pas de réponse satisfaisante. Même chose pour la temporalité et l’architecture narrative. En écrivant L’Heure et l’ombre, j’ai voulu me démontrer à moi-même l’hypothèse d’un caractère poétique en soi du seul agencement narratif et temporel dans un roman. Un exemple encore assez particulier : mon premier roman publié, Carnage de clowns, à part le premier et le dernier chapitre, obéit à une sorte de contrainte oulipienne. C’est un roman à la première personne sans aucun je. (Devinette : comment fait-on ?) Pour en revenir au plan lexico-syntaxique, je suis à la recherche, en ce moment, d’un mode personnel d’accord entre langue populaire et langue écrite classique. J’ai fait des tentatives en ce sens, assez limitées encore, dans la première partie du Maréchal absolu, que tu as publiée. De ce point de vue, la langue de Jean-Yves Cendrey est pour moi un idéal de saveur et d’efficacité.
FT : Il serait sans doute préférable de parler de tension entre invention baroque (sujets loufoques, excès de langue) et style classique (système d’adjectivation, art descriptif, rhétorique de la justesse d’expression)… Au reste, comme tu le sais au premier chef, j’ai eu l’occasion d’insister sur l’ingéniosité narrative de Festins secrets ou l’inventivité carnavalesque de La Cantatrice avariée – sans oublier qu’une de mes étudiantes de 3e année en Arts du spectacle est en train de mettre en scène (en voix) le chapitre inédit du Maréchal absolu que j’ai publié sur LIBR-CRITIQUE.
Ce qui frappe également les lecteurs qui te connaissent un tant soit peu, c’est que ton propos semble beaucoup plus pessimiste qu’à l’accoutumée, toi qui places ta réflexion d’ensemble à l’enseigne d’une citation d’Agamben qui peut sembler désillusionnée : « Une culture qui a perdu, avec sa transmissibilité, l’unique garante de sa vérité et se trouve menacée par l’incessante accumulation de son propre non-sens, confie alors à l’art sa propre garantie : et l’art se trouve ainsi dans la nécessité de garantir ce qui ne peut être garanti qu’à condition qu’il perde lui-même à son tour ses propres garanties » (L’Homme sans contenu)…
PJ : Franchement non, pas de pessimisme sur la littérature. En ce qui concerne la culture de masse, oui, parce qu’on est en train de perdre ce qui me paraît au fond le plus important, un véritable art populaire. Mais il s’agit avant tout de réaffirmer le caractère essentiel de l’art dans la société. L’Homme sans contenu d’Agamben (1996) est un ouvrage important de ce point de vue, et pas si désillusionné. La citation provient de la fin du livre, où Agamben assigne à l’esthétique la tâche (énorme) de se substituer à la tradition, de résoudre « ce conflit entre ancien et nouveau sans la réconciliation desquels l’homme, cet être qui s’est perdu dans le temps et doit s’y retrouver […] est incapable de vivre ». Or, l’art moderne, pour Agamben, doit assumer cette tâche dans l’intransmissibilité qui le caractérise, comme pur lieu de conflit, dans la seule dimension esthétique. Je ne le suis pas jusque là, et j’interprète à ma façon la « perte des garanties » : pas de valeur préexistante ne signifie pas aucune valeur. Je bricole Agamben avec Proust : l’art fait le vide. Ce vide est la condition d’une possible recomposition. C’est le jeu dans la machine. Il oppose aux significations toutes faites et aux langages préfabriqués la possibilité, pour le réel, de se produire.
FT : Oui, comme d’autres, Agamben – qui fait partie de notre horizon à tous deux – en est réduit à jouer au "Qui perd gagne", gageant sur la mise en crise de l’art pour que ce dernier redevienne une valeur vitale. À toi, comme à tout acteur du champ intellectuel, il nous faut tenter ce pari…
![[Entretien] De la critique en terrain miné. Dialogue avec Pierre Jourde](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)
monsieur jourde
j’aimerais savoir ce que vous pensez de « retour et définitif de l’etre aimé », par olivier cadiot., livre encensé par toute la critique parisienne.
cordialement
denis hamel
Je suppose que si vous dites « encensé par toute la critique parisienne », cela signifie que vous n’aimez pas ça du tout. Bon, je n’ai pas la place d’argumenter sérieusement, mais voilà, j’avoue, oui, j’encense itou, j’aime bien ce que fait Cadiot, cette théâtralité de son écriture, cet humour très particulier. Et j’y ajoute la poésie de son complice Pierre Alféri. « Retour durable et définitf de l’être aimé », je ne l’ai pas lu, je l’ai vu monté sur je ne sais plus quelle scène, et c’était vraiment séduisant, drôle, aérien. Maintenant, je comprends qu’on n’accroche pas. C’est typiquement le genre de texte qui peut vous laisser à la porte.
Pierre Jourde
Un beau moment de joie et d’humour…