Dernière mise à jour pour le moment, un article qui, publié en 2006, n’était plus du tout disponible sur Libr-critique : il s’agit d’une réflexion sur l’opposition entre moderne et antimoderne – qui se subdivise entre antimodernisme conservateur et antimodernisme progressiste.
Mais comment peut-on encore être moderne ?, telle est la question que ne cessent de marteler depuis un quart de siècle tous ceux qui sont demeurés étrangers aux avant-gardes des années 60-70 ou qui ont pris leurs distances par rapport aux derniers avatars de la modernité. Dès 1981, dans Le Ruban au cou d’Olympia, le déjà classique Michel Leiris stigmatisait la « merdonité », cette dérive spectaculaire qui, suivant l’irrésistible flux capitaliste, tend à confondre modernité et actualité : « Notion stimulante mais caduque […], la modernité […] n’a-t-elle pas, camouflet à son nom même, cessé d’être moderne ? » (Gallimard, p. 248). Débutait une ère souvent qualifiée de « postmoderne », où l’on ne se contentait pas de dénoncer la dégradation de la modernité en modernisme — cette quête effrénée de la nouveauté —, ou encore les excès formalistes (purisme) et idéologiques (activisme révolutionnaire) : l’heure de la revanche sonnait pour tous les naufragés de la vague textualiste, qui s’empressaient de sonner l’hallali des avant-gardes pour claironner le retour à des valeurs sûres.
L’antimodernisme conservateur
A l’écart des polémiques qu’au sein de ce qu’on appelle « la vie littéraire » entretiennent les intellectuels médiatiques et des revues comme Esprit ou Le Débat, l’université n’est pas en reste, en la personne d’un de ses plus illustres représentants, Antoine Compagnon, professeur de notoriété internationale qui enseigne et à la toujours prestigieuse Sorbonne (Paris IV) et à l’Université Colombia de New York. Peu après Les Modernes (1984) de Jean-Paul Aron, mais sans tremper sa plume dans la même encre satirique, cet ancien  disciple de Barthes entreprend de commencer un bilan qui s’apparente à une liquidation. Les Cinq Paradoxes de la modernité (Seuil, 1990), tout d’abord, mettent en relief les apories d’une modernité avant-gardiste dont l’éthique et l’esthétique de la rupture aboutissent au formalisme stérile et au progressisme illusoire, à la fétichisation du nouveau et de la théorie. « Le démon de la théorie » est précisément celui qui s’empare de ceux que l’on pourrait nommer les « terroriciens » si l’on voulait employer un mot-valise offrant un clin d’œil au Paulhan des Fleurs de Tarbes : dans leur lutte sans merci contre le sens commun, « ils soutiennent des paradoxes, comme la mort de l’auteur, ou l’indifférence de la littérature au réel », de sorte qu’ils échouent à débarrasser les études littéraires de la doxa (Le Démon de la théorie. Littérature et sens commun, Seuil, 1998, pp. 277-278). Avec beaucoup d’érudition et un art subtil de la nuance, l’historien de la littérature procède ainsi à une démythification de la théorie qui le conduit au constat d’échec des « Vingt Glorieuses » avant-gardistes. Pour légitime et salutaire que soit cette démarche, elle doit néanmoins être jugée à l’aune de ses conclusions : une suite d’apories ressortissant à une logique consensuelle de l’entre-deux. La justification qu’en donne l’auteur doit se lire conformément à la ligne directrice de l’ouvrage, à savoir le triomphe du sens commun : « L’aporie qui termine chaque chapitre n’a donc rien d’accablant : ni la solution du sens commun ni celle de la théorie n’est bonne, ou bonne toute seule. On peut les renvoyer dos à dos, mais elles ne s’annulent pas l’une l’autre, car il y a du vrai de chaque côté » (p. 281). Les meilleurs exemples de cette pensée molle se trouvent à la fin du chapitre sur le style, où l’on apprend que « le style existe bel et bien » (p. 208), et de celui sur l’auteur : « la présomption d’intentionnalité reste au principe des études littéraires […], mais la thèse anti-intentionnelle, même si elle est illusoire, met légitimement en garde contre les excès de la contextualisation historique et biographique » (pp. 98-99).
disciple de Barthes entreprend de commencer un bilan qui s’apparente à une liquidation. Les Cinq Paradoxes de la modernité (Seuil, 1990), tout d’abord, mettent en relief les apories d’une modernité avant-gardiste dont l’éthique et l’esthétique de la rupture aboutissent au formalisme stérile et au progressisme illusoire, à la fétichisation du nouveau et de la théorie. « Le démon de la théorie » est précisément celui qui s’empare de ceux que l’on pourrait nommer les « terroriciens » si l’on voulait employer un mot-valise offrant un clin d’œil au Paulhan des Fleurs de Tarbes : dans leur lutte sans merci contre le sens commun, « ils soutiennent des paradoxes, comme la mort de l’auteur, ou l’indifférence de la littérature au réel », de sorte qu’ils échouent à débarrasser les études littéraires de la doxa (Le Démon de la théorie. Littérature et sens commun, Seuil, 1998, pp. 277-278). Avec beaucoup d’érudition et un art subtil de la nuance, l’historien de la littérature procède ainsi à une démythification de la théorie qui le conduit au constat d’échec des « Vingt Glorieuses » avant-gardistes. Pour légitime et salutaire que soit cette démarche, elle doit néanmoins être jugée à l’aune de ses conclusions : une suite d’apories ressortissant à une logique consensuelle de l’entre-deux. La justification qu’en donne l’auteur doit se lire conformément à la ligne directrice de l’ouvrage, à savoir le triomphe du sens commun : « L’aporie qui termine chaque chapitre n’a donc rien d’accablant : ni la solution du sens commun ni celle de la théorie n’est bonne, ou bonne toute seule. On peut les renvoyer dos à dos, mais elles ne s’annulent pas l’une l’autre, car il y a du vrai de chaque côté » (p. 281). Les meilleurs exemples de cette pensée molle se trouvent à la fin du chapitre sur le style, où l’on apprend que « le style existe bel et bien » (p. 208), et de celui sur l’auteur : « la présomption d’intentionnalité reste au principe des études littéraires […], mais la thèse anti-intentionnelle, même si elle est illusoire, met légitimement en garde contre les excès de la contextualisation historique et biographique » (pp. 98-99).
En fait, malgré la posture d’épistémologue modéré qu’adopte Antoine Compagnon, corrélative d’une position de surplomb (se différenciant de la théorie littéraire, sa théorie de la littérature se pose comme une critique de la critique, un archidiscours déontologique chargé d’évaluer la recherche littéraire avec scepticisme et relativisme), on peut se demander si, dans sa conclusion générale, il ne nous livre pas lui-même l’explication de son engagement critique : « L’attitude des littéraires devant la théorie rappelle la doctrine de la double vérité dans la théologie catholique. Chez ses adeptes, la théorie est en même temps l’objet d’une foi et d’un désaveu : on y croit, mais on ne va quand même pas faire comme si on y croyait tout à fait » (p. 278). Témoigne sans doute encore de cette projection l’illustration supplémentaire qu’il donne de cette attitude dans Les Antimodernes (Gallimard, 2005), manifestant à cette occasion une incomparable ingéniosité de casuiste : « En théorie, Barthes défend des idées modernes ou même d’avant-garde, mais en pratique il ruse avec ses idées […] » (p. 418). De même, la formule paradoxale de Barthes qu’il cite — « être d’avant-garde, c’est savoir ce qui est mort ; être d’arrière-garde, c’est l’aimer encore » (p. 433) — n’éclaire-t-elle pas sa propre position ? Se reconnaître dans l’antimodernisme tel qu’il le définit, c’est-à-dire « l’arrière-garde de l’avant-garde », n’est-ce pas se repositionner en fonction de sa situation universitaire ? Sinon, comment comprendre une telle réactualisation de la Querelle entre Anciens et Modernes, ou plutôt cette parade triomphale de néo-Anciens ou Modernes traditionalistes dans un paysage littéraire d’après la bataille — ciel de traîne après la perturbation —, cette tentative pour réhabiliter les «réactionnaires de charme » (p. 448) et faire des antimodernes « les vrais modernes, non dupes du moderne, déniaisés » (p. 8), « des modernes en liberté » (p. 14), des consciences critiques qui ont « été les véritables fondateurs de la modernité et ses représentants les plus éminents » (p. 19) ? La parenthèse théoriciste (terroriciste ?) achevée, il s’agit désormais de remettre à l’honneur certaines notions (« l’auteur », « le monde », « le style »…), des figures mises au rebut par les récentes avant-gardes (Benda, Paulhan, Gracq…), des valeurs comme le respect de la tradition, le goût du sublime, ou encore l’amour de la langue, sans oublier la discipline reine de la Sorbonne que constitue l’histoire littéraire — dont l’auteur de La Troisième République des lettres (Seuil, 1983) redore le blason au travers de l’hommage rendu au « grand patron des études littéraires en France » (Lanson)i, et qui, apanage des savants, reste (redevient) pour lui le fondement de la recherche universitaire1. Ainsi la stratégie démonstrative à l’œuvre des Cinq Paradoxes de la modernité aux Antimodernes, en passant par Le Démon de la théorie, peut-elle se condenser en cette formule : dater les Modernes qui ont voulu faire date et exhumer les « inactuels ».
Dans cette perspective, Antoine Compagnon dresse un portrait tout en nuance et en profondeur des antimodernes : loin d’être de simples réactionnaires ou conservateurs traditionnels, ce sont des êtres politiquement, éthiquement et esthétiquement ambivalents — « modernes déchirés », « modernes intempestifs » (p. 7), « modernes vus de dos » (p. 441), terriblement sublimes, « à la droite de la gauche comme à l’arrière-garde de l’avant-garde » (p. 445)… Et puisque ces inactuels sont plus actuels et plus modernes que les plus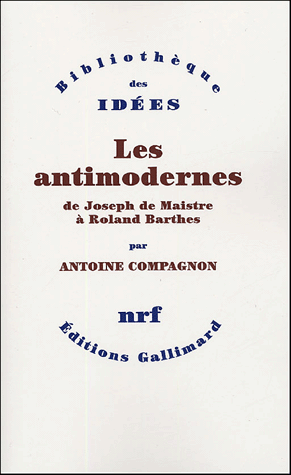 modernes des contemporains, il convient de substituer aux appellations péjoratives celles de Paulhan et de Barthes : mainteneurs, conservatifs ou réactifs, au lieu de conservateurs ou réactionnaires… Cette logique du retournement paradoxal prévaut jusque dans la définition qui inaugure la première partie (« Les Idées ») : « l’antimodernité entendue non comme néo-classicisme, académisme, conservatisme ou traditionalisme, mais comme la résistance et l’ambivalence des véritables modernes » (p. 17). Rien d’étonnant, donc, à ce que la section consacrée à la cinquième composante antimoderne procède à un détournement de Kant, pris en tenaille entre Emerson et Burke, « premier théoricien de la contre-révolution » (p. 111) : ignorant la relecture qu’opère Lyotard de la Critique du jugement esthétique dans Le Postmoderne expliqué aux enfants, à savoir que « c’est dans l’esthétique du sublime que l’art moderne (y compris la littérature) trouve son ressort, et la logique des avant-gardes ses axiomes » (Le Livre de Poche, 1988, p. 20), Antoine Compagnon fait du sublime une caractéristique de l’antimodernisme sous prétexte que, même chez Kant, la terreur — « l’émotion sublime par excellence » pour Burke (p. 111) — fait toujours partie intégrante de cette catégorie. Or, l’esthétique antimoderne se rattache au beau, et non au sublime, dans la mesure où elle se détermine, entre autres traits distinctifs, par le fini, le continu et la terreur, et non par l’infini, le discontinu et l’horrible (qu’on se rappelle l’aphorisme de Jarry au principe d’un art de l’informe : « J’appelle monstre toute originale inépuisable beauté »ii).
modernes des contemporains, il convient de substituer aux appellations péjoratives celles de Paulhan et de Barthes : mainteneurs, conservatifs ou réactifs, au lieu de conservateurs ou réactionnaires… Cette logique du retournement paradoxal prévaut jusque dans la définition qui inaugure la première partie (« Les Idées ») : « l’antimodernité entendue non comme néo-classicisme, académisme, conservatisme ou traditionalisme, mais comme la résistance et l’ambivalence des véritables modernes » (p. 17). Rien d’étonnant, donc, à ce que la section consacrée à la cinquième composante antimoderne procède à un détournement de Kant, pris en tenaille entre Emerson et Burke, « premier théoricien de la contre-révolution » (p. 111) : ignorant la relecture qu’opère Lyotard de la Critique du jugement esthétique dans Le Postmoderne expliqué aux enfants, à savoir que « c’est dans l’esthétique du sublime que l’art moderne (y compris la littérature) trouve son ressort, et la logique des avant-gardes ses axiomes » (Le Livre de Poche, 1988, p. 20), Antoine Compagnon fait du sublime une caractéristique de l’antimodernisme sous prétexte que, même chez Kant, la terreur — « l’émotion sublime par excellence » pour Burke (p. 111) — fait toujours partie intégrante de cette catégorie. Or, l’esthétique antimoderne se rattache au beau, et non au sublime, dans la mesure où elle se détermine, entre autres traits distinctifs, par le fini, le continu et la terreur, et non par l’infini, le discontinu et l’horrible (qu’on se rappelle l’aphorisme de Jarry au principe d’un art de l’informe : « J’appelle monstre toute originale inépuisable beauté »ii).
La tentative d’annexion de ces trois hérauts de la modernité que sont Flaubert, Baudelaire et Barthes n’a rien de surprenant non plus : à ce stade, on ne saurait craindre d’avancer que nous avons bel et bien affaire à une subversion du moderne par amalgame. Comment peut-on en effet ranger sous la même bannière de Maistre ou Bloy et Baudelaire ou Flaubert, dont Bourdieu a montré le rôle prépondérant dans l’invention de la modernité, le premier en imposant un nouveau nomos (l’autonomie artistique) et le second en révolutionnant le roman par la subordination du sujet à la forme ? Comment mêler des écrivains politiquement conservateurs et esthétiquement traditionalistes (Barbey d’Aurevilly, Bloy, Bourget, Barrès…) à d’autres plus novateurs et progressistes (Breton, Bataille, Barthes… — pour rester dans la liste des noms commençant par la deuxième lettre de l’alphabet) ? Comment mettre sur le même plan Gracq et Barthes : si tous deux ont pratiqué l’écriture fragmentaire et sont philologues, au sens d’amoureux de la langue, est-ce de la même langue qu’il s’agit ? A celui dont l’écriture préférentielle s’ancre dans un XIXe siècle qui s’achève avec Proust, la verve satirique, le beau style, la finitude rhétorique et le purisme linguistique ; au maître du structuralisme, au sémiologue, au fervent défenseur des avant-gardes, à l’écrivain jouisseur du texte, le ludisme, la langue absconse, l’infinitude vertigineuse de l’espace scriptural… A l’évidence, pour réussir à intégrer ces deux figures antithétiques dans la catégorie fourre-tout des antimodernes, il a fallu tirer le plus moderne vers le classicisme et le plus classique vers le surréalisme… Au problème de l’aplanissement — lequel est poussé jusqu’à la provocation dans l’affirmation finale : « L’antimoderne est le neutre où Barthes rejoint de Maistre » (p. 448) — s’ajoute celui de la survalorisation : est-il légitime de réduire au même deux auteurs qui n’ont pas joué un rôle égal dans l’histoire de la littérature contemporaine ? Plus généralement, la notion d’antimodernisme est trop équivoque et trop large, d’autant plus floue que manque une étude contextuelle des conditions dans lesquelles, pour chaque état du champ, s’effectue le rejet d’une modernité particulière. La volonté de réévaluer une vague tendance idéologico-esthétique ne pouvait qu’aboutir à une double erreur de perspective, historique et méthodologique : l’hyperfocalisation (ou effet de zoom) rend à ce point aveugle qu’on en vient à décréter que la quasi-totalité de la littérature post-révolutionnaire est antimoderne… (Et que faire des Stendhal, Hugo, Zola, Jarry, Breton, Bataille, Malraux, Queneau, Sartre, Beckett, Genet, Ionesco, Camus, Simon, Duras, Butor, Perec, Guyotat, Novarina ou Prigent, pour ne citer que quelques représentants majeurs de la modernité ?). Rendons cependant à Antoine Compagnon ce qui lui appartient : une hyperlucidité qui lui fait reconnaître à la première page de sa conclusion que sans doute « trop d’antimoderne tue l’antimoderne » (p. 441).
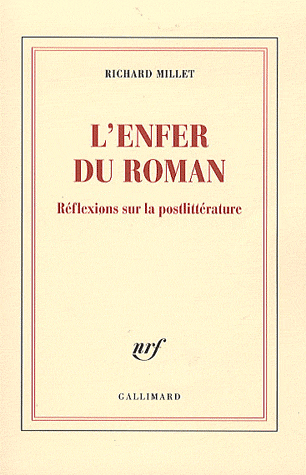 Se positionnera parmi les Antimodernes que décrit Antoine Compagnon l’auteur de L’Enfer du roman. Réflexions sur la postlittérature : la postlittérature, c’est la disparition de la littérature dans un univers sans autorité ni valeurs, où triomphent la haine de la langue, le ludisme et le politiquement correct. Et Richard Millet de préférer la civilisation qui favorise la ferveur du sens, le vertical à l’horizontal, le singularisme à l’universalisme et les anti-Lumières au progressisme laïc : fustigeant un Nouvel Ordre Moral qui, pour lui, englobe le « révisionnisme littéraire », les Droits de l’Homme comme les minorités ethniques, religieuses et sexuelles, il se pose comme adepte d’une esthétique normative et d’une langue hypostasiée, se range du côté de la spiritualité chrétienne, de l’aristocratisme, de la vérité auctoriale, de l’œuvre, du style et de la métaphore.
Se positionnera parmi les Antimodernes que décrit Antoine Compagnon l’auteur de L’Enfer du roman. Réflexions sur la postlittérature : la postlittérature, c’est la disparition de la littérature dans un univers sans autorité ni valeurs, où triomphent la haine de la langue, le ludisme et le politiquement correct. Et Richard Millet de préférer la civilisation qui favorise la ferveur du sens, le vertical à l’horizontal, le singularisme à l’universalisme et les anti-Lumières au progressisme laïc : fustigeant un Nouvel Ordre Moral qui, pour lui, englobe le « révisionnisme littéraire », les Droits de l’Homme comme les minorités ethniques, religieuses et sexuelles, il se pose comme adepte d’une esthétique normative et d’une langue hypostasiée, se range du côté de la spiritualité chrétienne, de l’aristocratisme, de la vérité auctoriale, de l’œuvre, du style et de la métaphore.
L’antimodernisme novateur
Si, à la fin de la même année 2005, dans Dada et les arts rebelles (Editions Hazan), Gérard Durozoi se détermine également par rapport à l’idéologie moderniste, il ne propose pas pour autant la même définition de l’antimodernité : selon lui, il s’agit d’une résistance novatrice à la « surenchère formelle » (p. 8) qui a fait dériver les Modernes jusqu’à la « post-modernité ». Non que le critique d’art ne soit pas conscient des questions que l’on peut légitimement se poser face à toutes les avant-gardes : « Quelle portée attribuer à une contestation qui, tout en se prétendant radicale et définitive, doit périodiquement resurgir ? Cette crispation sur la négativité, cette réactivation des démarches agressives contre le goût et l’art tel qu’il continue à être admis, ces indifférences multiplement répétées à l’égard de l’avenir comme du passé, n’indiquent-elles pas amplement leur vanité ? Quelle confiance accorder à des mouvements qui déprécient au lieu d’exalter, et qui semblent piétiner rageusement, mais de manière impuissante ? » (p. 11). Mais, se penchant sur « l’horizon mental » constitutif de notre contemporanéité, il en vient à une conception clivée de l’avant-gardisme pour appréhender un fait artistique et philosophique majeur : la critique des excès esthétiques et idéologiques qu’en un siècle ont perpétrés les avant-gardes modernistes par des « avant-gardes rebelles » qui, de Dada au lettrisme et au situationnisme, en passant par le surréalisme, Cobra, Fluxus ou l’actionnisme viennois, se sont souvent révélées tout aussi virulentes et subversives, mais pas de la même façon.
Sans vouloir dresser un parallèle systématique entre deux ouvrages très différents, un essai original et un vade-mecum qui, appartenant à la collection « Guide des arts », contient de courts articles classés par ordre alphabétique dans trois parties (« Techniques et concepts communs », « Mouvements » et « Artistes »), concentrons-nous sur les deux séries d’antinomies qui s’en dégagent. La première confronte à une modernité remontant aux Lumières une antimodernité conservatrice : Contre-Révolution, Anti-Lumières versus Révolution, Lumières ; antidémocratisme, antirationalisme humaniste, voire idéaliste vs rationalisme matérialiste, antihumanisme ; conservatisme (poids du passé et de la tradition) vs progressisme (priorité à l’avenir et à l’innovation) ; « théologie du péché originel » (p. 88), « vérité éternelle de la Chute » (p. 90) vs « métaphysique moderne du progrès », « hubris sacrilège des modernes » (pp. 88 et 90) ; pessimisme individualiste et mélancolique vs optimisme réformiste ; vitupération des « prophètes du passé » vs lyrisme messianique ; imprécation vs ludisme ; philologie, purisme linguistique vs misologie, purisme formel ; scepticisme, indépendance, ambivalence vs arrogance, radicalisme, activisme politique…
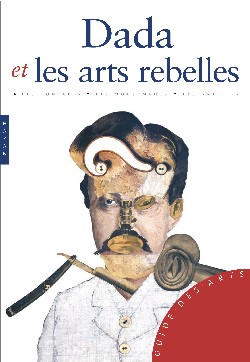 La seconde oppose « les avant-gardes rebelles » (antimodernité novatrice) aux avant-gardes modernistes : tabula rasa de toutes les valeurs libérales, de toute tradition, de tout goût officiel, « déterminé davantage par la rumeur et la marchandise que par l’expérience des œuvres » (p. 67) vs rationalisme utilitariste, société de consommation et de communication ; exploitation des forces dynamiques actuelles (« utopie inverse de celles des Modernes », p. 10) vs conception téléologique de l’Histoire, foi en l’avenir ; désengagement vs engagement politique ; créations collectives et éphémères, artiste comme « "monteur" ou organisateur de l’expérience sensible » (p. 10) vs mythologie du créateur et de ses œuvres éternelles ; amateurisme vs esprit de sérieux ; activité du public (cf. happenings) vs passivité ; prédilection pour le chaos, l’informe, les forces irrationnelles, l’automatisme vs prédominance de l’ordre rationnel, la maîtrise de la forme ; promotion du « bricolage ludique » (p. 18), de formes « impures » telles que le ready-made, le photomontage et le collage, qui « conteste radicalement l’opposition entre matériau réputé artistique et déchet banal » et qui, « détruisant l’image homogène, […] découvre une esthétique de l’hétérogène et du contradictoire » (p. 34) vs purisme formel, homogénéité, noblesse des matériaux…
La seconde oppose « les avant-gardes rebelles » (antimodernité novatrice) aux avant-gardes modernistes : tabula rasa de toutes les valeurs libérales, de toute tradition, de tout goût officiel, « déterminé davantage par la rumeur et la marchandise que par l’expérience des œuvres » (p. 67) vs rationalisme utilitariste, société de consommation et de communication ; exploitation des forces dynamiques actuelles (« utopie inverse de celles des Modernes », p. 10) vs conception téléologique de l’Histoire, foi en l’avenir ; désengagement vs engagement politique ; créations collectives et éphémères, artiste comme « "monteur" ou organisateur de l’expérience sensible » (p. 10) vs mythologie du créateur et de ses œuvres éternelles ; amateurisme vs esprit de sérieux ; activité du public (cf. happenings) vs passivité ; prédilection pour le chaos, l’informe, les forces irrationnelles, l’automatisme vs prédominance de l’ordre rationnel, la maîtrise de la forme ; promotion du « bricolage ludique » (p. 18), de formes « impures » telles que le ready-made, le photomontage et le collage, qui « conteste radicalement l’opposition entre matériau réputé artistique et déchet banal » et qui, « détruisant l’image homogène, […] découvre une esthétique de l’hétérogène et du contradictoire » (p. 34) vs purisme formel, homogénéité, noblesse des matériaux…
Malgré leurs profondes divergences, les deux livres ont comme point commun tout à fait significatif d’assimiler la modernité aux modèles canoniques de l’avant-gardisme — qui, selon Jean Clair, n’est pourtant qu’une « idée clivée de la modernité »iii. Or, de Gide à Desportes, en passant par Proust, Céline, Michaux, Sartre, Camus, la surréflexion (Bonnefoy, Du Bouchet, Dupin, Jaccottet…), Ernaux, ou encore Koltès, nombreux sont les mouvements et les écrivains novateurs et progressistes à avoir résisté au terrorisme groupusculaire, à l’éthique et l’esthétique de la tabula rasa, au lyrisme prophétique, au radicalisme théorico-politique et, plus généralement, aux excès en tous genres (hyperformalisme, libération de l’inconscient, exploration de l’informe, expérimentation des formes hétérogènes les plus extrêmes…).
Faut-il être absolument moderne ?
Les deux concepts les plus marquants depuis un quart de siècle, ceux de « postmoderne » et d’« antimoderne », révèlent la volonté d’échapper à un certain académisme moderniste. Car si la question s’est posée de savoir s’il faut être absolument moderne, c’est que bien évidemment le paradigme moderniste était devenu une norme. Ce que ne manque pas de souligner Henri Meschonnic, dans Célébration de la poésie par exemple : « […] "la tradition des avant-gardes", tradition de la provocation. L’ennui est justement que c’est déjà aussi une tradition » ; « Le comble […], c’est de se croire moderne parce qu’on fait du bruit dans le contemporain » (Verdier, 2001, pp. 93 et 203). D’où certaines tentatives pour émanciper le contemporain du moderne. C’est le cas de Dominique Fourcade, qui, après avoir posé dans Outrance Utterance et autres élégies la « non-identité du contemporain au moderne » (P.O.L, 1990, p. 12), affirme dans un entretien avec Henri Bauer : « Il me semble que le moderne a été réalisé […]. Il n’y a donc surtout pas, surtout plus, à être absolument ni résolument moderne. Mais il serait beau d’être contemporain, il serait beau et juste de l’être, selon une forme à inventer dans la mesure même où le contemporain, qui est une nuit, s’invente » (Java, n° 17, été-automne 1998, pp. 67-68). Le problème est que le contemporain se confond le plus souvent avec l’actuel, c’est-à-dire la totalité éclectique de ce qui est en vue dans le champ, le fourre-tout anomique de la littérature au présent qu’imposent aussi bien l’univers éditorial ou journalistique que les panoramas universitaires. Reste la notion d’« extrême contemporain », forgée par un collectif prestigieux (M. Chaillou, J. Deguy, D. Fourcade et J. Roubaud) lors d’un colloque en 1986 dont les actes furent publiés l’année suivante dans la revue Po&sie, peu avant que naquît la collection du même nom chez le même éditeur (Belin)… Mais elle est déjà datée, du fait qu’elle constitue un label — qui, en outre, recouvre une entreprise essentiellement patrimoniale.
En définitive, toutes ces critiques de la modernité au profit de la contemporanéité, de l’anti- ou de la post-modernité, oublient que le moderne, qu’il soit ou non d’avant-garde, se définit précisément par une posture critique qui implique une constante remise en question,
Indépendamment de tout parti pris, il convient de faire obstacle à ce « démon de la théorie » qui pousse universitaires, écrivains et essayistes à subsumer les pratiques particulières sous de trop vastes et vides appellations — à ce travers qui trouve une explication dans une loi plus ou moins implicite du champ littéraire français, selon laquelle il n’est de position visible sans discours généralisant. Plutôt que de tomber dans l’hypostase, il est préférable d’analyser rigoureusement des postures singulières qui, à chaque état du champ, contribuent à enrichir notre appréhension du monde (et) de la littérature et/ou renouvellent des motifs ou des formes spécifiques.
i Cf. Antoine Compagnon, La Troisième République des lettres, Seuil, 1983, p. 59, et Le Démon de la théorie, Seuil, 1998, p. 20.
ii Alfred Jarry, L’Ymagier, n°2, janvier 1895 ; repris dans Œuvres complètes (édition de Michel Arrivé), Gallimard, « La Pléiade », t. I, 1972, p. 972.
iii Cf. Jean Clair, La Responsabilité de l’artiste. Les avant-gardes entre terreur et raison, Gallimard, 1997. Pour avoir participé depuis un quart de siècle à toutes les polémiques sur « la crise de l’art contemporain » et publié de virulents essais (Considérations sur l’état des Beaux-Arts. Critique de la modernité, Gallimard, 1983 ; De la modernité considérée comme une religion, L’Echoppe, 1988…), le critique d’art reconnu qui a dirigé le Musée Picasso (Paris) de 1989 à 2005 est perçu comme un antimoderne (au sens négatif de contempteur de la modernité).
iv Voir, respectivement, Christian Prigent, L’Incontenable, P.O.L, 2004, pp. 89 et 106 ; Ceux qui merdRent, P.O.L, 1991, p. 28 ; A quoi bon encore des poètes ?, P.O.L, 1996, p. 10 ; Salut les modernes, P.O.L, 2000, p. 29.
![[Libr-retour] Des modernes et des antimodernes](https://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2014/09/MelancholiaHugoBackG.jpg)
![[Libr-retour] Des modernes et des antimodernes](https://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2014/09/band-melancholiaHugo.jpg)