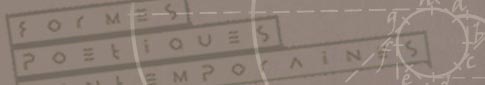 Présentation de Formes Poétiques Contemporaines (FPC)
Présentation de Formes Poétiques Contemporaines (FPC)
[Voir le site : http://www.chamontin.nom.fr/fpc/]
Un titre programmatique
Formes Poétiques Contemporaines est beaucoup plus une revue sur la poésie qu’une revue de poésie. Elle a été créée en 2003 par un groupe de poètes et de chercheurs dont certains font aussi partie de Formules, revue des littératures à contraintes (publication annuelle existant depuis 1997). Ceci dit, le projet de FPC, tout en bénéficiant de l’expérience de Formules et en s’inscrivant également sur le long terme, concerne exclusivement les aspects formels de la poésie contemporaine. Son programme est tout entier contenu dans son titre. "FORMES" en est le noyau. Dans leur pluralité, ces FORMES sont qualifiées à la fois comme "POÉTIQUES" et comme "CONTEMPORAINES". Chacun de ces trois termes pose des problèmes de définition, et demande en conséquence quelques éclaircissements.
 Les "FORMES" poétiques contemporaines ne sont pas seulement celles du vers. En effet, le vers, même libre, ne sert plus à caractériser la Poésie. Autrement dit, depuis plus d’un siècle, la poésie n’est plus définie (principalement) par les caractéristiques formelles de son écriture, mais plutôt par les effets esthétiques de sa lecture. Compte tenu d’une telle situation, les diverses significations que pourront revêtir aujourd’hui les termes de "poésie" ou de "poétique" (avec majuscule ou avec minuscule, comme genre ou comme non-genre, etc.) sont l’un de nos thèmes de réflexion, mais principalement du point de vue des FORMES.
Les "FORMES" poétiques contemporaines ne sont pas seulement celles du vers. En effet, le vers, même libre, ne sert plus à caractériser la Poésie. Autrement dit, depuis plus d’un siècle, la poésie n’est plus définie (principalement) par les caractéristiques formelles de son écriture, mais plutôt par les effets esthétiques de sa lecture. Compte tenu d’une telle situation, les diverses significations que pourront revêtir aujourd’hui les termes de "poésie" ou de "poétique" (avec majuscule ou avec minuscule, comme genre ou comme non-genre, etc.) sont l’un de nos thèmes de réflexion, mais principalement du point de vue des FORMES.
"POÉTIQUES" nous sert donc à qualifier toutes les pratiques formelles d’écriture et de performance qui se donnent pour telles. Nous ne nous arrêtons pas d’emblée à une quelconque définition rigoureuse de ce qui serait ou de ce qui ne serait pas de la "Poésie". Cela n’est pas possible aujourd’hui, faute de consensus.
L’adjectif "CONTEMPORAINES" couvre notre champ temporel, celui des auteurs vivants. Nous traversons sans doute une époque de transition : les étiquettes mêmes de "modernité" et de "post-modernité" sont devenues problématiques. Elles nous concernent toutefois dans la mesure où certains poètes et critiques les revendiquent ou les rejettent. En nous référant donc au contemporain, aux auteurs vivants, nous délimitons un espace plus vaste que le champ de la "modernité". Certes, le contemporain inclut, par exemple, les œuvres utilisant des moyens techniques de pointe (même si parfois leur "nouveauté" se limite à leurs seuls moyens), mais il est également évident que son domaine s’étend nécessairement — à moins de tomber dans l’incohérence — à toutes les pratiques formelles actuellement attestées.
Nos auteurs décrivent et commentent, exemples à l’appui, des formes poétiques pratiquées par des auteurs vivants. Ces contributions très diverses sont contenues dans plusieurs rubriques. Les questions esthétiques ou idéologiques sont abordées dans une section théorique ou font l’objet d’un Dossier. Une Enquête sur le vers contemporain est publiée dans chaque numéro, comportant les réponses de poètes sollicités par Gérald Purnelle. Les auteurs parlent de leurs propres œuvres dans la section Poèmes et poétiques, et des dossiers ou des entretiens peuvent leur être consacrés. Une rubrique est ouverte aux poèmes en cours de réalisation et une autre accueille des analyses d’œuvres, mais FPC ne fait pas systématiquement de notes de lecture des publications récentes, ce qui est le domaine propre à d’autres revues.
Finalement, il faut souligner que FPC n’entend nullement affirmer la ligne idéologique d’une quelconque chapelle, mais qu’elle prétend explorer par des questionnements évolutifs un domaine de création littéraire.
Une attention privilégiée aux formes poétiques
Notre sujet étant ainsi délimité, nous devons tenter de mieux définir ce que nous entendons par “forme”, ne serait-ce qu’à titre d’hypothèse continuellement remise en cause.
 Nous proposons donc de reconnaître comme forme tout trait descriptible régulier propre à une œuvre en particulier ou à un ensemble d’œuvres textuelles ou performatives. De notre point de vue, un trait descriptible sera régulier soit sur le mode de la répétition parfaitement systématique, soit sur le mode de répétitions diversement modulées. Ces formes pourront se trouver sous des aspects très diversifiés : les pratiques qui prolongent sous de nouveaux noms (comme "l’extrême contemporain" ou "le nouveau formalisme") le formalisme transgressif et iconoclaste d’une partie des avant-gardes historiques ; les pratiques qui prolongent le vers prosodique traditionnel, en le modifiant ou non ; les pratiques du formalisme hyperconstruit des écritures à contraintes (contraintes utilisées par des auteurs oulipiens ou non) ; les pratiques qui prolongent le vers libre avec une utilisation systématique de figures de composition non métriques, comme, par exemple, les avatars de la poésie sonore, performative, cybernétique, multimédia, visuelle ou typographique.
Nous proposons donc de reconnaître comme forme tout trait descriptible régulier propre à une œuvre en particulier ou à un ensemble d’œuvres textuelles ou performatives. De notre point de vue, un trait descriptible sera régulier soit sur le mode de la répétition parfaitement systématique, soit sur le mode de répétitions diversement modulées. Ces formes pourront se trouver sous des aspects très diversifiés : les pratiques qui prolongent sous de nouveaux noms (comme "l’extrême contemporain" ou "le nouveau formalisme") le formalisme transgressif et iconoclaste d’une partie des avant-gardes historiques ; les pratiques qui prolongent le vers prosodique traditionnel, en le modifiant ou non ; les pratiques du formalisme hyperconstruit des écritures à contraintes (contraintes utilisées par des auteurs oulipiens ou non) ; les pratiques qui prolongent le vers libre avec une utilisation systématique de figures de composition non métriques, comme, par exemple, les avatars de la poésie sonore, performative, cybernétique, multimédia, visuelle ou typographique.
Je crois que les diverses questions qui me sont posées à propos du projet de FPC comportent toutes un point commun : quel serait, pour nous, le pourquoi de la forme ? Il se trouve que, jusqu’à présent, nous avons plutôt privilégié une problématique du comment, et cela selon notre définition de la forme textuelle. Nous la définissons (dans un texte ou dans un ensemble de textes) comme une régularité descriptible et objectivable, ce qui implique forcément qu’elle est la trace matérielle, le produit objectif d’une règle d’écriture reconnaissable par une règle de lecture.
Or, si notre perspective se veut aussi objective que possible, l’objectif, en matière de formes textuelles, ne se confond pas pour autant avec le tautologique ni avec l’évident. Car ce n’est pas parce qu’une forme matérielle est présente dans tel texte qu’elle y est immédiatement repérable par la plupart des lecteurs. Elle peut même rester imperceptible. Ainsi, pour ne donner qu’un exemple célèbre, R. M. Albérès (par ailleurs excellent critique) écrivit un compte rendu de lecture à propos de La Disparition de Georges Perec sans remarquer à aucun moment que le roman respectait une règle textuelle cachée (assez connue des poètes alexandrins et des baroques, mais totalement oubliée à l’époque) : le " lipogramme en e ”. On pourrait m’objecter qu’il s’agit là d’un cas extrême, et que ce n’est pas de la poésie, mais d’un roman, où d’habitude on ne va pas chercher ce genre de choses. Prenons donc un exemple plus simple, comme les Sonnets de Prague, de Jaroslav Seifert (Seghers, 1984, p. 7-25). Dans leur traduction française (Henri Deluy et Jean-Pierre Faye), on voit bien que les premiers quatorze poèmes s’enchaînent les uns aux autres, chacun prenant comme premier vers le dernier vers du poème précédent ; quant au quinzième poème, il reprend dans l’ordre les vers ainsi répétés pour faire un sonnet entier. Combien de lecteurs ont pu y reconnaître la forme canonique de la Couronne de Sonnets ? On est en droit de se demander si les traducteurs eux-mêmes en ont eu connaissance (malgré leur fidélité aux répétitions de l’original), car ils n’en font pas mention dans leur préface. Cette forme italienne (décrite par Morier dans son Dictionnaire de Rhétorique), très courante en allemand et dans beaucoup de langues slaves à partir du XIXe siècle, demeure largement ignorée en France, ce qui donne peut-être la clé du problème.
Pour quelle raison certaines formes textuelles sont-elles peu ou pas perçues ? Parce que, me semble-t-il, tout texte résulte de l’exécution d’une série de règles purement et exclusivement conventionnelles, selon un primat du contractuel qui est le propre de la communication. La formulation de ces conventions appartient donc à un domaine social qui reste extérieur, extrinsèque au texte proprement dit. La simple matérialité de l’écrit ne suffit pas à nous livrer immédiatement toutes les règles qui le structurent, tant qu’on n’a pas accès à ce domaine contractuel : à la connaissance de la langue et de la culture, mais aussi à la connaissance précise de telle nouvelle règle inventée par tel créateur.
Cela vaut aussi bien pour les normes linguistiques que pour les règles pragmatiques du discours (ces règles constitutives de la langue et de la bonne communication). Cela vaut encore pour les canons littéraires, qui sont des conventions culturellement admises et historiquement déterminées. Ce qui importe toutefois pour mon propos est que, comme nous le verrons, cette connaissance préalable est encore plus indispensable lorsque la règle textuelle est peu conventionnelle ou non conventionnelle, c’est-à-dire inhabituelle ou nouvelle.
Assurément, on perçoit avec clarté la “ nouveauté ” de certaines œuvres ; ce fut le cas des iconoclasmes formels des avant-gardes, lesquels furent néanmoins accompagnés d’un discours théorique abondant. Ce type de différence se doit d’être violent, et doit surtout contredire des règles admises, des attentes préalables ; c’est le déplacement, ou l’infraction, ce qui sort du code conventionnel, qui est perceptible. Mais la dépendance (négative, négativiste) vis-à-vis du conventionnel est ici encore plus flagrante. L’évidence ne s’impose cependant pas toujours avec une telle violence. Ainsi, bien des constructions textuelles instaurent des règles supplémentaires sans violer pour autant les anciennes. Il suffit de lire les contributions de nos auteurs pour s’en rendre compte.
En d’autres termes, nous postulons que la perception claire et distincte des formes textuelles dépend en très grande part de la connaissance partagée de la règle textuelle utilisée pour les produire. Ainsi, moins une forme sera conventionnelle, c’est-à-dire contractuelle, plus il sera nécessaire que l’auteur la rende explicite pour permettre au lecteur de comprendre aisément ce qu’il a fait : il instaure le contrat, la nouvelle convention avec son lecteur. Je dis “ ce qu’il a fait ” et nullement “ ce qu’il a dit ”. Sans trop parler de dérives du signifié et autres déconstructions, je rappellerai simplement qu’il existe par nature un écart entre le Dire et le Dit, car tout texte comporte des “ trous ”, des “ places vides ” (Leerstelle, selon la terminologie de Wolfgang Iser sur l’acte de lecture) qui sont diversement remplies par des développements paradigmatiques et encyclopédiques échappant au sens littéral, de telle manière que le texte dira toujours un peu plus et un peu moins, quelle que soit l’intention communicative de son auteur. L’écart entre le Fait et le Faire matériel de la forme est bien plus mince si l’exécution de la règle d’écriture ne comporte pas trop de licences (ou d’erreurs). Pour cette raison, nous demandons à nos auteurs uniquement, mais impérativement, un commentaire formel à propos de leur travail. Libre à eux de nous donner d’autres réflexions de surcroît. Nous aurions très bien pu opter pour le choix opposé : publier des écritures formelles en laissant à nos lecteurs le soin de trouver par eux-mêmes les formes produites par nos auteurs. Ou, pour le dire autrement, en leur laissant la laborieuse découverte des raisons formelles claires et précises de ce qui les charme ou les rebute plus ou moins vaguement dans un texte. Nous aurions alors choisi et proposé une pragmatique du décryptage, ce qui n’est pas du registre de la lecture littéraire proprement dite, telle que nous la proposons.
En résumant, l’orientation de FPC dans la perspective du comment des formes est objective, mais elle n’est pas complètement neutre : elle implique le choix d’une certaine pragmatique de lecture littéraire, bref, d’une stratégie du partage de la création et de son analyse, qui s’érige sur une primauté du contractuel.
Quel serait donc le pourquoi de l’intérêt de FPC pour le comment des formes ? Des nuances péjoratives soupçonneuses restent attachées au “ formalisme ”, terme qui servit hier à condamner toute forme d’art non engagé. Il faut situer cela sur fond de paradigmes esthétiques, d’un certain Zeitgeist de la Modernité, qui persiste encore, surtout en France, comme opinion commune, en un mot comme Doxa, dans une époque qui n’est plus moderne, mais “ postmoderne ” ou “ hypermoderne ”.
Conformité à des modèles anciens, cohérence, fini stylistique, clôture, nouveauté par recherche de variations sur le déjà connu, tels ont été les traits formels “ académiques ” contre lesquels s’est construite une certaine idée de la Modernité. Et pourtant, révoltes contre les modèles, incohérences systématiques, non finito, œuvres ouvertes, nouveauté par recherche du jamais vu, sont également des traits formels d’un formalisme transgressif qui constitue encore l’une des tendances de la création contemporaine, tendance qui a droit à notre intérêt soutenu, comme par exemple par la place que nous donnons à des poètes français comme Gleize ou américains comme Bernstein. Cet intérêt pour les aspects à la fois iconoclastes et constructifs des formes nous vient en grande partie de ceux d’entre nous qui participent depuis neuf ans aux travaux de la revue Formules, de leurs réflexions sur des procédés, programmes et contraintes actuellement en usage chez les créateurs.
Mais alors, quels sont nos choix dans la perspective du pourquoi des formes ? Les formes poétiques étant œuvre humaine, elles comportent nécessairement des implications humaines : esthétiques, sociales, politiques, etc. Tous ces aspects sont autant de problématiques foisonnantes que nos auteurs ont très peu abordé dans les quatre numéros parus entre 2003 et 2006, à quelques exceptions près, comme Éric Clemens dans son article “ Manifestes ”.
Cela reste donc un vaste chantier à aborder, principalement dans son domaine philosophique propre, celui, esthétique, où nous n’avons, heureusement, aucune position commune.
![[Manières de critiquer] Poésie et critique (4), par Bernardo Schiavetta](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)