
"La critique ne doit, ne peut même se limiter à parler des livres ;
à son tour, elle se prononce toujours sur la vie."
"Ne nous leurrons pas, notre jugement ne découlera pas de notre savoir :
celui-ci nous servira à restituer la voix de l’autre, alors que la nôtre
trouve sa source en nous-même, dans une responsabilité éthique assumée"
(Tzvetan Todorov, Critique de la critique, Seuil, 1984, p. 190 et 187).
" Faudrait-il tout gober, rejoindre le troupeau des consommateurs, soutenir aveuglément la rentabilité, louer de pseudo-petits-maîtres et contribuer à la déperdition de culture ? " En  ces temps d’anomie, telle est la question que doit se poser avec Micheline B. Servin tout lecteur qui s’interroge encore sur la notion de "valeur esthétique", et donc a fortiori celui qui s’adonne à cette activité à propos de laquelle Tzvetan Todorov affirmait d’emblée dans Critique de la critique qu’elle " n’est pas un appendice superficiel de la littérature, mais son double nécessaire (le texte ne peut jamais dire toute sa vérité) " (Seuil, 1984). En ces temps hypermodernes qui voient le règne des "graphomanes entoilés" (Antoine Compagnon) et d’un fantasme de communication directe des œuvres avec le public, et où triomphe une publicité diablement efficace – fournissant "un conditionnement attrayant, un service commercial combatif, […] une politique de prix agressive et une mise en rayon de grande envergure" (William Marx, "Critique littéraire et critique yaourtière") -, à quoi bon la critique, en effet ? Les critiques vont-ils céder le pas aux animateurs ? De fait, le plus inquiétant est le brouillage des frontières : ""Qu’il y ait une fiction de divertissement et une fiction littéraire, cela ne pose pas de problème. Mais qu’on désigne comme littéraire ce qui est du pur divertissement et qu’on passe sous silence ce qui est littéraire, c’est au mieux de la paresse, au pire une forme de collaboration avec la domination capitaliste" (Thierry Guichard).
ces temps d’anomie, telle est la question que doit se poser avec Micheline B. Servin tout lecteur qui s’interroge encore sur la notion de "valeur esthétique", et donc a fortiori celui qui s’adonne à cette activité à propos de laquelle Tzvetan Todorov affirmait d’emblée dans Critique de la critique qu’elle " n’est pas un appendice superficiel de la littérature, mais son double nécessaire (le texte ne peut jamais dire toute sa vérité) " (Seuil, 1984). En ces temps hypermodernes qui voient le règne des "graphomanes entoilés" (Antoine Compagnon) et d’un fantasme de communication directe des œuvres avec le public, et où triomphe une publicité diablement efficace – fournissant "un conditionnement attrayant, un service commercial combatif, […] une politique de prix agressive et une mise en rayon de grande envergure" (William Marx, "Critique littéraire et critique yaourtière") -, à quoi bon la critique, en effet ? Les critiques vont-ils céder le pas aux animateurs ? De fait, le plus inquiétant est le brouillage des frontières : ""Qu’il y ait une fiction de divertissement et une fiction littéraire, cela ne pose pas de problème. Mais qu’on désigne comme littéraire ce qui est du pur divertissement et qu’on passe sous silence ce qui est littéraire, c’est au mieux de la paresse, au pire une forme de collaboration avec la domination capitaliste" (Thierry Guichard).
Par ailleurs, pour qui les critiques écrivent-ils aujourd’hui ? Si, dans les années 70, la réponse à la question "Que doit faire la critique ?" paraissait évidente – devenir une science, comme l’avançait Northrop Frye -, qu’en est-il en cette deuxième décennie du XXIe siècle ? C’est dire à quel point s’avère stimulant le numéro spécial des Temps Modernes que, une trentaine d’années après l’ouvrage de Todorov, coordonne Jean-Pierre Martin : le pluriel du titre renvoie à la grande diversité des perspectives classées en quatre parties ("Diagnostics", "Affects", "Approches" et "Enjeux").
Les Temps Modernes, Gallimard, n° 672 : "Critiques de la critique", janvier-mars 2013, 256 pages, 20,50 €. [Disponible de mi-février à mi-avril dans les points de vente habituels ; après, commandable à l’éditeur]
► Sur Libr-critique : "Libr-critique.com dans l’espace littéraire numérique. Notes (auto)réflexives" ; "De la critique et de la fonction critique en terrain miné" ; "De la critique en terrain miné. Dialogue avec Pierre Jourde".
[Suite de la chronique ci-dessous, en trois temps : "Crise de la critique ?", "Des trois critiques aujourd’hui" et "Au risque de la critique…"]
Crise de la critique ?
Dans son avant-propos, Jean-Pierre Martin commence par évoquer une idée reçue toujours d’actualité : "Critique : ne pas manquer d’en déplorer les insuffisances notoires"… 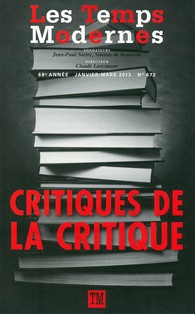 Philippe Forest lui fait écho : non seulement il n’y a pas d’Âge d’Or de la critique, mais en outre il ne saurait y avoir de critique parfaite, pour la simple raison que l’objectivité et la transparence relèvent du mythe. Ceci dit, en quoi peut-on parler aujourd’hui d’ "état critique" de la critique ou de "crise d’identité du critique" ? Notons d’abord que, s’il n’y a pas d’Âge d’or, force est de constater néanmoins qu’en ces temps où chutent les ventes en sciences humaines nous ne connaissons plus la même densité critique que dans les année 70. On remarquera ensuite que les constats de Pierre Jourde et de Claude Burgelin sont sans appel : "La critique littéraire a, en France, à peu près cessé d’exister et elle n’a plus rien à dire" (p. 46) ; "L’Université est exsangue, mais apaisée. Les combats d’idées ont déserté le terrain critique. Les colloques universitaires sont sérieux, sages, affables, mais également dépourvus d’enjeux et d’audace chercheuse que de public. La critique semble être devenue résolument postmoderne : émiettée, parcellaire, laissant coexister pacifiquement les discours dans une sorte de patchwork méthodologique sans trop de couleurs" (28). Le fait est que les signes alarmants ne manquent pas : quasi-invisibilité et mévente des publications critiques ; dans la sphère journalistique, diminution constante de la place réservée à la critique ; confusion actuelle entre information, promotion, recommandation et réflexion spécifique ; crise de la lecture, et plus encore de la lecture lettrée ; crise de l’enseignement, à laquelle les réformes successives n’apportent guère de solution…
Philippe Forest lui fait écho : non seulement il n’y a pas d’Âge d’Or de la critique, mais en outre il ne saurait y avoir de critique parfaite, pour la simple raison que l’objectivité et la transparence relèvent du mythe. Ceci dit, en quoi peut-on parler aujourd’hui d’ "état critique" de la critique ou de "crise d’identité du critique" ? Notons d’abord que, s’il n’y a pas d’Âge d’or, force est de constater néanmoins qu’en ces temps où chutent les ventes en sciences humaines nous ne connaissons plus la même densité critique que dans les année 70. On remarquera ensuite que les constats de Pierre Jourde et de Claude Burgelin sont sans appel : "La critique littéraire a, en France, à peu près cessé d’exister et elle n’a plus rien à dire" (p. 46) ; "L’Université est exsangue, mais apaisée. Les combats d’idées ont déserté le terrain critique. Les colloques universitaires sont sérieux, sages, affables, mais également dépourvus d’enjeux et d’audace chercheuse que de public. La critique semble être devenue résolument postmoderne : émiettée, parcellaire, laissant coexister pacifiquement les discours dans une sorte de patchwork méthodologique sans trop de couleurs" (28). Le fait est que les signes alarmants ne manquent pas : quasi-invisibilité et mévente des publications critiques ; dans la sphère journalistique, diminution constante de la place réservée à la critique ; confusion actuelle entre information, promotion, recommandation et réflexion spécifique ; crise de la lecture, et plus encore de la lecture lettrée ; crise de l’enseignement, à laquelle les réformes successives n’apportent guère de solution…
Des trois critiques aujourd’hui
Plus précisément, l’état des lieux que propose le volume au travers des trente contributions peut être présenté suivant la fameuse distinction entre les trois critiques opérée par Albert Thibaudet et rappelée à plusieurs reprises ici. Indéniablement, la critique journalistique est la plus décriée. Pierre Jourde résume ainsi ses travers : "généralisation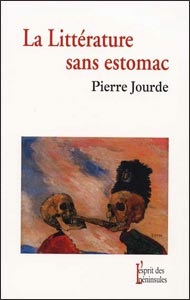 du conflit d’intérêt ; pipolisation du discours ; déférence envers le succès ; préjugés idéologiques et esthétiques ; panurgisme ; refus de la critique négative ; médiocrité de l’écriture ; refus de la remise en cause" (36). Philippe Forest, quant à lui, condamne « un principe inflationniste d’admiration ou de détestation hyperbolique culminant dans l’exercice désormais hégémonique du "coup de cœur" / "coup de gueule", qui réduit le geste critique à sa plus simple expression et le vide de toute signification » (111). Pour sa part, menant à bien son "incursion dans la critique dramatique", Micheline B. Servin décrit "une petite société du spectacle où plaire est un atout et les louanges très appréciées" : le "syndrome du cénacle", les collusions entre critiques et théâtres et les pressions diverses (relations directes entre la nature des critiques et les offres de places aux spectacles, voire les soutiens financiers aux journaux sous forme d’encarts publicitaires) expliquent que la critique dramatique est tombée dans la critique promotionnelle. En conséquence, comme le souligne Antoine Compagnon, "nous sommes entrés dans un nouvel âge de la conversation : la critique immédiate a lieu sur Internet, dans les blogs, les commentaires des librairies en ligne" (9). Nous n’en saurons pas plus : la critique sur la toile est la grande absente de l’ouvrage. Dans ces conditions, paraît salutaire la voie proposée par Thierry Guichard, le directeur du Matricule des Anges, qui entend redorer le blason de la critique journalistique, parce que seule à s’adresser véritablement aux lecteurs : "une critique littéraire qui s’adresserait à tous (et c’est l’honneur du journalisme de vouloir le faire) sans renier son objet : la littérature et seulement la littérature" (205).
du conflit d’intérêt ; pipolisation du discours ; déférence envers le succès ; préjugés idéologiques et esthétiques ; panurgisme ; refus de la critique négative ; médiocrité de l’écriture ; refus de la remise en cause" (36). Philippe Forest, quant à lui, condamne « un principe inflationniste d’admiration ou de détestation hyperbolique culminant dans l’exercice désormais hégémonique du "coup de cœur" / "coup de gueule", qui réduit le geste critique à sa plus simple expression et le vide de toute signification » (111). Pour sa part, menant à bien son "incursion dans la critique dramatique", Micheline B. Servin décrit "une petite société du spectacle où plaire est un atout et les louanges très appréciées" : le "syndrome du cénacle", les collusions entre critiques et théâtres et les pressions diverses (relations directes entre la nature des critiques et les offres de places aux spectacles, voire les soutiens financiers aux journaux sous forme d’encarts publicitaires) expliquent que la critique dramatique est tombée dans la critique promotionnelle. En conséquence, comme le souligne Antoine Compagnon, "nous sommes entrés dans un nouvel âge de la conversation : la critique immédiate a lieu sur Internet, dans les blogs, les commentaires des librairies en ligne" (9). Nous n’en saurons pas plus : la critique sur la toile est la grande absente de l’ouvrage. Dans ces conditions, paraît salutaire la voie proposée par Thierry Guichard, le directeur du Matricule des Anges, qui entend redorer le blason de la critique journalistique, parce que seule à s’adresser véritablement aux lecteurs : "une critique littéraire qui s’adresserait à tous (et c’est l’honneur du journalisme de vouloir le faire) sans renier son objet : la littérature et seulement la littérature" (205).
Si l’on en croit Antoine Compagnon, la critique des créateurs serait elle aussi mal en point : les écrivains d’aujourd’hui délaisseraient cette activité, faute d’opportunités et d’intérêt pour leurs confrères. S’il est vrai qu’ils sont de moins en moins sollicités par les instances littéraires, c’est ignorer la place qu’occupe l’écriture critique chez Christian Prigent, Bernard Desportes ou Pierre Jourde ; c’est oublier un peu vite l’importance qu’accordent à la réflexion critique et théorique ceux qui la pratiquent de façon occasionnelle comme auteurs et plus assidûment comme lecteurs : Annie Ernaux, Sylvain Courtoux, Chloé Delaume, Philippe Forest, etc. ; enfin, c’est ignorer ce sur quoi insiste Laurent Zimmermann, la créativité de certaines démarches : l’essayisme de Philippe Forest, les machineries fictionnelles de Pierre Bayard, diverses réécritures critiques (par exemple, Marc Escola, Lupus in fabula, 2003)…
les écrivains d’aujourd’hui délaisseraient cette activité, faute d’opportunités et d’intérêt pour leurs confrères. S’il est vrai qu’ils sont de moins en moins sollicités par les instances littéraires, c’est ignorer la place qu’occupe l’écriture critique chez Christian Prigent, Bernard Desportes ou Pierre Jourde ; c’est oublier un peu vite l’importance qu’accordent à la réflexion critique et théorique ceux qui la pratiquent de façon occasionnelle comme auteurs et plus assidûment comme lecteurs : Annie Ernaux, Sylvain Courtoux, Chloé Delaume, Philippe Forest, etc. ; enfin, c’est ignorer ce sur quoi insiste Laurent Zimmermann, la créativité de certaines démarches : l’essayisme de Philippe Forest, les machineries fictionnelles de Pierre Bayard, diverses réécritures critiques (par exemple, Marc Escola, Lupus in fabula, 2003)…
Quant à la critique universitaire, selon Dominique Rabaté, elle se caractérise toujours par le temps de la relecture, indispensable pour prendre le recul nécessaire par rapport à ses premières impressions. Ce qui ne l’empêche pas d’opter pour le "risque du contemporain" : selon Dominique Viart, plutôt que de décrire ou prescrire, cette critique du contemporain doit inscrire, à savoir mettre en évidence les enjeux historiques, socioculturels et formels des œuvres (inscription dans l’espace littéraire et l’espace social). Resterait à comprendre pourquoi elle se cantonne encore trop souvent dans l’étude des "valeurs sûres" et des écritures "lisibles" (Bonnefoy, Dupin, Jaccottet… Bergounioux, Bon, Duras, Echenoz, Houellebecq, Le Clézio, Michon, Simon…), quand elle ne rejoint pas les "valeurs" du Marché (on voit même poindre des articles sur Angot…). Du point de vue méthodologique, Alexandre Gefen analyse la mutation qui a eu lieu au tournant du siècle : "alors que la littérature d’avant les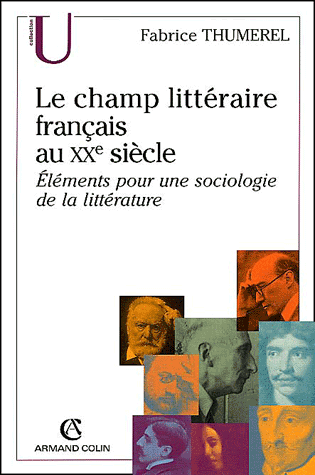 années 80 pouvait se prévaloir d’une critique endogène, linguistique, technique, et d’un regard sur elle-même uniquement informé par sa propre histoire, c’est en termes d’éthique et de micropolitique des sujets que les écrivains contemporains rendent compte de leurs projets, réintroduisant des formes de conscience du monde et d’autrui qui se donnent comme singulières, mouvement dont la critique témoigne par sa pluralité" (57). Désormais, "le texte est observé en action et en mouvement, dans ce qu’il fait, non dans ce qu’il est" (60). D’où un renouvellement salutaire favorisé par les apports des sciences cognitives comme des sciences humaines (sociologie, microhistoire, histoire matérielle du livre, anthropologie, théorie de l’information). Pour Éric Marty, la critique génétique, qui "ne s’est vraiment développée qu’à l’abri d’une crise profonde des études littéraires, c’est-à-dire d’une crise de l’interprétation" (129), reste "le dernier grand effort, dans la théorie littéraire, pour penser la littérature, c’est-à-dire se donner un objet, un programme, une méthode propre à un désir de connaissance" (126). Et c’est un fait que les perspectives génétique et sociologique – ou sociogénétique – ont donné lieu à de nombreux travaux reconnus. Pour sa part, Marie Gil défend une critique littéraliste qui réconcilie formalisme et herméneutique : cette lecture codée repose sur le postulat que « ce qui se cache sous le texte n’est pas un "discours" mais un autre texte » (147). Si ce panorama offre un aperçu intéressant d’une critique universitaire qui semble avoir définitivement tourné la page du formalisme, il n’en reste pas moins vrai que la majorité des productions – en particulier des communications de colloque – ressortissent à la critique d’application ou revendiquent l’absence de méthode particulière (cf. F. Thumerel, La Critique Littéraire, Armand colin, 1998, p. 110-115).
années 80 pouvait se prévaloir d’une critique endogène, linguistique, technique, et d’un regard sur elle-même uniquement informé par sa propre histoire, c’est en termes d’éthique et de micropolitique des sujets que les écrivains contemporains rendent compte de leurs projets, réintroduisant des formes de conscience du monde et d’autrui qui se donnent comme singulières, mouvement dont la critique témoigne par sa pluralité" (57). Désormais, "le texte est observé en action et en mouvement, dans ce qu’il fait, non dans ce qu’il est" (60). D’où un renouvellement salutaire favorisé par les apports des sciences cognitives comme des sciences humaines (sociologie, microhistoire, histoire matérielle du livre, anthropologie, théorie de l’information). Pour Éric Marty, la critique génétique, qui "ne s’est vraiment développée qu’à l’abri d’une crise profonde des études littéraires, c’est-à-dire d’une crise de l’interprétation" (129), reste "le dernier grand effort, dans la théorie littéraire, pour penser la littérature, c’est-à-dire se donner un objet, un programme, une méthode propre à un désir de connaissance" (126). Et c’est un fait que les perspectives génétique et sociologique – ou sociogénétique – ont donné lieu à de nombreux travaux reconnus. Pour sa part, Marie Gil défend une critique littéraliste qui réconcilie formalisme et herméneutique : cette lecture codée repose sur le postulat que « ce qui se cache sous le texte n’est pas un "discours" mais un autre texte » (147). Si ce panorama offre un aperçu intéressant d’une critique universitaire qui semble avoir définitivement tourné la page du formalisme, il n’en reste pas moins vrai que la majorité des productions – en particulier des communications de colloque – ressortissent à la critique d’application ou revendiquent l’absence de méthode particulière (cf. F. Thumerel, La Critique Littéraire, Armand colin, 1998, p. 110-115).
Au risque de la critique…
Ainsi la critique est-elle aujourd’hui encore régie par les mêmes lignes de fracture : objectivisme / subjectivisme, érudition / spectacle, scientisme / mimétisme… Ainsi continue-t-elle d’évoluer entre ces deux écueils que rappelle Pierre Jourde : "d’un côté, le texte comme prétexte, de l’autre le texte considéré en fonction des signes de littérarité qu’il émet" (43). Mais le bouleversement est lié aux signes visibles de rupture épistémologique.
Ainsi la critique doit-elle résister à l’uniformisation médiatique et marchande : pierre angulaire dans la circulation du sens, le critique doit se garder de se laisser court-circuiter par un univers promotionnel qui fait de ses jugements des arguments de vente et prendre conscience de sa responsabilité lorsqu’il érige des textes actuels en objets d’étude. Il doit également se défier de ces mêmes lieux communs qui se sont immiscés dans le volume. Le premier est celui qui attribue à l’œuvre une "qualité intrinsèque" ; or, l’histoire littéraire comme l’histoire des réceptions ne valident pas cette hypostase qui a jadis donné naissance à l’appellation "profondeur de l’œuvre". Le second est formulé de la sorte à la page 110 : "pour un auteur, le bon critique est essentiellement celui qui émet le jugement le plus favorable sur son livre"… La généralisation n’est évidemment pas acceptable : seuls sont concernés ici les écrivains ressortissant au pôle commercial ou semi-commercial ; pour les autres, seule compte la relation symbolique aux lecteurs et critiques – ce dialogue qui, lorsqu’il est fructueux, développe tous les fils de cette bobine qu’est l’œuvre.
On terminera par regretter que ce volume corresponde quasi systématiquement à ses conditions de production : une revue institutionnelle invite bon nombre d’auteurs qui sont des institutions en soi ou appartiennent à des institutions afin de pontifier sur des lieux et des auteurs institutionnels : la boucle est bouclée. Or, la critique se limite-t-elle à quelques médias et quelques mandarins ? N’est-ce pas aux marges qu’elle est la plus singulière ?
![[Chronique] Critiques de la critique, numéro spécial des Temps Modernes](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)
« Plume poil palme piaillent pagaïe oublié
le boulet de l’espèce à la vitesse où déboule
venue les dép-ouille-aïe-er du moule
la pouhésie qui tourneboule poule & poule »
NOTES SUR LE CONCEPT DE MATÉRIALISME LANGAGIER
1.prolégomènes :
1.1 j’emploie les mots signifiant et signifié dans un sens large :
1.2 signifiant = le signe + le son, à l’intérieur d’une certaine communauté linguistique.
1.3 signifié = le substrat conceptuel de base à peu prêt commun à tous dans une communauté + la résonance et les connotations propres à chacun suivant sa culture, son imagination, sa sensibilité.
2. développement :
2.1. le matérialisme métaphysique affirme le primat de la matière sur l’esprit.
2.2. le matérialisme dialectique, ou matérialisme historique affirme que les constructions intellectuelles et culturelles sont la résultante, ou superstructure, des formes de productions industrielles (techno structure, ressources naturelles)
2.3. le matérialisme langagier affirme le primat du signifiant sur le signifié.
2.4. les raisons de cette affirmations tiennent essentiellement à une solidité, une matérialité objectale, public et valable pour tous du signifiant, par opposition au caractère non délimité, flou, privé, individuel et subjectif du signifié.
2.5. l’idée que le signifiant ne puisse être qu’un outil chargé de désigner une vérité qui ne soit pas exactement la même pour tous est précisément ce que combat le matérialisme langagier, dans lequel un mot doit renvoyer à la même chose pour tous.
2.6. d’où une volonté de « limiter » le plus possible l’extension du signifié et de favoriser la normalisation du dispositif langagier (signifiant + signifié).
3. conséquences :
3.1 la conséquence du matérialisme langagier est l’appauvrissement extrême du sens des énoncés au profit du signifiant (son+signe). ce dispositif a pour but de frapper l’esprit comme à l’aide de slogans festifs et ludiques et de couper la réflexion qui proviendrait d’une intellection plus profonde du sens.
3.2 on voit donc que le but du matérialisme langagier, bien que provenant d’une idéologie post-marxisante est identique à celui de la nov-langue du capitalisme ultra libéral. dans les deux cas l’objectif est d’aliéner le lecteur-auditeur à la volonté de la puissance émettrice du message.
3.3 cette conjonction de buts des forces post-marxistes dégénérées et du capitalisme ultra libéral est ce que Guy Debord appelait dans son livre « commentaire su la société du spectacle » : le spectaculaire intégré.
merci de votre attention
denis hamel
http://fr.groups.yahoo.com/group/hainedelapoesie/