 Yves Citton, Mythocraties : storytelling et imaginaire de gauche, éditions Amsterdam, 2010, 17 €, ISBN : 978-2-35480-067-3.
Yves Citton, Mythocraties : storytelling et imaginaire de gauche, éditions Amsterdam, 2010, 17 €, ISBN : 978-2-35480-067-3.
► Ce soir à 20H, Librairie Le Genre Urbain (30, rue de Belleville 75020 Paris), débat avec l’auteur, l’économiste Frédéric Lordon et le philosophe Laurent Bove.
Chronique par Jean-Nicolas Clamanges
Réagissant au livre de Christian Salmon, Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits (La Découverte, 2007), Yves Citton reprend le problème au fond en interrogeant notre imaginaire du pouvoir et en réévaluant les ressources de l’art du récit à partir d’un investissement résolument politique de la théorie littéraire. Il est membre du collectif de la revue Multitudes, collabore à la Revue Internationale des Livres et des Idées et enseigne la littérature à l’université de Grenoble. Il a publié L’envers de la liberté et Lire, interpréter, actualiser : pourquoi les études littéraires (éd. Amsterdam).
Le pouvoir est dans la machine à café
"Nul n’est encore parvenu à déterminer ce que peut un récit", annonce Yves Citton ; pour essayer de le savoir, il faut selon lui commencer par changer notre idée du pouvoir ; s’inscrivant dans une réflexion sur la dimension volontaire de la servitude qui va de La Boétie à Hobbes, et relisant Foucault avec Lazzaratto (Les Révolutions du capitalisme, Seuil), Y.C. demande, s’agissant des régimes contemporains, qu’on substitue à une représentation pyramidale du pouvoir l’image d’un réseau intriqué, d’un patchwork d’interconnections subjectives. La capacité à y capter l’attention (le temps d’attention) et le flux des désirs y est la clef de ce que Lazzaratto nomme "noo-politique" : politique de l’intellect en tant qu’il s’inscrit dans une "économie des affects". On retrouve ici, dans des termes différents, ce qu’identifie aujourd’hui Bernard Noël comme stratégie d’occupation des fors intérieurs (cf. ma chronique sur A bas l’utile), mais là où BN. s’inquiète : "l’intimité n’a plus de lieu" (La Castration mentale, POL, p. 36), Y.C. l’assume en deleuzien dans une approche "transindividuelle" des émotions : des circuits de frayages mentaux interagissent, se structurent en agencements locaux, plus ou mois auto-régulés, plus ou moins durables et qui sont constitutifs de la sphère publique ; l’imaginaire du pouvoir ici visé s’identifie donc à une circulation de courants mentaux, à un champ de magnétisation dont il pointe l’émergence au XVIIIe siècle (mesmerisme) et dont la sociologie de Tarde (Les Lois de l’imitation, 1890) fut la première théorisation. L’économie des affects est une économie de flux traversant les individus, constituant les intériorités comme des sortes d’échangeurs en capacité virtuelle de faire bifurquer l’influx (invention) ou de le laisser passer (imitation). L’exercice du pouvoir consisterait à capturer cette énergie désirante de la multitude, à la canaliser par des institutions collectives.
des émotions : des circuits de frayages mentaux interagissent, se structurent en agencements locaux, plus ou mois auto-régulés, plus ou moins durables et qui sont constitutifs de la sphère publique ; l’imaginaire du pouvoir ici visé s’identifie donc à une circulation de courants mentaux, à un champ de magnétisation dont il pointe l’émergence au XVIIIe siècle (mesmerisme) et dont la sociologie de Tarde (Les Lois de l’imitation, 1890) fut la première théorisation. L’économie des affects est une économie de flux traversant les individus, constituant les intériorités comme des sortes d’échangeurs en capacité virtuelle de faire bifurquer l’influx (invention) ou de le laisser passer (imitation). L’exercice du pouvoir consisterait à capturer cette énergie désirante de la multitude, à la canaliser par des institutions collectives.
Y.C. condense ce modèle dans une image originale qui revisite le Leviathan hobbesien en mode percolateur : "selon l’imaginaire associé par notre époque à la machine à café, on envisagera donc que la puissance de la multitude se canalise pour s’élever au-dessus d’elle-même pour se surplomber et pour retomber sur les individus sous la forme d’un pouvoir institutionnel" (p. 48). De ces retombées interagissantes (nuage de coups de matraques classiques ou neige électronique du "soft power" sur nos écrans mentaux), Y.C. choisit de travailler la seconde comme "conduite des conduites" (Foucault), en forçant un peu sur la métaphore du réseau de canalisations pour lier induction, conduction et stratégies des possibles : le pouvoir aménagerait en douce des probabilités de conduites illusoirement vécues comme libres par les consciences en réseaux (c’est ici Spinoza qui est au volant du module théorique).
Ce que peut un récit
Arrive alors la fameuse formule du roman "fataliste" de Diderot : "tout ce qui nous arrive de bien et de mal était écrit là-haut", qu’il faut réécrire selon Y.C. comme une question destinée à penser le pouvoir : "qui raconte mon histoire (de personne réelle) ?" (p. 62), ou bien : "qui métaconduit mes conduites ?", sachant que le réseau est en composition (improvisation collective) incessante où chacun cherche à conduire d’autres conduites, en étant lui-même conduit depuis une autre scène. Du coup la question devient : "Qui racontent nos histoires ?"
C’est ici qu’Y.C. discute les thèses de Salmon sur le "storytelling". Concédant l’instrumentalisation moderne de la "story" par le management, la publicité et la politique, concédant également que l’art de cette instrumentalisation  est aujourd’hui "de droite", il refuse d’accorder pour autant que (se) raconter des histoires aujourd’hui soit nécessairement de l’ordre de la mystification réactionnaire. Il propose au contraire de réévaluer le potentiel émancipateur du récit. L’increvable définition aristotélicienne (ravalée par Francesca Polletta dans It was like a Fever : Storytelling in Protest and Politics, Chicago, 2006), modélise l’objet : un début, un milieu, une fin ; unité de l’intrigue ; enchaînement causal et transformation d’états ; affrontement de valeurs antithétiques ; capacité intégrative de l’intrigue comme "synthèse de l’hétérogène". Bref, du récit comme on n’en écrit plus en littérature de recherche depuis, mettons pour la France, la démolition du "récit balzacien" par Robbe-Grillet et son gang. Y.C. pense néanmoins qu’au niveau de l’individu lambda, "c’est en narrativisant (plus ou moins de cette façon) les événements de ma vie que je leur donne sens" (p. 73), et généralise en posant que "les histoires qu’on se raconte fonctionnent dans bien des cas comme des machines à orienter nos propres flux de désirs et de croyances" (p. 74). Autrement dit, l’inconscient des contemporains est structuré comme un réseau d’histoires transindividuelles en transformation incessante.
est aujourd’hui "de droite", il refuse d’accorder pour autant que (se) raconter des histoires aujourd’hui soit nécessairement de l’ordre de la mystification réactionnaire. Il propose au contraire de réévaluer le potentiel émancipateur du récit. L’increvable définition aristotélicienne (ravalée par Francesca Polletta dans It was like a Fever : Storytelling in Protest and Politics, Chicago, 2006), modélise l’objet : un début, un milieu, une fin ; unité de l’intrigue ; enchaînement causal et transformation d’états ; affrontement de valeurs antithétiques ; capacité intégrative de l’intrigue comme "synthèse de l’hétérogène". Bref, du récit comme on n’en écrit plus en littérature de recherche depuis, mettons pour la France, la démolition du "récit balzacien" par Robbe-Grillet et son gang. Y.C. pense néanmoins qu’au niveau de l’individu lambda, "c’est en narrativisant (plus ou moins de cette façon) les événements de ma vie que je leur donne sens" (p. 73), et généralise en posant que "les histoires qu’on se raconte fonctionnent dans bien des cas comme des machines à orienter nos propres flux de désirs et de croyances" (p. 74). Autrement dit, l’inconscient des contemporains est structuré comme un réseau d’histoires transindividuelles en transformation incessante.
Dans ce réseau, ce qui nous structure "en nous sans nous" (comme disait le père Malebranche) c’est spécialement ce que Bernard Stiegler appelle les "rétentions tertiaires", soit ce qu’on enregistre hors de moi sur d’autres supports que mon mental, et dont la reproductibilité à l’identique parasite et formate mes capacités narratives. Voire ! car Y.C. importe ici de la théorie littéraire anglo-saxonne la notion de "prompteur" (Kendall L. Walton) visant notre capacité de jeu et de faire semblant : "capacité à jouer avec ce qui canalise nos flux de désirs et de croyances comme si les canaux constituaient les pièces d’un jeu ouvert" (p. 83). Notre propre est aussi de fictionner pour voir ce que ça donne… Du coup apparaît en filigrane de la réflexion d’Y.C. l’impact de l’idée d’œuvre ouverte (Eco), comme une sorte de contrepoint au modèle "aristotélicien" de la structure intégrative bouclée vu plus haut. C’est amusant de voir l’histoire moderne des formes organiser discrètement la matière du théoricien.
Mais au fond, Y.C. ne prétend pas enrichir la théorie de la narration : ce qui l’intéresse en revanche, c’est ce qu’il appelle la "scénarisation" : scénariser, c’est raconter pour conduire des conduites réelles. Chez Eschyle, des "paroles enchanteresses" aideront Oreste, Apollon l’en assure, à se tirer du mauvais pas où les dieux l’ont mis, lors du jugement de son cas devant le tribunal d’Athènes. En rhétorique, c’est vrai, la narratio est un enjeu stratégique puisque la présentation des faits qu’elle met en scène condense toute la stratégie d’attaque ou de défense. Dans le vocabulaire d’Y.C., le récit est "déclencheur et conducteur de conduites".
Scénariser : le génie de Mme de la Pommeraye
Il illustre cela par une analyse passionnante de l’épisode de Mme de la Pommeraye dans Jacques le fataliste. Une femme jalouse parvient à force d’intrigue et de dissimulation à faire épouser "librement" une prostituée à son ancien amant. La scénarisation consiste ici à rendre invisible (au marquis des Arcis) ce qui démarque fiction et réalité (pour Mme de la P. et pour le lecteur). Il s’agit, commente Y.C., "de savoir inventer de ce que (l’auditeur) veut entendre" (p. 98). J’ajouterai qu’en psychanalyse, cela s’appelle la relation d’emprise : c’est le terrain où combattent Valmont et la marquise de Merteuil ; c’est aussi celui de Dom Juan avec M. Dimanche : deviner ce que l’autre ignore de son désir, c’est s’assurer de lui (Cf. Pierre Bayard, Le paradoxe du menteur, éd. de Minuit.)
Y.C. se demande ce que nous enseigne cette sorte d’histoires(s) de ce que nous pouvons faire pour comprendre la machine et nous en servir dans une perspective émancipatrice. Comment faire émerger une "story" de la mer des histoires ? par une stratégie d’"accroche", par la force d’un "script". Accrocher, en passant par un genre, un 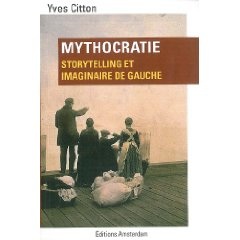 style admis (dans son vocabulaire, des frayages mentaux ou des pré-figurations); jouer la force intégrative de la syntaxe narrative : le marquis des Arcis se prendra, dans le réel, pour une actualisation d’un script en vogue : "le libertin-séducteur-d’une-ravissante-idiote". Mais la différence radicale entre le récit de Diderot et le script en question, serait que le narrateur (Jacques) le reconfigure en introduisant du "bougé" un peu partout : sa position à l’égard des valeurs est ambivalente, la polyphonie des écoutants et de leurs interprétations (divergentes) problématise l’interprétation, et puis des choses échappent, des lignes de fuite se dessinent : le bonheur des deux époux n’était pas prévu par la meneuse d’intrigue. On pourrait dire que la réflexion sur ce sujet des conduites scénarisées par des récits, commence avec les aventures de Don Quichotte saisi par ce que Cervantès appelle génialement les "écritures errantes".
style admis (dans son vocabulaire, des frayages mentaux ou des pré-figurations); jouer la force intégrative de la syntaxe narrative : le marquis des Arcis se prendra, dans le réel, pour une actualisation d’un script en vogue : "le libertin-séducteur-d’une-ravissante-idiote". Mais la différence radicale entre le récit de Diderot et le script en question, serait que le narrateur (Jacques) le reconfigure en introduisant du "bougé" un peu partout : sa position à l’égard des valeurs est ambivalente, la polyphonie des écoutants et de leurs interprétations (divergentes) problématise l’interprétation, et puis des choses échappent, des lignes de fuite se dessinent : le bonheur des deux époux n’était pas prévu par la meneuse d’intrigue. On pourrait dire que la réflexion sur ce sujet des conduites scénarisées par des récits, commence avec les aventures de Don Quichotte saisi par ce que Cervantès appelle génialement les "écritures errantes".
Jacques le fataliste est donc écrit, selon Y.C., pour révéler les possibles émancipateurs de la scénarisation bien conçue : scénariser ce n’est jamais programmer ; c’est jouer sur une distance entre ce qui est et ce qui passe pour être, jeu de "faire semblant" nécessaire à l’efficacité "conductrice" de l’opération – mais justement reconfigurable (un des mots favoris de Citton) par là-même. Cela d’autant plus que (et réintervient ici l’impact de l’art moderne du récit déconstruit ou en miettes, version Godard ou Beckett), ce sont moins des œuvres, pense Y.C., qui nous touchent, que des "particules narratives" : « "l’œuvre" n’offrant plus qu’à titre exceptionnel un horizon de complétude intégratrice (…) notre rapport aux histoires est généralement constitué des impacts ponctuels produits par des effets syntaxiques locaux » (p. 112). Chance à saisir, car le réseau est tellement embrouillé, complexe et fragile qu’il suffirait de s’en aviser pour engendrer des bifurcations locales, elles-mêmes génératrices d’autres frayages de plus grande envergure.
Faut-il donc (se) raconter surtout des histoires aux sentiers qui bifurquent ? Sans doute : proposant de considérer la narration "comme une usine de retraitement des valeurs" (p. 116), Y.C. valorise l’art de la complexité formelle (p. 119), par rapport au simplisme des "storytellers" épinglés par Salmon. C’est qu’il préfère visiblement le free jazz, le cinéma de Claire Denis ou Le Manuscrit trouvé à Saragosse du comte Potocki, aux valses viennoises ou aux romans de Jardin. Au fil du livre s’esquisse en effet un éloge de la "multiplication des niveaux, des mises en scène de contradictions, de nuances expressives, de lenteurs narratives, de rétrospections critiques, d’indécidabilités axiologiques" (p. 119) : au fond, les œuvres résistent à la dissolution moléculaire de la soupe médiatique et ce livre le prouve en s’écrivant sous leur conduite discrète. Plus on avance, plus on sent que derrière les modèles foucaldo-deleuziens qu’Y.C. dit "bricoler" (il fait tout de même un peu plus), c’est son imaginaire esthétique qui œuvre foncièrement. On ignore si cet imaginaire est celui du quidam contemporain.
Ce qui vient ?
Certes, jamais il n’écrirait que le storytelling "de gauche" consiste à produire des œuvres d’art ! Néanmoins, c’est bien lui qui se réjouit d’emprunter son argument à Sun Ra : "La mythocratie, c’est ce que vous n’êtes jamais devenu de ce que vous devriez être". Le tragique d’une telle formule ne requiert pas Y.C., qui l’exploite en utopiste ; et s’il cite le constat désabusé de W. Benjamin sur l’effacement moderne de la narration par l’information (Le Narrateur, in Écrits français, folio), c’est pour le renverser ; en effet, "le pouvoir de scénarisation (tel qu’il l’entend) consiste (bien) à "injecter ou à répandre des précédents dans le tissu social" (p. 126). Il s’appuie ici sur les thèses de J-C. Scott récemment traduit chez Amsterdam (La Domination et les arts de la résistance), présentant les rapports entre "texte public" et "texte caché" dans la médiasphère, comme terrain où tout se joue, à la frontière de ce que le texte dominant est fait pour verrouiller et de ce que les voix et les récits des dominés parviennent à y faire entendre – avec des effets de propagation quelquefois fulgurants, y compris en termes politiques. "La frontière entre les textes publics et cachés forme une zone de lutte constante entre dominants et subordonnés – mais ne constitue pas un mur solide (…). La lutte sans relâche organisée autour de ces frontières est peut-être l’arène la plus fondamentale des formes de conflit et de lutte de classe." (Scott, cité p. 129).
Admettre ce modèle, c’est du même coup reconnaître que la notion de "soft power" oblitère objectivement la violence effective du pouvoir. Ce qui n’est pas une découverte. Mais l’effraction du texte caché à travers la frontière, n’est-ce pas, par exemple, ce "babil des classes dangereuses" que Novarina, Prigent, Verheggen et leurs acolytes font entendre dans la langue dominante depuis l’époque de TXT ? N’est-ce pas aussi tout le travail de B. Noël : "Ma langue naît dans la langue morte : elle arrache la peau qui trop signifiait, elle agite en l’air ce verbe défait, et le sens lui vient comme vient le souffle sur la nudité (…) car la chair se fait verbe pour que les corps soient l’avenir des mots." (La castration mentale, p. 42).
violence effective du pouvoir. Ce qui n’est pas une découverte. Mais l’effraction du texte caché à travers la frontière, n’est-ce pas, par exemple, ce "babil des classes dangereuses" que Novarina, Prigent, Verheggen et leurs acolytes font entendre dans la langue dominante depuis l’époque de TXT ? N’est-ce pas aussi tout le travail de B. Noël : "Ma langue naît dans la langue morte : elle arrache la peau qui trop signifiait, elle agite en l’air ce verbe défait, et le sens lui vient comme vient le souffle sur la nudité (…) car la chair se fait verbe pour que les corps soient l’avenir des mots." (La castration mentale, p. 42).
Finalement, le livre d’Y.C. pourrait faire symptôme (dans l’ordre délimité de la "théorie littéraire") d’un "bien creusé vieille taupe" en chemin : peut-être qu’une cristallisation est en train de s’opérer depuis le travail de ces écrivains et de quelques autres (et pas seulement dans l’Hexagone ), au contact de la rage qui monte (l’insurrection qui vient ?), pour qu’émerge une façon de dire et de (se) raconter la lutte des classes qui n’aura pas grand chose à voir avec les façons du storytelling.
Comme il faut toujours laisser quelque chose au lecteur, je lui réserve les chapitres V et VI du livre, aussi gauches et maladroits que possible pour assumer, nous dit-on, de "renouveler l’imaginaire de gauche" en prenant un virage vers Saturne.
![[Chronique-recherches] Yves Citton, Mythocraties : storytelling et imaginaire de gauche, par J.-.N. Clamanges](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)