Dans Les Fils maudits de la République. L’avenir des intellectuels en France (Fayard, 2005), l’historien Gérard Noiriel oppose aux intellectuels de cour et aux prophètes révolutionnaires — dont il fustige ces figures archétypales que sont pour lui Sartre et Nizan — ceux qui, par delà leurs divergences, peuvent et doivent se regrouper en communauté pour mettre leurs savoirs et savoir-faire particuliers au service du débat démocratique. Il ne fait ainsi que reformuler la position de Pierre Bourdieu, qui disqualifie les intellectuels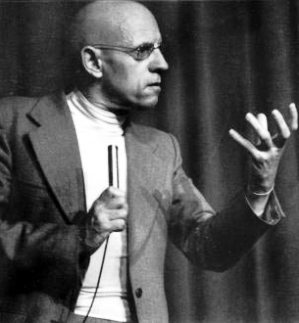 traditionnels et les faux intellectuels (doxosophes) au profit des intellectuels spécifiques, qu’il invite à se réunir en collectifs. Au reste, dans un numéro de Critique consacré à Bourdieu (n° 579-580, août-sept. 1998), Gérard Mauger pose que le sociologue opère le dépassement de l’opposition établie par M. Foucault (cf. «Vérité et pouvoir», L’Arc, n° 70, 1977) entre «l’intellectuel universel» (le défenseur des valeurs universelles dont Sartre, qui se situe dans la lignée de Voltaire et de Zola, est le parangon au XXe siècle) et «l’intellectuel spécifique» (l’expert que l’on ne consulte ou qui ne prend la parole qu’au sujet de problèmes concernant son domaine) — opposition qui ressortit à celle entre, d’une part, philosophie et sciences humaines (Bergson vs Durkheim), et, d’autre part, philosophie du sujet et philosophie du savoir. Sartre est donc considéré comme un intellectuel classique, c’est-à-dire comme un type d’intellectuel universaliste qu’il convient de dépasser (cf. «L’Engagement sociologique», pp. 674-696).
traditionnels et les faux intellectuels (doxosophes) au profit des intellectuels spécifiques, qu’il invite à se réunir en collectifs. Au reste, dans un numéro de Critique consacré à Bourdieu (n° 579-580, août-sept. 1998), Gérard Mauger pose que le sociologue opère le dépassement de l’opposition établie par M. Foucault (cf. «Vérité et pouvoir», L’Arc, n° 70, 1977) entre «l’intellectuel universel» (le défenseur des valeurs universelles dont Sartre, qui se situe dans la lignée de Voltaire et de Zola, est le parangon au XXe siècle) et «l’intellectuel spécifique» (l’expert que l’on ne consulte ou qui ne prend la parole qu’au sujet de problèmes concernant son domaine) — opposition qui ressortit à celle entre, d’une part, philosophie et sciences humaines (Bergson vs Durkheim), et, d’autre part, philosophie du sujet et philosophie du savoir. Sartre est donc considéré comme un intellectuel classique, c’est-à-dire comme un type d’intellectuel universaliste qu’il convient de dépasser (cf. «L’Engagement sociologique», pp. 674-696).
Il faudra passer outre ces subtilités rhétorico-dialectiques pour s’interroger sur le rôle de l’intellectuel critique contemporain : faut-il voir, après Sartre et à partir de Bourdieu, la fin de l’intellectuel classique, ou au contraire les considérer tous deux comme des figures idéaltypiques de l’intellectuel critique, c’est-à-dire deux modèles dont les fondements anthropologiques sont différents ? D’où ces pierres d’achoppement que constituent ces autres questions : quelles philosophies de l’action et quelles pratiques d’écriture un tel engagement nécessite-t-il ? Quels sont ses limites et à quelles conditions peut-il échapper à l’aporie et au paradoxe ? De Sartre à Bourdieu : la fin de l’intellectuel classique ?
Avant comme après la disparition de Pierre Bourdieu (1930-2002), les innombrables parallèles avec Sartre, qui ont été établis aussi bien dans les champs médiatique et politique que dans le champ intellectuel, nous ont offert un point de vue pour le moins ambivalent. D’une part, le sociologue est rangé dans la catégorie des «intellectuels à l’ancienne», des «intellectuels classiques» (de Zola à Sartre) — d’autant qu’il a su retrouver face aux cheminots, à la gare de Lyon en 1995, la même posture inconfortable que celle du philosophe à Boulogne-Billancourt en 68, celle d’un imprécateur «porte-parole des humiliés» (voir, en août 1998 dans Le Figaro, la déclaration d’Henri Weber, sénateur PS de Seine Maritime, mais aussi Philippe Tesson dans Le Figaro littéraire du 3 septembre 1998, Arnaud Viviant dans Les Inrockuptibles, 29 janvier-4 février 2002,…). Toutefois, on peut également trouver un rapprochement d’une tout autre nature : dans Bourdieu autrement. Fragilités d’un sociologue de combat (Textuel, 2003), Philippe Corcuff le classe parmi «les grands intellectuels critiques du siècle dernier», aux côtés de Sartre, Merleau-Ponty, Foucault, Deleuze… Inversement, d’autres insistent sur la rupture entre cet expert qui descend dans la rue et la tradition française de l’intellectuel (cf. Catherine Portevin dans Télérama, n° 2716, 30 janvier 2002), jugement que peuvent résumer ces lignes d’Emmanuelle Anizon dans La Vie du 24 septembre 1998 : «Aujourd’hui, on est "bourdivien" ou "bourdieusien", comme on a été sartrien. […]. Pourtant, Bourdieu n’est pas Sartre. Celui qui se définit comme un "militant scientifique" ne fonde pas ses engagements sur des convictions personnelles, mais sur ce qu’il considère être une science, la sociologie».
De façon moins simpliste (qui pourrait sérieusement souscrire à cette antinomie réductrice : intellectuel incompétent, naïf et irresponsable versus expert compétent et responsable ?), Pierre Bourdieu lui-même s’est opposé à Sartre, se livrant à une critique constante et parfois virulente de celui qui, au XXe siècle, incarne par excellence «l’intellectuel à l’ancienne, présent sur tous les fronts de la pensée, détenteur de toutes les réponses […]» (Questions de sociologie, Minuit, 1980 ; rééd. 1998, p. 73). A tel point qu’on ne peut s’empêcher de rapporter à sa relation à cet emblème de l’intellectuel contemporain, qui, pour l’étudiant qu’il était dans les années cinquante, constituait une figure fascinante mais repoussante (1) la maxime qu’il énonce dans son Esquisse d’une théorie de la pratique (Droz, 1972) : «[…] certains anathèmes […] ne revêtiraient sans doute pas une telle violence s’ils n’avaient une saveur d’autocritique, consciente ou inconsciente» (rééd. Seuil, «Points», 2000, p. 270). Aussi conviendra-t-il d’éclairer le différend Bourdieu/Sartre pour être en mesure de montrer en quoi ils représentent deux figures d’intellectuel critique différentes mais non antithétiques.
Une critique constante du modèle sartrien
Dès le début des années soixante-dix, Pierre Bourdieu opère une critique radicale des intellectuels centrée sur le modèle sartrien : il leur reproche d’universaliser le rapport inconscient qu’ils entretiennent à leur objet, faute d’une analyse critique efficace de leur position dans le champ du pouvoir comme dans leur champ d’appartenance (philosophique, littéraire, etc.), mais aussi de leurs déterminations génériques et spécifiques.
Conformément à la méthode scientifique qu’il a mise au point dès 1971 dans «Champ du pouvoir, champ intellectuel et habitus de classe» (Scolies, n°1, pp. 7-26), commençons par considérer le point de vue qu’il adopte sur les relations entre champ intellectuel et champ du pouvoir. Son premier grief à l’encontre des intellectuels universalistes trouve sa meilleure formulation dans son entretien avec Loïc J.D. Wacquant : paradoxalement, ces champions de la connaissance ignorent les «mécanismes collectifs de la subordination politique et éthique», et cette ignorance est l’une des raisons qui «ont trop souvent conduit les intellectuels les plus sincèrement progressistes (comme Sartre) à rester complices des forces qu’ils croyaient combattre» (Réponses, Seuil, 1992, p. 166). Pire, décident-ils de se livrer à un exercice d’autocritique, «ces classeurs inclassables» (La Distinction, Minuit, 1979, p. 550) qui souffrent d’une incapacité générique à se situer socialement sombrent alors dans la mauvaise foi : «Proclamer : "Je suis un intellectuel bourgeois !", comme Sartre aimait à le faire, est à peu près sans conséquence. Mais dire : "Je suis un assistant à Grenoble parlant à un professeur parisien", c’est m’obliger à m’interroger sur la part de ce que je dis où se dit non la vérité, mais la vérité de cette relation…» (Réponses, p. 167). Leur seule chance de suppléer à leur irréalisme et leur duplicité, qui ont pour corollaires l’inefficacité pratique et l’aveuglement, c’est de prendre conscience de leur position ambiguë dans l’espace social : partie intégrante des dominants, en tant que détenteurs d’un fort capital culturel — voire d’un certain capital social et/ou économique —, mais relégués dans la fraction dominée, puisque dépourvus de pouvoir politique ou économique, ils sont enclins à contester l’ordre établi et à se sentir solidaires des déclassés, mais ils n’ont pas intérêt à ce que soit bouleversée une société dans laquelle ils occupent un rôle prestigieux. Pour avoir méconnu la subordination du champ intellectuel au champ du pouvoir, Sartre s’est condamné à ne percevoir les déterminismes sociaux qui ont pesé sur Flaubert qu’à travers le prisme du conditionnement familial, ne pouvant ainsi comprendre que l’opposition entre Gustave et son frère aîné est homologue de celle entre l’écrivain Flaubert et l’écrivain bourgeois. Vingt ans après ces analyses parues dans Scolies, Bourdieu met l’accent sur la projection de Sartre sur cet «idiot de la famille» : c’est pour conjurer son angoisse d’écrivain, liée à cette position paradoxale dans le champ du pouvoir, qu’il développe le mythe de l’artiste créateur ; et le sociologue de dénoncer ce «narcissisme par procuration» (Les Règles de l’art, Seuil, 1992 ; «Points», 1998, p. 312).
Cette situation structuralement équivoque prédispose les intellectuels à jouer le rôle de porte-parole. Toutefois, parler pour les autres, c’est parler «en leur faveur, mais aussi à leur place», de sorte que ces intermédiaires «sont portés à tromper, le plus souvent de bonne  foi, aussi bien ceux dont ils parlent que ceux à qui ils parlent» (Esquisse d’une théorie de la pratique, p. 226). C’est ici mettre l’accent sur l’une des contradictions de l’engagement sartrien qu’a examinées Benoît Denis dans Littérature et engagement de Pascal à Sartre (Seuil, «Points», 2000 ; cf. pp. 59-62). Au reste, cet engagement est des plus ambigus : la position radicale de l’intellectuel engagé que Sartre invente à partir de 1945 n’a pu s’imposer au sein du champ intellectuel comme de l’espace social qu’au prix d’un compagnonnage tumultueux avec le PC (Cf. Anna Boschetti, Sartre et «Les Temps Modernes» : une entreprise intellectuelle, éditions de Minuit, «Le Sens commun», 1985, pp. 137-144) qui a contraint «l’intellectuel pétitionnaire et solidaire» à lui servir de «caution symbolique» (P. Bourdieu, Contre-feux 2. Pour un mouvement social européen, éditions Raisons d’agir, 2001, p. 10) et l’a conduit à commettre les erreurs les plus communément dénoncées. Quant à la philosophie même de l’engagement, dans plusieurs travaux majeurs (de l’Esquisse d’une théorie de la pratique jusqu’aux Raisons pratiques), Bourdieu récuse son irréalisme abstrait. Pour lui, Sartre constitue en effet la meilleure illustration de «l’anthropologie imaginaire du subjectivisme» (Le Sens pratique, Minuit, 1980, p. 71) : dans L’Etre et le Néant, le monde de la praxis se réduit à un univers imaginaire dans lequel se projette librement une conscience définie comme pur projet ; même dans la Critique de la raison dialectique, le dualisme et le «volontarisme activiste» (p.73) de Sartre lui font privilégier la praxis individuelle — et, partant, rejeter l’objectivisme sociologique. Or, concevoir l’acte engagé comme le produit d’un choix volontaire et non déterminé par des facteurs conjoncturels et/ou les conditions sociales d’existence relève d’«un moralisme de l’intention pure» proprement inconcevable pour le sociologue : «On ne peut pas fonder des vertus durables sur une décision de la conscience pure, c’est-à-dire, à la manière de Sartre, sur quelque chose comme un serment…» (Raisons pratiques, Seuil, 1994 ; rééd. «Points», 1996, pp. 164 et 238). Seule l’émergence d’univers sociaux autonomes tels que le champ philosophique, le champ littéraire ou le champ scientifique, régis par une logique anti-économique selon laquelle prévalent les bénéfices symboliques, a permis de créer durablement les conditions économiques et sociales de la production de l’universel.
foi, aussi bien ceux dont ils parlent que ceux à qui ils parlent» (Esquisse d’une théorie de la pratique, p. 226). C’est ici mettre l’accent sur l’une des contradictions de l’engagement sartrien qu’a examinées Benoît Denis dans Littérature et engagement de Pascal à Sartre (Seuil, «Points», 2000 ; cf. pp. 59-62). Au reste, cet engagement est des plus ambigus : la position radicale de l’intellectuel engagé que Sartre invente à partir de 1945 n’a pu s’imposer au sein du champ intellectuel comme de l’espace social qu’au prix d’un compagnonnage tumultueux avec le PC (Cf. Anna Boschetti, Sartre et «Les Temps Modernes» : une entreprise intellectuelle, éditions de Minuit, «Le Sens commun», 1985, pp. 137-144) qui a contraint «l’intellectuel pétitionnaire et solidaire» à lui servir de «caution symbolique» (P. Bourdieu, Contre-feux 2. Pour un mouvement social européen, éditions Raisons d’agir, 2001, p. 10) et l’a conduit à commettre les erreurs les plus communément dénoncées. Quant à la philosophie même de l’engagement, dans plusieurs travaux majeurs (de l’Esquisse d’une théorie de la pratique jusqu’aux Raisons pratiques), Bourdieu récuse son irréalisme abstrait. Pour lui, Sartre constitue en effet la meilleure illustration de «l’anthropologie imaginaire du subjectivisme» (Le Sens pratique, Minuit, 1980, p. 71) : dans L’Etre et le Néant, le monde de la praxis se réduit à un univers imaginaire dans lequel se projette librement une conscience définie comme pur projet ; même dans la Critique de la raison dialectique, le dualisme et le «volontarisme activiste» (p.73) de Sartre lui font privilégier la praxis individuelle — et, partant, rejeter l’objectivisme sociologique. Or, concevoir l’acte engagé comme le produit d’un choix volontaire et non déterminé par des facteurs conjoncturels et/ou les conditions sociales d’existence relève d’«un moralisme de l’intention pure» proprement inconcevable pour le sociologue : «On ne peut pas fonder des vertus durables sur une décision de la conscience pure, c’est-à-dire, à la manière de Sartre, sur quelque chose comme un serment…» (Raisons pratiques, Seuil, 1994 ; rééd. «Points», 1996, pp. 164 et 238). Seule l’émergence d’univers sociaux autonomes tels que le champ philosophique, le champ littéraire ou le champ scientifique, régis par une logique anti-économique selon laquelle prévalent les bénéfices symboliques, a permis de créer durablement les conditions économiques et sociales de la production de l’universel.
Dans Les Règles de l’art, Bourdieu estime que, pour comprendre l’«effet Sartre», à savoir le triomphe de l’écrivain-philosophe engagé que l’après-guerre a érigé en prophète d’une nouvelle religion, l’existentialisme — ou, mieux, en prophète des temps modernes ! —, il faudrait analyser «les conditions sociales de l’apparition de la demande sociale d’une prophétie pour intellectuels : conditions conjoncturelles, comme les expériences de rupture, de tragique et d’angoisse associées aux crises collectives et individuelles nées de la guerre, de l’occupation, de la résistance et de la libération ; conditions structurales, comme l’existence d’un champ intellectuel autonome doté de ses institutions propres de reproduction (Ecole normale supérieure) et de légitimation (revues, cénacles, éditeurs, académies, etc.), donc capable de soutenir l’existence indépendante d’une "aristocratie de l’intelligence", séparée du pouvoir, voire dressée contre les pouvoirs , et d’imposer et de sanctionner une définition particulière de l’accomplissement intellectuel» (p. 350,n.). A «la doxa intellectualocentrique», il oppose ainsi le «concept d’arbitraire culturel» (Réponses, p. 145) : tout comme n’importe quel autre champ, le champ intellectuel est mû par des passions, des intérêts et des croyances socialement déterminés. La croyance en la toute-puissance de la pensée ou au créateur incréé s’explique donc — sans s’y réduire, car il n’y a pas de pensée mécaniste chez Bourdieu — par la position dominante de la philosophie et de Sartre dans le champ intellectuel. Autrement dit, ses prises de position (sa philosophie de la liberté tout entière, et la notion de «projet originel» en particulier) comme son «hubris du penseur absolu» (RA, p. 313) sont à mettre en relation avec sa position d’«intellectuel total», qui a été conquise grâce à un sens pratique extra-ordinaire : après avoir réussi à transgresser les frontières entre professeur et créateur d’une part, philosophie et littérature d’autre part, Sartre accomplit «une action historique extrêmement importante, qui consiste à unifier des univers séparés, à constituer une sorte de champ intellectuel global» dans lequel, en s’appuyant sur des instances externes (public cultivé, forces politiques de gauche — c’est-à-dire, surtout, un parti communiste dont il se rapproche), il impose ses vues à ses adversaires (Camus, Bataille, Blanchot, Merleau-Ponty…).
Nous sommes maintenant en mesure de percevoir la différence entre le constructivisme de Bourdieu et la phénoménologie sartrienne, dans le prolongement de laquelle il se situe néanmoins (nous y reviendrons) : avec la notion de stratégie, il prend ses distances vis-à-vis de ce qu’il considère comme un volontarisme subjectiviste en posant que le sens de l’orientation sociale est socialement acquis. Ce qui, ramené au cas de Sartre, peut se formuler ainsi : son habitus petit-bourgeois (parisien élevé dans le culte des lettres par un grand-père agrégé d’allemand, il a suivi ensuite un cursus scolaire conforme à ses origines — au cours duquel, ayant découvert les auteurs contemporains, il se détache des classiques, sans pour autant renoncer à être le Hugo du XXe siècle) le prédisposait à se mouvoir avec aisance dans la République des lettres, à opérer, par rapport au champ intellectuel des années trente, «de ces transgressions de la règle prévues par la règle» («Le Fonctionnement…», p. 20).
La socio-analyse des intellectuels que Bourdieu a commencé d’élaborer au moment où, dans l’Esquisse d’une théorie de la pratique, il s’interrogeait sur la relation objectiviste de l’ethnologue à son objet d’étude repose sur un «mode de pensée génétique et générique» (Réponses, p. 108). Pour l’auteur des Méditations pascaliennes (Seuil, 1997), la meilleure façon de lutter contre l’implicite est de recourir à cette double historicisation qui consiste à situer les prises de position dans l’histoire collective (genèse du champ et des 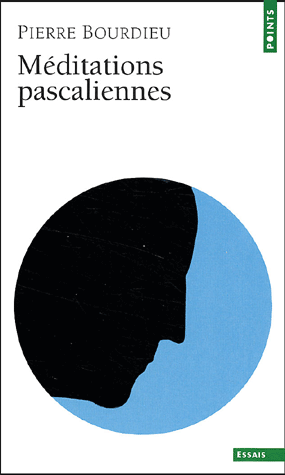 catégories de pensée) et dans une histoire individuelle (étude d’une trajectoire faite de placements et de déplacements qui ne peuvent se comprendre que si l’on ajuste le système des dispositions subjectives au système des positions objectives — c’est-à-dire si l’on prend en compte cette intériorisation de l’histoire collective qu’est l’habitus). L’impensé qui sous-tend le rapport de l’intellectuel à son objet est de trois ordres : il ressortit à la doxa épistémologique, celle-là même qui, propre au champ philosophique, est corrélative de la doxa générique (doxa scolastique) ; enfin, il est lié à l’habitus primaire, dont il vient d’être question dans le paragraphe précédent.
catégories de pensée) et dans une histoire individuelle (étude d’une trajectoire faite de placements et de déplacements qui ne peuvent se comprendre que si l’on ajuste le système des dispositions subjectives au système des positions objectives — c’est-à-dire si l’on prend en compte cette intériorisation de l’histoire collective qu’est l’habitus). L’impensé qui sous-tend le rapport de l’intellectuel à son objet est de trois ordres : il ressortit à la doxa épistémologique, celle-là même qui, propre au champ philosophique, est corrélative de la doxa générique (doxa scolastique) ; enfin, il est lié à l’habitus primaire, dont il vient d’être question dans le paragraphe précédent.
Tout d’abord, la doxa propre à l’univers scolastique qui a le premier conquis son autonomie éclaire l’ethos et le discours philosophique de Sartre : celui qui, somme toute, a toujours respecté la barrière scolastique entre sujet et objet (pour-soi/en-soi, praxis/pratico-inerte) partage avec ses pairs l’illusion de la toute-puissance de la raison pure, à ce point libératrice qu’elle permet à elle seule de cerner les limites de la connaissance objective, et, partant, souscrit plus ou moins consciemment à ces présupposés de la réflexion philosophique traditionnelle que sont l’affirmation de la philosophie comme fondement des autres discours, le refus de toute historicisation (la «pensée antigénétique» de Sartre s’inscrit en droite ligne du «refus husserlien de toute genèse du sujet absolu» cf. Sens pratique, p.84 (note) et Les règles de l’art, p.312) et de l’objectivation du sujet de l’objectivation. Quant à la disposition scolastique, elle est engendrée par la skholè, cette disponibilité constitutive de tous les champs savants : tout penseur occupe une position privilégiée, dans la mesure où la nécessaire coupure épistémologique se double d’une coupure sociale. Ce rapport distancié au monde est renforcé par un lieu d’enfermement scolastique par excellence, l’Ecole normale supérieure, dont il décrit ainsi les effets dans ses Méditations pascaliennes : «Les effets de l’enfermement scolastique, redoublés par ceux de l’élection scolaire et de la cohabitation prolongée d’un groupe très homogène socialement, ne peuvent que favoriser une distance intellectualocentrique à l’égard du monde : la coupure sociale et mentale ne se voit jamais aussi bien, paradoxalement, que dans les tentatives, souvent pathétiques et éphémères, pour rejoindre le monde réel, notamment à travers des engagements politiques (stalinisme, maoïsme, etc.) dont l’utopisme irresponsable et la radicalité irréaliste attestent qu’ils sont encore une manière de dénier les réalités du monde social» (p. 53).
D’après le sociologue, les errements du Sartre de l’après-guerre s’enracinent dans la vie indépendante qu’il a menée entre 1924 et 1928, dans ce que Simone de Beauvoir appelle une «insouciance», une «disponibilité» qu’«il était tentant de […] confondre avec une souveraine liberté» (La Force de l’âge, Gallimard, 1960, p. 24). Dans son Esquisse pour une auto-analyse, l’ancien normalien revient à la charge contre cette École «dite normale et prétendue supérieure» — pour reprendre une formule de Nizan dont il se déclare plus proche que de Sartre —, qui permettait aux élus de «se consacrer en toute innocence» à leur mission «de magistère universel de l’intelligence» : «ces sortes d’enfants prodiges par décret se croyaient conférer, à vingt ans, les privilèges et les obligations du génie» (p. 39).
Rien d’étonnant, dans ces conditions, à ce que l’intellectuel lui serve de modèle anthropologique. A plusieurs reprises, P. Bourdieu insiste sur le fait que l’homme sartrien est la projection de sa vision de l’intellectuel : pour lui, ce «professionnel de la conscience voué à l’illusion de la "conscience sans inertie", sans passé et sans extérieur» (Le Sens pratique, p. 77), n’a de cesse que de soustraire l’être humain à toute détermination, que d’en faire — contre Marx et Freud ! — un être inconditionné «pour affirmer la transcendance de l’ego contre "ce que Comte appelait le matérialisme, c’est-à-dire l’explication du supérieur par l’inférieur"» . L’Etre et le Néant, surtout, est l’universalisation d’un point de vue singulier : «Sartre convertit en structure ontologique, constitutive de l’existence humaine dans son universalité, l’expérience sociale de l’intellectuel, paria privilégié, voué à la malédiction (bénie) de la conscience qui lui interdit la coïncidence béate avec lui-même et de la liberté qui le met à distance de sa condition et de ses conditionnements». Dans cette ontologie, l’antinomie pour-soi/en-soi sert d’opérateur de distinction. L’intellectuel étant l’incarnation du Pour-soi, il n’est point de situation ou de position qu’il ne puisse dominer : la distance étant constitutive de son être, il se différencie de la bourgeoisie comme du peuple, transforme sa marginalisation sociale en affirmation de sa liberté et va jusqu’à retourner à son avantage sa relation au Parti communiste, s’instituant «conscience fondatrice du parti» pour «s’assurer ainsi un brevet de vertu révolutionnaire» sans pour autant hypothéquer «la pleine liberté d’une adhésion élective qui se vit comme seule capable de se fonder en raison» (RA, pp. 349-350).
Parce que Sartre a développé une philosophie du sujet tout-puissant et d’une liberté inconditionnelle qui est celle, transposée à l’homme, du Dieu de Descartes, parce qu’il a inventé le mythe du «créateur incréé» — et, ce faisant, radicalisé le credo des intellectuels —, il leur a fourni leur idéologie professionnelle. La doxa intellectualiste à laquelle le philosophe-idéologue a donné une formulation extrémiste présuppose encore une foi démesurée dans le logos et le langage. Dans cette perspective, savoir c’est vouloir (dimension éthique), et vouloir c’est pouvoir (dimension politique) — lequel pouvoir s’exerce par le biais du langage : parler, c’est agir. Ce dernier dogme, corrélatif du scholastic bias, contient en germes deux principaux dangers. Le premier, que Bourdieu appelle le campus radicalism, est «la propension à un révolutionnarisme sans objet et sans effet», c’est-à-dire «à prendre des révolutions dans l’ordre des mots, ou des textes, pour des révolutions dans l’ordre des choses» (Contre-feux 2, p. 35). Le second est le penchant au terrorisme : le logocentrisme s’accompagne d’une volonté de puissance qui, non seulement trouve à s’exprimer au sein du champ intellectuel même, mais en plus cherche des débouchées dans le champ politique, c’est-à-dire dans un domaine où les affrontements ne sont pas que verbaux, où la violence n’est pas que symbolique (cf. Questions de sociologie, p. 66).
Avant même, dans son auto-analyse posthume, d’opposer la réflexivité critique de Karl Kraus aux dérives de cette «figure exemplaire de l’intellectuel» qui a inventé «la mythologie de l’intellectuel libre» (p. 37), le sociologue trouve regrettable que ceux qui surestiment leur liberté et leur pouvoir opposent un refus irrationnel à l’objectivation. Cet hubris entraîne les intellectuels à l’ancienne vers la dérive prophétique, travers qui consiste à abuser de son capital social pour intervenir dans un domaine hors de sa compétence spécifique. Dans sa critique des «spécialistes en généralités», Bourdieu rejoint M. Foucault, qui raillait «ces politiques de la docte ignorance» regroupées sous le nom d’engagement : «Quand on est tant soit peu au courant en linguistique, en histoire, en sociologie, en ethnologie et en philosophie, en économie, on ne peut plus faire des topos à la Sartre» (CFDT aujourd’hui, n° 100, mars 1991, p. 120). Ce qui revient à prendre clairement position en faveur d’un nouveau type d’engagement, celui de l’intellectuel spécifique — dont il se pose comme le plus digne représentant aujourd’hui, lui qui possède une réelle compétence technique dans des disciplines multiples et variées des sciences humaines.
Le différend Bourdieu/Sartre
Inéluctablement, Bourdieu se heurte à la difficulté majeure engendrée par la construction même de la position idéaltypique de Sartre : se définissant en définissant, il est amené à opérer des simplifications abusives. Se positionnant par rapport au modèle de l’intellectuel (à la)Sartre qui a marqué ses années de formation, il se consacre avant tout à ce qu’il est convenu d’appeler le «premier Sartre» — sans pour autant prendre le soin d’analyser en détail Situations, II —, et, lorsqu’il s’aventure à évoquer la Critique de la raison dialectique (1960) ou L’Idiot de la famille (1971-1972), c’est de façon plus ou moins schématique ou partielle : outre que dans des ouvrages aussi volumineux que l’Esquisse d’une théorie de la pratique ou, plus encore, Le Sens pratique, on aurait pu s’attendre à ce que la Critique de la raison dialectique soit traitée autrement qu’en trois ou quatre pages et moins de dix notes, on ne peut qu’être surpris que la méthode biographique de Sartre ne soit presque exclusivement abordée qu’au travers des pages de L’Etre et le Néant sur la psychanalyse existentielle (quatrième partie, chap. II, section I) et d’un extrait de L’Idiot de la famille paru dans Les Temps Modernes sous le titre de «La Conscience de classe chez Flaubert» (nos 240-241, mai-juin 1966). Il va de soi que rien  n’empêchait le sociologue, après avoir lu les trois volumes de l’étude, de reconsidérer son point de vue dans Les Règles de l’art. Qui plus est, ne pas tenir compte de Situations, II dans son intégralité — ou, comme le fait G. Mauger, ne se référer qu’à la seule «Présentation» des Temps Modernes (1er octobre 1945) — et passer sous silence les deux textes sur les intellectuels recueillis dans Situations, VIII («Plaidoyer pour les intellectuels» et «L’Ami du peuple»), c’est passer à côté d’une pensée et d’une action complexes qui n’ont cessé d’évoluer — ou, du moins, c’est s’exposer au réductionnisme.
n’empêchait le sociologue, après avoir lu les trois volumes de l’étude, de reconsidérer son point de vue dans Les Règles de l’art. Qui plus est, ne pas tenir compte de Situations, II dans son intégralité — ou, comme le fait G. Mauger, ne se référer qu’à la seule «Présentation» des Temps Modernes (1er octobre 1945) — et passer sous silence les deux textes sur les intellectuels recueillis dans Situations, VIII («Plaidoyer pour les intellectuels» et «L’Ami du peuple»), c’est passer à côté d’une pensée et d’une action complexes qui n’ont cessé d’évoluer — ou, du moins, c’est s’exposer au réductionnisme.
Certes, l’auteur de Situations, VIII déplore la disparition des intellectuels universalistes au profit des spécialistes (cf. «Plaidoyer pour les intellectuels», 1965, in Situations, VIII, Gallimard, 1972, p. 377). Il est certain aussi que, dans ces mêmes Situations, VIII, puis dans le film réalisé par A. Astruc et M. Contat (Gallimard, 1977, p. 12), Sartre fait son mea culpa, après un mouvement de mai 68 qui a remis les intellectuels en question : il reconnaît qu’il est un intellectuel classique, à savoir un «type qui tire une bonne conscience de sa mauvaise conscience par les actes (qui sont en général des écrits) que celle-ci lui fait faire en d’autres domaines» (p. 461) et qui, tout en se prétendant porte-parole des opprimés, se contente de tenir des discours théoriques. Il en arrive à la conclusion suivante : «Il faut d’abord qu’il se supprime en tant qu’intellectuel. […]. Il faut qu’il mette ce qu’il a pu retirer des discours qui lui ont appris la technique de l’universel directement au service des masses. Il faut que les intellectuels apprennent à comprendre l’universel qui est désiré par les masses dans la réalité, dans le moment, dans l’immédiateté» (p. 467). Quant à lui, son âge lui interdit de rien faire d’autre que poursuivre sa somme sur Flaubert… Il n’hésite d’ailleurs pas à confier qu’il ne faut attendre de lui aucune métamorphose, vu qu’il ne saurait pas plus aller à l’encontre d’une œuvre qui constitue son intérêt idéologique que d’un passé — et plus particulièrement d’une enfance — qui le conditionne. De quoi ne pas décevoir le sociologue ! D’autant que, dans la deuxième conférence du Plaidoyer pour les intellectuels, il décrit à sa façon la situation de dominé qu’occupe l’intellectuel dans le champ du pouvoir, invariant sociologique que Bourdieu n’ exposera qu’un peu plus tard : «La classe dominante l’ignore : elle ne veut connaître de lui que le technicien du savoir et le petit fonctionnaire de la superstructure» (p. 400).
Toujours est-il que, pour en revenir à l’entretien intitulé «L’Ami du peuple» (1970), Sartre n’en ajoute pas moins qu’il s’est «mis progressivement en question comme intellectuel» (p. 468) et qu’il pense avoir évolué. Cinq ans plus tôt, il affirmait déjà que, les arguties étant susceptibles de masquer des préjugés intériorisés dans l’enfance, l’intellectuel doit soumettre sa pensée à un type de réflexivité qui consiste à s’appréhender comme universalité singulière : la dénonciation du racisme en-soi, par exemple, ne saurait offrir une garantie suffisante contre un racisme profondément ancré en soi. Et, conscient de son être-situé, il doit «sans cesse lutter contre l’idéologie sans cesse renaissante» par «une autocritique perpétuelle» (p. 420) et par une série de tâches ayant pour objectif de soutenir concrètement l’action des classes populaires (détruire l’image fausse, parce qu’idéologique, qu’elles se font d’elles-mêmes ; «user du capital-savoir donné par la classe dominante» — c’est moi qui souligne — pour faire accéder à la culture et à des professions intellectuelles un maximum de membres des classes défavorisées ; poser des fins universelles à réaliser par tous «contre tout pouvoir», et s’en faire le gardien — pp. 423-24). C’est le moment de rappeler son action concrète en cette fin des années soixante et jusqu’au crépuscule de sa vie : il dirige et distribue La Cause du peuple, prend part au lancement de Libération, s’engage dans des luttes politiques et humanitaires qu’on ne saurait réduire à cette image d’Epinal qui hante les mémoires, celle de l’Intellectuel perché sur un tonneau afin de haranguer les ouvriers de la Régie Renault, renversant par là même, au cours d’un exercice périlleux d’équilibriste, l’archétype du philosophe qui, tel Diogène, ressent souvent le besoin de se réfugier dans son tonneau… Sans compter qu’il suffit, même à un lecteur inattentif, de parcourir, si ce n’est l’ensemble d’un volume dont il ne faut pas oublier que le sous-titre est «Autour de 68», du moins la table des matières, pour saisir en quoi des écrits peuvent se transformer en véritables brûlots, en pavés jetés dans la mare d’une époque avec laquelle le philosophe-écrivain est à la fois aux prises et en prise, dans laquelle il situe toute chose et se situe : «Viêt-Nam : le tribunal Russell», «Achever la gauche ou la guérir ?», «L’Idée neuve de Mai 1968», «Les Communistes ont peur de la révolution», «Il n’y a pas de bon gaullisme…», «"Le Tiers Monde commence en banlieue"», «Israël, la gauche et les Arabes»…
l’idéologie sans cesse renaissante» par «une autocritique perpétuelle» (p. 420) et par une série de tâches ayant pour objectif de soutenir concrètement l’action des classes populaires (détruire l’image fausse, parce qu’idéologique, qu’elles se font d’elles-mêmes ; «user du capital-savoir donné par la classe dominante» — c’est moi qui souligne — pour faire accéder à la culture et à des professions intellectuelles un maximum de membres des classes défavorisées ; poser des fins universelles à réaliser par tous «contre tout pouvoir», et s’en faire le gardien — pp. 423-24). C’est le moment de rappeler son action concrète en cette fin des années soixante et jusqu’au crépuscule de sa vie : il dirige et distribue La Cause du peuple, prend part au lancement de Libération, s’engage dans des luttes politiques et humanitaires qu’on ne saurait réduire à cette image d’Epinal qui hante les mémoires, celle de l’Intellectuel perché sur un tonneau afin de haranguer les ouvriers de la Régie Renault, renversant par là même, au cours d’un exercice périlleux d’équilibriste, l’archétype du philosophe qui, tel Diogène, ressent souvent le besoin de se réfugier dans son tonneau… Sans compter qu’il suffit, même à un lecteur inattentif, de parcourir, si ce n’est l’ensemble d’un volume dont il ne faut pas oublier que le sous-titre est «Autour de 68», du moins la table des matières, pour saisir en quoi des écrits peuvent se transformer en véritables brûlots, en pavés jetés dans la mare d’une époque avec laquelle le philosophe-écrivain est à la fois aux prises et en prise, dans laquelle il situe toute chose et se situe : «Viêt-Nam : le tribunal Russell», «Achever la gauche ou la guérir ?», «L’Idée neuve de Mai 1968», «Les Communistes ont peur de la révolution», «Il n’y a pas de bon gaullisme…», «"Le Tiers Monde commence en banlieue"», «Israël, la gauche et les Arabes»…
Sans solidarité avec lui-même (Carnets de la drôle de guerre, Gallimard, 1995, p. 512), l’intellectuel Sartre a constamment pratiqué l’autocritique, allant jusqu’à écrire des livres contre lui-même (cf. Les Mots, Gallimard, 1964, p. 135). Il a toujours analysé son être-situé afin de prévenir la renaissance de l’idéologie, comme, par exemple, dans le film d’A. Astruc et M. Contat : bien que faisant partie des anti-chiens de garde qui, néanmoins, «demeurent élitistes même quand ils professent des idées révolutionnaires», et que, ayant décidé de poursuivre L’Idiot de la famille, il ait continué d’écrire pour un public bourgeois, par un tout autre côté de lui-même, il refuse ses «intérêts idéologiques», se conteste lui-même comme intellectuel classique, «refuse d’être un écrivain élitiste qui se prend au sérieux» ; de sorte que, ayant ainsi réussi à dépasser son être-de-classe, il se retrouve parfois «au milieu des hommes qui luttent contre la dictature bourgeoise» (pp. 11-12)… La duplicité ne caractérise donc pas tant son être que son être-situé : l'(h)ontologie sartrienne n’a rien d’abstrait. Déchiré entre son être-bourgeois et son être-pour-le-peuple, il est, plus généralement, dans la situation de tout intellectuel contemporain, qui n’est qu’un produit historique traduisant les contradictions d’une société donnée : ressentant d’emblée une contradiction entre l’égalitarisme humaniste qu’on lui a inculqué et son statut privilégié (qu’il soit héritier ou élu qui a franchi toutes les étapes de la sélection «démocratique», son savoir lui confère une certaine importance sociale), il est en plus soumis à une tension entre son particularisme de classe (il est le représentant d’un ordre établi qu’il a intériorisé) et son universalisme professionnel, tension que connaît également la société bourgeoise, puisqu’elle est en quête de valeurs universelles tout en veillant à imposer son idéologie. Au XVIIIe siècle, un tel conflit était inconnu et de la classe bourgeoise et de ses intellectuels organiques : la bourgeoisie se percevait comme classe universelle et les philosophes des lumières considéraient comme universelles les valeurs qu’ils revendiquaient (c’est ainsi que, par exemple, sous le nom de «Liberté», ils entendaient, en fait, la liberté de faire du commerce et d’exprimer leurs opinions —et par là même de contester le pouvoir autoritaire de l’Ancien Régime). Deux siècles plus tard, la «fausse universalité bourgeoise» (S. VIII, p. 405), qui propose une vision essentialiste de l’homme, détachée des conditions politiques, économiques et sociologiques, et conforme aux intérêts des dominants, est l’apanage des faux intellectuels, dont la contestation est truquée, puisqu’ils ne sont pas les partisans du non, mais du «non mais» (p. 408) : ce sont ceux-là mêmes qui, à l’époque de la guerre d’Algérie, se disaient anticolonialistes, mais condamnaient, au nom de ce principe universel qu’est le refus de la violence, la rebellion indigène — se faisant ainsi les complices de la violence impérialiste, sous prétexte qu’elle ne se manifestait pas de façon aussi éclatante. En revanche, la contestation des intellectuels authentiques — c’est-à-dire de ceux qui, se saisissant dans le malaise comme des monstres (p. 410), ignorent la conscience de survol (p. 413) et jouent le rôle d’inquiéteurs — doit déboucher sur la praxis collective : tous leurs efforts doivent tendre à inscrire des valeurs abstraites dans la réalité concrète — à mettre en place une universalité concrète indéniablement utopique. D’ailleurs, dans la note qui inaugure la quatrième partie de ces Situations, VIII («Les Intellectuels»), Sartre assigne à l’intellectuel la tâche de dépasser le «stade de la conscience malheureuse (idéalisme, inefficacité)» (p. 374) pour se transformer en «compagnon radicalisé des forces populaires» (p. 373), ce qu’il deviendra à la seule condition «qu’il prenne une distance nouvelle par rapport à […] son être social et qu’il comprenne qu’aucune dénonciation politique ne pourrait compenser le fait qu’il est objectivement l’ennemi des masses»…
En fait, comme l’indique Jean-François Louette dans la partie de son ouvrage Sartre contra Nietzsche portant sur l’engagement sartrien, «il existe chez Sartre une tension constante et irrésolue entre pensée de l’universel et pensée du situé» . C’est ainsi que, même dans la «Présentation» des Temps Modernes — largement mais partialement citée par G. Mauger —, l’écrivain-philosophe précise clairement qu’il ne faut nullement «aller chercher dans un ciel intelligible» les «valeurs d’éternité» dont il se réclame (Situations, II, Gallimard, 1948, rééd. 1980, p. 15). L’écrivain-clerc qui se livre «à la contemplation exclusive de l’Eternel» (p. 133), tel que le décrit Julien Benda, est celui du Moyen Age… «En situation dans son époque» (p. 127), l’écrivain, qui vise «l’universalité du genre humain» au travers du «groupe concret et historique de ses lecteurs» (p. 129), n’ignore pas qu’il est une conscience malheureuse condamnée à jouer le rôle de «parasite de "l’élite" dirigeante» (p. 130), conflit dont la forme objective est l’antagonisme entre son public réel (conservateurs) et son public virtuel (progressistes). Aussi, dans la dernière partie de Qu’est-ce que la littérature ?, Sartre entreprend-il de se situer par rapport à l’esprit objectif de l’entre-deux-guerres, à savoir la culture comme pratico-inerte, l’ensemble des canons esthétiques et des impératifs culturels qu’expriment les œuvres de cette époque : se rattachant à la troisième génération d’écrivains contemporains, qui, en ces années tragiques, ont brutalement découvert leur historicité, il s’applique durant plusieurs dizaines de pages à montrer en quoi ces «écrivains métaphysiciens» (p. 251) ne pouvaient que remettre en question la philosophie idéaliste, l’humanisme abstrait et le mythe romantique du «grand homme» dans lesquels ils avaient baigné à vingt ans, en quoi ils ne pouvaient écrire que «des romans de situation» (p. 252) ressortissant à une «littérature des situations extrêmes» (p. 250), diamétralement opposée à celle «des situations moyennes» (p. 249) que pratiquaient leurs aînés, des écrivains bourgeois dont la littérature de consommation était «une littérature d’alibi» (p. 213) dominée par les thèmes de la famille, de l’amour et du voyage. Dès lors que ces pages font suite à un précis d’histoire sociale de la littérature centré sur la condition des écrivains et, surtout, leurs rapports avec leur public, comment peut-on soutenir que la pensée de Sartre est antigénétique ?
Du pratico-inerte il est encore question dans le troisième tome de L’Idiot de la famille — que Bourdieu a passé sous silence —, où, associant dialectique et psychanalyse existentielle, Sartre met en œuvre cette «anthropologie structurelle et historique», définie dans le  premier tome de la Critique de la raison dialectique, qui vise à rendre compte des relations entre individuel et collectif : alternant les phases d’analyse et de compréhension pour dérouler la spirale d’une vie, il commence son essai par les conditions objectives qui ont déterminé l’enfant et le termine par l’objectivation de l’œuvre, la totalisation de l’artiste dans un roman (Madame Bovary) qui imprègne l’époque en lui présentant un miroir critique de la bourgeoisie et de l’idéal romantique. Comme son Art-névrose est situé par rapport au milieu familial et à l’Esprit objectif, à savoir les normes esthétiques de la période post-romantique qu’il a intériorisées, le Flaubert de Sartre, pas plus que l’homme sartrien en général, n’est un être inconditionné. Seulement, si l’auteur de Madame Bovary est «universalisé par son époque», il l’exprime singulièrement : la praxis transcende le pratico-inerte. C’est pourquoi, dans un article intitulé «Pour une anthropologie concrète : Sartre contre Bourdieu» (Les Temps Modernes, n° 596, nov.-déc. 1997), Arnaud Tomes estime que, contrairement au sujet bourdieusien, «le sujet sartrien n’est pas seulement un point dans un espace social»(p. 48) : parce qu’il s’est arrêté au stade descriptif du pratico-inerte et qu’il n’a pas réussi à «sortir de la vision aristotélicienne de l’hexis qui s’actualise» (p. 49), Pierre Bourdieu s’est condamné à ne pas pouvoir rendre compte du changement social, et plus particulièrement à ne pouvoir expliquer «pourquoi tout petit-bourgeois n’est pas Flaubert ou même pourquoi Flaubert devient écrivain, et non médecin comme son père».
premier tome de la Critique de la raison dialectique, qui vise à rendre compte des relations entre individuel et collectif : alternant les phases d’analyse et de compréhension pour dérouler la spirale d’une vie, il commence son essai par les conditions objectives qui ont déterminé l’enfant et le termine par l’objectivation de l’œuvre, la totalisation de l’artiste dans un roman (Madame Bovary) qui imprègne l’époque en lui présentant un miroir critique de la bourgeoisie et de l’idéal romantique. Comme son Art-névrose est situé par rapport au milieu familial et à l’Esprit objectif, à savoir les normes esthétiques de la période post-romantique qu’il a intériorisées, le Flaubert de Sartre, pas plus que l’homme sartrien en général, n’est un être inconditionné. Seulement, si l’auteur de Madame Bovary est «universalisé par son époque», il l’exprime singulièrement : la praxis transcende le pratico-inerte. C’est pourquoi, dans un article intitulé «Pour une anthropologie concrète : Sartre contre Bourdieu» (Les Temps Modernes, n° 596, nov.-déc. 1997), Arnaud Tomes estime que, contrairement au sujet bourdieusien, «le sujet sartrien n’est pas seulement un point dans un espace social»(p. 48) : parce qu’il s’est arrêté au stade descriptif du pratico-inerte et qu’il n’a pas réussi à «sortir de la vision aristotélicienne de l’hexis qui s’actualise» (p. 49), Pierre Bourdieu s’est condamné à ne pas pouvoir rendre compte du changement social, et plus particulièrement à ne pouvoir expliquer «pourquoi tout petit-bourgeois n’est pas Flaubert ou même pourquoi Flaubert devient écrivain, et non médecin comme son père».
On ne peut, il est vrai, que rejoindre A. Tomes lorsqu’il démonte le modèle ultra-subjectiviste que Bourdieu construit de la philosophie sartrienne : la Critique de la raison dialectique ne contient aucune trace de ce qui, dans L’Etre et le Néant, est susceptible d’être interprété comme un dualisme (pour-soi transparent/en-soi opaque), vu que la praxis et la matière n’existent qu’à l’intérieur du champ pratique (la première adapte les moyens à des fins qui lui échappent parfois, comme c’est le cas dans la praxis-processus, et la seconde n’est pas pure matière mais matière ouvrée). Précisons qu’il y a d’autant moins dualisme que l’on ne saurait figer les couples antinomiques dialectique/anti-dialectique, praxis/pratico-inerte, singularité/altérité, identité/aliénation : l’originalité de la dialectique sartrienne tient à ce que, ignorant le dépassement des contradictions, elle réside dans un tournoiement incessant des ensembles pratiques, un mouvement circulaire qui fait se succéder indéfiniment totalisations et détotalisations. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que, dès ses débuts, Sartre a voulu élaborer une philosophie concrète qui s’oppose à la fois à l’idéalisme et au matérialisme. A ce propos, il est symptomatique que ce soit à un cours de Brunschvicg que, dans un exposé intitulé «Nietzsche est-il philosophe ?», il présente pour la première fois ses idées sur la contingence. C’est dire sa volonté, dès 1928, de s’inscrire à l’encontre de ce rationalisme absolu qui nie la perception des choses comme étape propédeutique de la connaissance : pour reprendre la terminologie de Meyerson — auquel l’auteur de Situations, I s’attaque également dans son article sur Husserl —, Brunschvicg ignore les réalités particulières pour s’attacher aux essences intelligibles, c’est-à-dire aux objets ; or, c’est à la revalorisation des choses que va s’attacher le jeune philosophe après avoir lu Husserl, pour qui la conscience dissout d’autant moins les choses qu’il n’y a pas de «sens» sans les propriétés de l’objet visé par elle. Et dès lors que Sartre intègre l’objectif au subjectif, il va à l’encontre du clivage classique entre sujet connaissant et objet de connaissance : récusant l’egologie cartésienne et même husserlienne, c’est au sein du sujet qu’il introduit un clivage (pour-soi/en-soi ; praxis/exis). Peut-on encore, dans ces conditions, parler de dualisme ?
En revanche, il est impossible de souscrire à la démarche d’A. Tomes qui revient à opposer à un réductionnisme un autre réductionnisme : pas plus que la pensée de Sartre ne peut être qualifiée de subjectiviste, celle de Bourdieu ne saurait être taxée d’objectiviste. En effet, en pleine période structuraliste, dans l’Esquisse d’une théorie de la pratique (1972), Bourdieu affirme qu’il faut dépasser l’opus operatum vers le modus operandi : il ne faut pas s’arrêter à la seule analyse des structures structurées, mais s’intéresser à la façon dont elles deviennent structures structurantes au travers de l’habitus. Dans cette perspective, qu’il va développer progressivement, ce n’est qu’en fonction des propriétés acquises à l’état objectivé (héritage) ou incorporé (les jugements et les comportements, constitutifs de l’ethos et de l’hexis corporelle, qui se sont formés au sein de la famille — habitus primaire — et du milieu scolaire, universitaire et professionnel — habitus secondaire) que le sujet social se fait une idée — plus ou moins juste — de ses possibles, qu’il se représente — avec plus ou moins de lucidité — le système des positions à l’intérieur du champ auquel il croit se destiner mais auquel, en fait, il est pré-destiné, ainsi que les contraintes inhérentes à ce champ (génériques, thématiques et formelles, en ce qui concerne le champ littéraire). Cependant, les mécanismes de la reproduction n’ont rien de systématique, la dialectique des dispositions et des positions ne saurait se réduire à un déterminisme total : l’actualisation de l’hexis dépend de deux facteurs, l’état du champ — ou, plus exactement, de la structure des possibilités objectivement offertes, à un moment donné, par le marché et l’espace hiérarchisé des positions à l’intérieur du champ — et les dispositions envers l’héritage et l’habitus, qui varient en fonction de la relation au père et/ou à la mère, de la place occupée au sein de ce champ particulier qu’est la famille… L’habitus n’étant fonctionnel que si se trouvent reproduites les conditions objectives et les dispositions subjectives dans lesquelles il a été produit, on comprendra qu’il n’est pas un destin : il n’est pas impossible, en effet, de rencontrer diverses situations d’inadéquation entre les conditions de production et les conditions d’actualisation de l’habitus, qui entraînent des effets d’hysteresis. Indépendamment de ces circonstances exceptionnelles, les habitus singuliers diffèrent des habitus génériques pour la simple raison qu’ils se restructurent perpétuellement en vue de s’adapter aux conjonctures nouvelles, déterminant ainsi des trajectoires inévitablement divergentes, puisque les expériences vécues par les membres d’un même groupe social ou d’une même classe d’âge ne peuvent être absolument homogènes.
Pour revenir au cas de Flaubert, tel que Bourdieu l’expose dans Les Règles de l’art, il s’est construit comme sujet créateur à la fois grâce à ses déterminations et contre elles. Alors que, doté d’un capital économique et d’un capital culturel, et ayant bénéficié d’une éducation bourgeoise, il est prédisposé à faire carrière dans la médecine ou le droit, sa relation au père — qui, contrairement à ce que pense Sartre, encourage probablement la «vocation littéraire» de son fils cadet — et au frère aîné — qui incarne le Bourgeois honni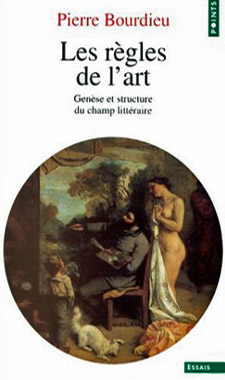 dont il sera le «parent pauvre» en tant qu’artiste — l’incline à se tourner vers l’univers des lettres, et, à l’intérieur de ce champ, à déroger une seconde fois en ne s’orientant pas vers l’art bourgeois ou le genre majeur qu’est la poésie, mais vers le roman, qu’il va néanmoins métamorphoser, en genre noble par le fait même de «bien écrire le médiocre» : cet idiot de la famille bourgeoise qui se trouve embarqué dans un espace social subordonné au champ du pouvoir — dans lequel il pouvait légitimement prétendre occuper une place conforme à ses origines — éprouve l’impérieux besoin de se distinguer ; aussi est-il amené à opérer une révolution éthique et esthétique en inventant un nouveau rôle social de l’artiste et en créant cette position originale qui consiste à dépasser les antinomies entre art et morale (bourgeoise), forme et sujet, art bourgeois et art social. Le fait que cet héritier soit prédisposé par sa trajectoire à «une vue plus haute et plus ample de l’espace des possibles» (p. 177) et qu’il cumule capital économique et capital social — qui lui permettent de se vouer tout entier à l’écriture et de mobiliser ses relations au besoin (que l’on se souvienne du procès de Madame Bovary…) —, mais encore capital culturel et, après le retentissement de Madame Bovary, capital symbolique, explique sans doute son «refus actif de toutes les déterminations associées à une position dominée dans le champ intellectuel» (p. 177), les dispositions aristocratiques qui lui font souhaiter être inclassable. Et inclassable, il l’est remarquablement, puisque son œuvre se situe singulièrement au carrefour des tendances classique, romantique, réaliste et parnassienne. Cette œuvre n’est donc le produit, ni de son habitus primaire, ni de son habitus secondaire, ni du champ littéraire, ni, plus généralement, de l’espace social : Flaubert est devenu Flaubert en faisant évoluer son habitus au contact d’un champ qu’il a contribué à transformer.
dont il sera le «parent pauvre» en tant qu’artiste — l’incline à se tourner vers l’univers des lettres, et, à l’intérieur de ce champ, à déroger une seconde fois en ne s’orientant pas vers l’art bourgeois ou le genre majeur qu’est la poésie, mais vers le roman, qu’il va néanmoins métamorphoser, en genre noble par le fait même de «bien écrire le médiocre» : cet idiot de la famille bourgeoise qui se trouve embarqué dans un espace social subordonné au champ du pouvoir — dans lequel il pouvait légitimement prétendre occuper une place conforme à ses origines — éprouve l’impérieux besoin de se distinguer ; aussi est-il amené à opérer une révolution éthique et esthétique en inventant un nouveau rôle social de l’artiste et en créant cette position originale qui consiste à dépasser les antinomies entre art et morale (bourgeoise), forme et sujet, art bourgeois et art social. Le fait que cet héritier soit prédisposé par sa trajectoire à «une vue plus haute et plus ample de l’espace des possibles» (p. 177) et qu’il cumule capital économique et capital social — qui lui permettent de se vouer tout entier à l’écriture et de mobiliser ses relations au besoin (que l’on se souvienne du procès de Madame Bovary…) —, mais encore capital culturel et, après le retentissement de Madame Bovary, capital symbolique, explique sans doute son «refus actif de toutes les déterminations associées à une position dominée dans le champ intellectuel» (p. 177), les dispositions aristocratiques qui lui font souhaiter être inclassable. Et inclassable, il l’est remarquablement, puisque son œuvre se situe singulièrement au carrefour des tendances classique, romantique, réaliste et parnassienne. Cette œuvre n’est donc le produit, ni de son habitus primaire, ni de son habitus secondaire, ni du champ littéraire, ni, plus généralement, de l’espace social : Flaubert est devenu Flaubert en faisant évoluer son habitus au contact d’un champ qu’il a contribué à transformer.
Puisqu’il ne s’agit pas ici d’entrer davantage dans le détail, venons-en au fait. La «dialectique de l’intériorité et de l’extériorité, c’est-à-dire de l’intériorisation de l’extériorité et de l’extériorisation de l’intériorité» (Esquisse d’une théorie de la pratique, p. 256), n’est pas la même chez Bourdieu que chez Sartre : tandis que, pour ce dernier, la relation dialectique s’établit, à l’intérieur du champ pratique, entre praxis (individuelle ou commune) et pratico-inerte, la première étant pourvue d’une force totalisatrice qui lui offre la constante possibilité de transcender la seconde, même si ses projets sont immanquablement appelés à être réifiés par les contre-finalités du monde matériel ou la force d’inertie des collectifs, Bourdieu, lui, dès 1972, définit la pratique comme la relation dialectique entre habitus et situation (cf. pp. 261-262), le premier s’ajustant à la seconde par une conduite intelligente, une stratégie plus ou moins adaptée selon le système de pratiques et de représentations intégrées, c’est-à-dire une connaissance sans conscience. Nous touchons ici ce qui fondamentalement sépare la pensée de Sartre et celle de Bourdieu : l’opposition entre sujet ontologique et sujet social. Le sujet sartrien est classique au sens où, irréductible, il ressortit encore à une métaphysique de la liberté — et donc à l’ontologie cartésienne. A la fois hexis et praxis, il est tantôt passif, tantôt actif, mais toujours libre : même en situation d’aliénation, il conserve son libre arbitre, puisque son intériorisation des structures sociales est volontaire (la praxis se fait hexis). Ainsi, dans un premier temps, c’est de son plein gré, ce qui ne signifie pas en toute conscience, que le Flaubert de Sartre adhère aux idées hexis de cette organisation sérielle qu’est la famille et de l’esprit objectif ; mais ensuite, il s’arrache au pratico-inerte pour choisir la passivité, la fuite dans l’imaginaire — choix qui, pour être conditionné, n’en est pas moins le produit d’une libre praxis. Enfin, Sartre se rattache d’autant plus à l’ontologie classique qu’il fait de la praxis individuelle le fondement de la praxis commune, c’est-à-dire de la dialectique historique. Quant au sujet social, à la fois inertie et spontanéité, collectif et individuel, c’est un «transcendantal historique dont les schèmes de perception et d’appréciation (les systèmes de préférence, les goûts) sont le produit de l’histoire collective et individuelle» (Les Structures sociales de l’économie, Seuil, 2000, p. 259). Il est plutôt informé par le modèle chomskyen de l’activité linguistique : sa réaction à une situation donnée n’est pas véritablement immédiate — comme le pensent les interactionnistes —, elle est spontanée tout en dépendant de l’appréhension qu’il en a suivant cette «matrice de perceptions, d’appréciations et d’actions» qu’est l’habitus (Esquisse d’une théorie…, p. 261) ; cette réponse, généralement élaborée de façon pré-réflexive, non par un sujet totalisateur ni une conscience pure qui poserait ses propres fins, mais par un «principe générateur de stratégies» (p. 257) — que l’on pourrait appeler, en réunissant deux termes jugés inconciliables par Kant, raison empirique —, est une performance qui actualise la compétence socialement acquise — et par là même extériorise cette extériorité intériorisée qu’est l’habitus. Et dans la mesure où cette compétence qui sous-tend le choix rationnel est limitée, Bourdieu rejoint le behavioriste H. Simon, dont il rejette pourtant la philosophie de l’action. On le voit, par sa volonté de dépasser les alternatives entre objectivisme et subjectivisme, déterminisme et liberté, passivité et activité, mécanisme et finalisme, Bourdieu prend ses distances vis-à-vis de la philosophie cartésienne et sartrienne comme de la sociologie rationaliste (Théorie de l’action rationnelle et individualisme méthodologique).
De cette divergence conceptuelle concernant le sujet pratique (projet organisateur/principe organisateur d’actions), il résulte que, si, pour l’écrivain-philosophe, l’espace social n’existe qu’à travers le projet d’une conscience singulière, au contraire, pour le sociologue, tout point de vue singulier n’existe que par rapport à un espace social particulier. Cependant, il faudrait analyser scrupuleusement ce que la vision bourdieusienne de l’art et du monde social doit à la philosophie du second Sartre : on s’apercevrait sans doute que l’habitus est pour le sujet social la synthèse passive «d’un univers de significations déjà constituées», que les œuvres sont des «productions sans totalisateur»… Mais si, dans l’Esquisse d’une théorie de la pratique (cf. p. 267), P. Bourdieu reconnaît très implicitement qu’il apprécie ces aspects de la Critique de la raison dialectique, il s’indigne que soit assignée à la sociologie «la tâche, fort suspecte parce que essentialiste, d’étudier la "socialité d’inertie"». En retour, faisant fi de ce que nous avons rappelé précédemment à propos de L’Idiot de la famille, il fait de Sartre un représentant — avec Lanson et les structuralistes !— d’un mode de pensée substantialiste suivant lequel les œuvres originales sont la création d’une individualité singulière (cf. «Champ du pouvoir, …», pp. 7-10 et 12-15, et RA, pp. 312-314). Au passage, il est amusant de noter qu’à l’antinomie sartrienne regardant/regardé, constitutive de la lutte intersubjective, succède cette autre, classant/classé, caractéristique de la lutte sociale. (Pour le dire autrement, dans son dialogue avec Sartre, se sentant classé dans la catégorie dévalorisante des techniciens du pratico-inerte, il réagit en le classant dans celle des essentialistes).
Cette réaction s’explique quand on connaît tous ses efforts pour redorer le blason d’une discipline qui, à l’époque où il passait brillamment l’agrégation de philosophie, était encore plus mal considérée que l’ethnologie. S’il n’a eu de cesse que d’en faire une science autonome, c’est principalement pour qu’elle pût tenir la dragée haute à une discipline reine méprisante. Qu’il ambitionne pour la sociologie la position dominante dans le champ intellectuel apparaît clairement à la (re)lecture de ses entretiens. Par exemple, lorsqu’il affirme que «la sociologie libère en libérant de l’illusion de la liberté, ou, plus exactement, de la croyance mal placée dans des libertés illusoires» (Choses dites, Minuit, 1987, p. 26), il faut entendre qu’elle permet de se prémunir contre l’erreur intellectualiste dans laquelle sombre la philosophie. (Mais en suggérant que la vraie liberté est celle que procure la sociologie, en louant les vertus et les bienfaits de la science sociale, en prônant le principe spinoziste qu’«une loi ignorée est une nature, un destin» et que, en revanche, «une loi connue apparaît comme la possibilité d’une liberté» , lui qui reconnaît avoir un «côté Aufklärer» et faire preuve d’un «optimisme un peu scientiste» (Respectivement Questions de sociologie, p.45; Les Usages sociaux de la science, INRA, 1997, p.59; "Questions à Pierre Bourdieu", in G. Mauger et L. Pinto, Lire les sciences sociales : 1989-1992, Belin, vol. 1, 1994, p.318), ne tombe-t-il pas dans l’illusion rationaliste qu’il a pourtant dénoncée avec véhémence ?). Qui plus est, dans ses Réponses à Loïc J.D. Wacquant, il va jusqu’à ranger le dévoilement sociologique parmi les grandes révolutions de la pensée, dont, bien évidemment, il exclut la philosophie : «Aux trois "blessures narcissiques" qu’évoquait Freud, celles qui ont été infligées à l’humanité par Copernic, Darwin et Freud lui-même, il faut ajouter celle que la sociologie nous fait souffrir, et spécialement lorsqu’elle s’applique aux "créateurs"» (p. 108). Selon cette logique, quelques lignes plus loin, il disqualifie la figure archétypale de l’intellectuel, sorte de Platon attardé dont le champ de production se circonscrit à ce domaine heuristiquement sans valeur qu’est la mythologie : Sartre «a produit la forme la plus accomplie du mythe fondateur du créateur incréé avec la notion de "projet originel" qui est à la notion d’habitus ce que le mythe de la genèse est à la théorie de l’évolution». Se profile ici une coupure épistémologique entre la sociologie — discours scientifique rigoureux — et les discours concurrents, rejetés dans la doxa. La meilleure illustration de cette stratégie épistémologique se trouve dans le préambule d’un article de Louis Pinto, qu’il convient de citer dans sa quasi-intégralité tant il est révélateur :
«"Foucault apporte aux gens ce dont ils avaient besoin : une synthèse éclectique où Robbe-Grillet, le structuralisme, la linguistique, Lacan, Tel Quel, sont utilisés tour à tour pour démontrer l’impossibilité d’une réflexion historique". Ce jugement peu bienveillant de Sartre sur Foucault illustre bien l’une des stratégies inhérentes à la polémique intellectuelle qui consiste à rabaisser le concurrent en "l’expliquant" par la seule loi du marché intellectuel. Ce que le rival menacé perçoit bien, quoique de façon confuse et imprécise […] : pour lui, les caractéristiques internes du discours nouveau sont moins pertinentes que l’accord de ce discours avec les attentes globales de ceux qu’il nomme vaguement "les gens". Or, au moment même où il croit découvrir des facteurs purement externes au principe de la réussite d’un nouvel entrant, adoptant ainsi cette posture réductrice souvent associée à l’idée commune de la démarche sociologique, Sartre reste prisonnier des limites que lui impose sa position puisqu’il interprète le clivage entre intellectuels dans la logique pure d’un débat théorique censé opposer la "structure" et l’"histoire", la "mort de l’homme" et le "sujet"… Lucide, cet "acteur" intéressé au premier chef à l’issue des luttes qui divisent le groupe des intellectuels longtemps dominé par lui discerne l’ensemble de ceux qui peuvent remettre en cause la domination, mais sa cécité consiste à ne pouvoir saisir les fondements objectifs de la transformation de l’espace au sein duquel s’affrontent les concurrents» («Tel quel. Au sujet des intellectuels de parodie», Actes de la recherche en sciences sociales, n° 89, oct. 1991, p. 66).
La dichotomie épistémo-axiologique est on ne peut plus manifeste : d’un côté, les non-initiés, dont les intuitions sont d’autant moins fondées qu’elles servent leurs intérêts particuliers, dont la cécité et la partialité ne peuvent que conduire à un réductionnisme polémique ; de l’autre, les savants, dont la clairvoyance et l’impartialité sont d’autant plus grandes qu’elles se fondent sur la connaissance des structures objectives du champ et des facteurs expliquant telle ou telle mutation. Pour sa part, Bourdieu prend l’exemple — qu’il rappelle encore dans Les Usages sociaux de la science (cf. p. 37) — de la polémique ayant opposé, à la fin des années cinquante, Raymond Aron et Simone de Beauvoir : tous deux présentaient comme objectif un point de vue particulier hostile aux «intellectuels de gauche» (L’Opium des intellectuels) ou à «la pensée de droite» (articles des Temps Modernes). Les implications théoriques qu’il en induit sont formulées dans Les Règles de l’art : les «objectivations partielles de la polémique», tout comme «la complaisance narcissique de la critique projective» (p. 317), dues au défaut d’auto-objectivation, sont un obstacle au vrai travail d’objectivation du champ intellectuel qu’opère le sociologue — qui, comme Bourdieu ne cesse de le marteler plus ou moins ouvertement, fort de son expérience du monde social et de sa pratique scientifique, qu’il sait rendre réflexive au besoin, ne saurait connaître le même aveuglement que les intellectuels profanes.
Et pourtant, depuis une vingtaine d’années, de nombreux chercheurs ont démontré que l’impensé n’est pas absent des travaux mêmes de Pierre Bourdieu. Ce qui ressort en premier lieu, c’est son ethnocentrisme intellectuel, qui est un dominocentrisme. Selon Bernard Lahire, il ne perçoit le rapport au monde social qu’à travers le prisme d’un schème d’action particulier : lui-même impliqué dans le jeu, le sociologue généralise abusivement un contexte spécifique, celui des luttes pour la conquête du pouvoir au sein d’espaces sociaux prestigieux ; en outre, conformément à la «réduction logocentrique de la réflexion à la réflexion savante», il est amené à privilégier le seul genre d’habitude non réflexive . Dans Le Savant et le Populaire. Misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature (1989), Claude Grignon et Jean-Claude Passeron, quant à eux, mettaient en exergue son légitimisme, c’est-à-dire le point de vue dominant à partir duquel il appréhende la culture populaire. Enfin, l’ouvrage collectif dirigé par Bernard Lahire, Le Travail sociologique de Pierre Bourdieu. Dettes et critiques (1999), nous fournit deux autres analyses critiques, l’une sur l’approche bourdieusienne des médias et l’autre sur La Misère du monde (1993). Tout d’abord, pour Cyril Lemieux, le principal grief à l’encontre de la télévision, à savoir son emprise sur une grande partie de la population, est empreint de misérabilisme. Arrêtons-nous ensuite sur l’article de Jean-Claude Monod. Pour lui, si le sociologue confond avec l’ensemble des dominés les agents sociaux qui constituent la «main gauche» de l’Etat — universalisant ainsi des intérêts spécifiques —, c’est parce qu’il partage avec eux la même contradiction structurale : méprisé par les dominants, il se sent proche de dominés dont il est objectivement séparé en tant qu’auxiliaire de l’ordre en place. En fait, l’opposition entre la «main gauche» et la «main droite» de l’Etat traduit le conflit intérieur entre son universalisme scientifique et son particularisme social de «dominé parvenu» (p. 238). Ce déchirement permet de comprendre son agressivité à l’encontre de la «noblesse d’Etat» et du champ intellectuel. Ajoutons que cette position structuralement ambiguë de dominant-dominé explique que, tout comme Sartre, il s’intéresse à Flaubert. Cette identification projective est d’autant plus forte qu’il est plus ou moins consciemment persuadé d’avoir introduit dans le domaine des sciences humaines et, plus largement, dans l’ensemble du champ intellectuel, les mêmes ruptures libératrices. En effet, il se présente constamment comme celui qui, conformément à ce modèle de grand novateur, a toujours su dépasser les alternatives auxquelles il a été confronté : entre Marx et Weber, Sartre et Foucault, intellectuel irresponsable (Sartre) et maître à penser le social (Durkeim), intellectuel total et intellectuel-militant, fatalisme scientifique et volontarisme utopiste (sociologisme et utopisme), sociologie conservatrice et sociologie populiste, mécanisme et finalisme, objectivisme (holisme et structuralisme) et subjectivisme (individualisme méthodologique et phénoménologie), histoire littéraire et critique, approches critiques externes et approches internes… Si bien qu’on pourrait être tenté de prendre pour une dénégation cette phrase d’Homo academicus (Minuit, 1984) : «la sociologie porte trop peu à l’illusion pour que le sociologue puisse se penser un seul instant dans le rôle du héros libérateur» (p. 16).
Le plus troublant est que Bourdieu semble s’appuyer sur cette position qu’il a voulu exceptionnelle, corrélative d’un intérêt à l’universel pour se soustraire habilement au débat critique : J.-C. Monod insiste sur le fait que, adoptant un point de vue surplombant — renforcé par une stratégie qui consiste à déprécier comme idéologique toute résistance, toute réaction à son discours scientifique —, le sociologue entend situer sans être situé, classer sans être classé, relativiser — en rapportant les prises de position aux positions occupées dans le champ — sans toutefois être l’objet d’une relativisation. C’est dire le risque que la sociologie s’oriente vers le même hégémonisme que celui reproché à la philosophie. Toujours selon J.-C. Monod, même dans La Misère du monde (1993), où, malgré la volonté affichée de rendre la parole aux exclus, Bourdieu réintroduit la distinction qu’il a récusée entre philosophie et sens commun, nous avons affaire à un discours qui, «tout en se développant, pose sa propre démarche comme norme implicite à l’aune de laquelle il mesure tout, non seulement les discours médiatiques, intellectuels et politiques, mais toutes les pratiques sociales et étatiques […]» (p. 233). En tant qu’il a parfois tendance à s’ériger en archidiscours, il est certain que le discours sociologique s’expose à la même critique que le discours philosophique. Cette dérive, et ce n’est pas là le moindre des paradoxes, est favorisée par un choix méthodologique des plus rigoureux et féconds : la construction d’objets transversaux, qui procède de fait à l’extension du champ d’étude de la sociologie. Le «tout est social» rejoint alors le «tout est philosophique». C’est ainsi que, dans Les Structures sociales de l’économie (Seuil, 2000), l’étude du marché de la maison offre la possibilité à Bourdieu de dépasser les frontières entre sociologie, anthropologie, économie et politique. Mieux, il s’attaque à la suprématie du discours économique : en mettant entre parenthèses «les modèles déductifs des économistes qui sont de simples mises en forme et en formules mathématiques d’une intuition de sens commun»(p. 13) — tout en se défendant d’un quelconque «annexionnisme réductionniste» — et en contestant «la vision antihistorique de la science économique» (p. 16) pour «construire une définition réaliste de la raison économique» (p. 234), il intègre ce «fait social total» (Mauss) qu’est la pratique économique dans une économie générale des pratiques humaines.
Au reste, revenant sur ses débuts, celui qui n’ a pas été épargné par l’aristocratisme normalien (cf. p. 130) confie dans son auto-analyse (2004) que sa lutte pour réunifier une discipline atomisée en de nombreuses «spécialités» l’a fait se trouver «présent à la totalité du champ des sciences sociales», de sorte que son entreprise a pu «apparaître comme une manière de poursuivre les ambitions démesurées de l’intellectuel total» (p. 89)… Ira-t-on pour autant jusqu’à dire avec Aron que Bourdieu souffre du même handicap que Sartre, celui d’avoir eu «"un système de concepts trop tôt"» (p. 48) ? En fait, nostalgique du «temps où on identifiait sociologie et socialisme» (cf. Propos sur le champ politique, PUL, 2000, p. 43) — où, dans les années trente exactement, Marcel Mauss était consulté par les socialistes —, Bourdieu souhaite que les sciences sociales retrouvent une place importante dans la société — au risque que le sociologue ressemble au philosophe platonicien qui détient les rênes du char étatique, à savoir, comme l’avance J.-C. Monod, qu’il substitue «à l’actuelle technocratie "main droite" des énarques et des élites arrogantes, une technocratie "main gauche", exprimant l’universalisation des intérêts confondus du sociologue et des fonctionnaires sociaux de l’Etat» (p. 250).
Dans ces conditions, la radicalité de sa contestation n’est peut-être pas plus authentique que celle de l’intellectuel classique, dans la mesure où la véhémence verbale masque la revendication institutionnelle d’un dominant-dominé : tout comme Sartre, qui, dans Situations, IV (Gallimard, 1964), avoue ne pas souhaiter la disparition de l’ordre bourgeois (cf. p.147), Bourdieu est un révolté, et non pas un révolutionnaire. D’où les deux nouveaux paradoxes que souligne J.-C. Monod : d’une part, le sociologue doit sa position dominante dans le champ intellectuel à sa lutte contre la domination symbolique ; d’autre part, se contentant de dénoncer la violence symbolique, il n’offre aux dominés qu’une libération formelle. Dans cette perspective, il n’est pas étonnant que, poussé par sa mauvaise conscience — qui n’est qu’une forme exacerbée de conscience malheureuse —, il s’en prenne à tout l’univers symbolique. De même, sa fascination pour Sartre est alors tout à fait compréhensible : ce grand contestataire qui est «l’incarnation la plus accomplie» de «l’intellectuel autonome» (La Noblesse d’État, Minuit, 1989, p. 302) s’est toujours défié de la reconnaissance institutionnelle, ni universitaire, ni professeur au Collège de France… Peu après la mort de l’illustre philosophe-écrivain, dans le numéro de Libération daté du 31 mars 1983, il laisse d’ailleurs libre cours à son enthousiasme pour «ce qu’il y avait sans doute de plus rare et de plus précieux dans le modèle sartrien de l’intellectuel et de plus réellement antithétique aux dispositions "bourgeoises" : le refus des pouvoirs et des privilèges mondains(s’agirait-il du prix Nobel) et l’affirmation du pouvoir et du privilège proprement intellectuels de dire non à tous les pouvoirs temporels».
Deux figures différentes d’intellectuel critique
Ainsi, pas plus que le philosophe, le sociologue n’échappe à l’impensé. Néanmoins, plutôt que de verser dans un relativisme polémique et aporétique, il s’agit maintenant d’aller plus loin que l’«incompatibilité d’habitus» avouée dans la revue French Cultural Studies (1993) et de saisir en quoi et pourquoi Bourdieu s’est constamment défini par rapport à Sartre, le critiquant pour mieux s’en différencier. (Et on a pu constater que, s’il était encore besoin de le démontrer, le novateur, dans quelque domaine que ce soit, ne fait pas forcément partie des commentateurs les plus avisés : derrière l’analyse apparaît en filigrane le réquisitoire et/ou l’apologie pro domo, positionnement dans le champ oblige). Dans cette optique, il faudrait reconstituer précisément sa trajectoire qui n’a de sens que par rapport aux différents états du champ intellectuel dans lesquels il a été amené à adopter ses prises de position. D’une telle étude il ressortirait sans doute que ses critiques les plus virulentes à l’encontre de Sartre appartiennent à ce qu’on pourrait appeler les phases de formation et de consécration de son itinéraire : durant la première, qui correspond aux années 60 et 70, selon un mouvement de double translation théorique, il se sert du structuralisme pour prendre ses distances vis à vis de la philosophie sartrienne et, inversement, il se prémunit contre l’objectivisme en élaborant un constructivisme structuraliste qui s’enracine en partie dans la phénoménologie sartrienne ; au cours de la seconde (années 80), il se voit élu à la chaire de sociologie du Collège de France et de plus en plus reconnu à l’intérieur d’un champ intellectuel duquel ont disparu les figures dominantes que représentaient Sartre, Barthes et Foucault. Cet itinéraire, toutes proportions gardées, ressemble à celui de l’écrivain-philosophe : après avoir conquis, grâce à une œuvre considérable, les bénéfices symboliques adéquats, après avoir fait de la sociologie une discipline majeure et, partant, s’être hissé à une position dominante dans le champ sociologique comme dans le champ intellectuel, l’auteur d’une sociologie qu’il a toujours voulu engagée (décrire les mécanismes de la domination symbolique, c’est, non pas les abolir, mais les dénoncer), s’est logiquement, et de plus en plus à partir de 1995, rattaché à la tradition «d’ouvrir sa gueule» sur laquelle il dialogue avec Günter Grass, Prix Nobel de littérature 1999 (Le Monde du 3 décembre 1999/entretien diffusé sur Arte le 5 décembre). Reconnu, il accorde de nombreux entretiens — dont certains contiennent des fragments d’«autobiographie parlée» (expression de Ph. Lejeune à propos de Sartre), notamment ses Réponses à Loïc J.D. Wacquant, qui proposent une «anthropologie réflexive» — et prend position dans de multiples conférences, qu’il regroupe sous le titre, non pas de Situations, mais de Contre-feux.
Et le succès que Bourdieu a rencontré durant ses dernières années s’explique tout autant que celui de Sartre à la Libération, par des conditions conjoncturelles qui viennent renforcer des conditions structurelles : d’une part, l’avènement du néo-libéralisme, avec son  cortège d’avatars boursiers, de «restructurations», etc., le retour de la droite au pouvoir en France entre 1993 et 1997, et en particulier les mesures impopulaires prises par le gouvernement Juppé, ont suscité la forte demande sociale d’un éclairage sociologique, dont témoignent les chiffres de vente des petits volumes publiés par les éditions Raisons d’agir, ainsi que des mouvements sociaux dans toute l’Europe, dont celui de décembre 1995, significativement qualifié de «décembre» des intellectuels français par J. Duval, C. Gaubert, F. Lebaron, D. Marchetti et F. Pavis (Raisons d’agir, 1998) ; d’autre part, dominant un champ sociologique devenu autonome, le sociologue a été non seulement professeur au Collège de France et directeur d’études à l’EHESS, mais en plus a dirigé la collection «Le Sens commun» aux éditions de Minuit, les éditions Raisons d’agir et les Actes de la recherche en sciences sociales, revue dont l’influence n’a cessé de croître depuis 1975… Remarquons toutefois que la reconnaissance sociale dont bénéficie Bourdieu, plus tardive que celle de Sartre, est aussi moins tapageuse. Contrairement à son illustre prédécesseur, le sociologue — qui n’a pas été conditionné, il est vrai, par un habitus secondaire suivant lequel prime une originalité qui confine à la marginalité, y compris en matière de mœurs — s’est beaucoup moins exposé, intervenant dans les médias, mais beaucoup moins fréquemment tout de même, se gardant, en outre, de donner dans l’exhibitionnisme et de dépasser les limites de son domaine de compétence. De ce point de vue, il faut souligner la cohérence d’une action qui s’inscrit dans une même logique anticapitaliste : qu’il joue le trouble-fête à la télévision (en particulier dans l’émission «Arrêt sur image» du 23 janvier 1996, animée par Daniel Schneidermann) et dans la presse (on se souvient qu’en 1998 le numéro spécial des Inrockuptibles dont il était le rédacteur en chef invité s’intitulait «Joyeux Bordel» !), qu’il proteste contre la suppression d’une émission de France-Culture («Staccato»), qu’il soutienne Arte ou Télérama, qu’il se mette à l’écoute des dominés, qu’il s’attaque au modèle américain, à l’ambiguïté de l’Europe ou à la dépolitisation de la politique française actuelle, il s’agit toujours de lutter — avec une générosité toute sartrienne — contre une violence qui est économique, certes, mais aussi — et de plus en plus — symbolique. En particulier, il s’agit, contre l’hégémonie du champ économique et du champ médiatique, de sauvegarder l’autonomie de tous les champs de production intellectuelle, c’est-à-dire de préserver la vertu essentielle qui rend les intellectuels indispensables à la lutte sociale : l’intérêt à l’universel.
cortège d’avatars boursiers, de «restructurations», etc., le retour de la droite au pouvoir en France entre 1993 et 1997, et en particulier les mesures impopulaires prises par le gouvernement Juppé, ont suscité la forte demande sociale d’un éclairage sociologique, dont témoignent les chiffres de vente des petits volumes publiés par les éditions Raisons d’agir, ainsi que des mouvements sociaux dans toute l’Europe, dont celui de décembre 1995, significativement qualifié de «décembre» des intellectuels français par J. Duval, C. Gaubert, F. Lebaron, D. Marchetti et F. Pavis (Raisons d’agir, 1998) ; d’autre part, dominant un champ sociologique devenu autonome, le sociologue a été non seulement professeur au Collège de France et directeur d’études à l’EHESS, mais en plus a dirigé la collection «Le Sens commun» aux éditions de Minuit, les éditions Raisons d’agir et les Actes de la recherche en sciences sociales, revue dont l’influence n’a cessé de croître depuis 1975… Remarquons toutefois que la reconnaissance sociale dont bénéficie Bourdieu, plus tardive que celle de Sartre, est aussi moins tapageuse. Contrairement à son illustre prédécesseur, le sociologue — qui n’a pas été conditionné, il est vrai, par un habitus secondaire suivant lequel prime une originalité qui confine à la marginalité, y compris en matière de mœurs — s’est beaucoup moins exposé, intervenant dans les médias, mais beaucoup moins fréquemment tout de même, se gardant, en outre, de donner dans l’exhibitionnisme et de dépasser les limites de son domaine de compétence. De ce point de vue, il faut souligner la cohérence d’une action qui s’inscrit dans une même logique anticapitaliste : qu’il joue le trouble-fête à la télévision (en particulier dans l’émission «Arrêt sur image» du 23 janvier 1996, animée par Daniel Schneidermann) et dans la presse (on se souvient qu’en 1998 le numéro spécial des Inrockuptibles dont il était le rédacteur en chef invité s’intitulait «Joyeux Bordel» !), qu’il proteste contre la suppression d’une émission de France-Culture («Staccato»), qu’il soutienne Arte ou Télérama, qu’il se mette à l’écoute des dominés, qu’il s’attaque au modèle américain, à l’ambiguïté de l’Europe ou à la dépolitisation de la politique française actuelle, il s’agit toujours de lutter — avec une générosité toute sartrienne — contre une violence qui est économique, certes, mais aussi — et de plus en plus — symbolique. En particulier, il s’agit, contre l’hégémonie du champ économique et du champ médiatique, de sauvegarder l’autonomie de tous les champs de production intellectuelle, c’est-à-dire de préserver la vertu essentielle qui rend les intellectuels indispensables à la lutte sociale : l’intérêt à l’universel.
En exhortant tous les producteurs autonomes à défendre leur singularité pour mieux défendre les valeurs universelles, plus encore dans ses Contre-feux 2 (cf. p. 91) que dans Les Règles de l’art (cf. «Pour un corporatisme de l’universel», pp. 543-558), Bourdieu rejoint le théoricien de l’universel singulier, qui reprend à son compte le rapport établi par Hegel entre universel et individuel. Ce faisant, il ne craint pas d’affronter un nouveau paradoxe, qui consiste à prendre sciemment le parti de celui dont il a constamment stigmatisé le prophétisme : «Il n’est personne qui ait cru plus que Sartre à la mission de l’intellectuel et qui ait fait plus que lui pour apporter à ce mythe intéressé la force de la croyance sociale. Ce mythe, et Sartre lui-même, qui, dans la splendide innocence de sa générosité, en est à la fois le producteur et le produit, le créateur et la créature, je crois (par un effet, sans doute, de la même innocence) qu’il faut le défendre à tout prix, envers et contre tous, et peut-être avant tout contre une interprétation sociologiste de la description sociologique du monde intellectuel : même s’il est encore beaucoup trop grand pour les plus grands des intellectuels, le mythe de l’intellectuel et de sa mission universelle est une de ces ruses de la raison historique qui font que les intellectuels les plus sensibles aux profits d’universalité peuvent être conduits à contribuer, au nom de motivations qui peuvent n’avoir rien d’universel, au progrès de l’universel» (2004, p. 40). Non sans précaution (au moyen d’une parenthèse ajoutée au texte publié en 1993 dans French Cultural Studies), et tout en combinant l’authenticité requise par l’auto-analyse et une argumentation qui s’appuie sur Hegel, le sociologue prend le risque de se faire taxer d’élitisme en faisant de l’intellectuel l’incarnation de l’universel. On ne peut en effet que s’interroger sur ce privilège : en dehors de toute perspective idéaliste (néo-platonicienne, si l’on veut), dans nos démocraties, en quoi l’intellectuel serait-il le seul ou le mieux à même de défendre des valeurs universelles ? A quel poids social et symbolique prétendre dans une société médiatico-marchande où le modèle républicain et universaliste est mort ? Ce qui explique sans doute la conclusion désabusée que Serge Halimi tire dans le numéro du Monde diplomatique paru en septembre dernier : «Mais peut-être ferait-on mieux de ne plus penser que les intellectuels seront nécessairement à l’avant-garde des prochaines transformations sociales» (n° 618, p. 31).
Cependant, puisqu’un tel défaitisme est absent chez Bourdieu, il importe de considérer à présent les raisons pour lesquelles il s’est engagé dans le débat public et la façon dont il a renouvelé les pratiques intellectuelles. Dans ses Contre-feux 2 (2001), le sociologue avoue lui-même que son habitus scientifique l’a longtemps soustrait à sa responsabilité d’intellectuel : «J’ai souvent mis en garde contre la tentation prophétique et la prétention des spécialistes des sciences sociales à annoncer, pour les dénoncer, les maux présents et à venir. Mais je me suis trouvé conduit par la logique de mon travail à outrepasser les limites que je m’étais assignées au nom d’une idée de l’objectivité qui m’est apparue peu à peu comme une forme de censure» (p. 75). De sorte que, occupant une position qui lui donne voix au chapitre social, celui en qui Jacques Bouveresse voit «le dernier grand représentant en France» d’un «modèle de l’intellectuel critique […] devenu désuet» , a assumé sous les feux médiatiques ce point d’aboutissement d’une sociologie critique que constitue la posture inconfortable, anti-wébérienne par excellence, de savant et politique (Cf. Jacques Bouveresse, Bourdieu, savant & politique, Agone, 2004, pp. 67 et 97-133). D’où les réserves émises, et pas seulement par les adversaires de Bourdieu : l’engagement ne nuit-il pas à la qualité scientifique des travaux ? Pire, ne révèle-t-il pas leur nature fondamentalement idéologique ? Sans négliger les fragilités d’une sociologie de combat (selon la formule de Philippe Corcuff dans son essai paru en 2003), dont il a déjà été question et sur lesquelles nous reviendrons encore, on peut opposer à ces interrogations, somme toute légitimes, qu’elles ne sauraient faire oublier la puissance théorique et pratique de l’œuvre , que Bourdieu lui-même a pris soin de distinguer textes de militant et ouvrages scientifiques et qu’une telle pratique a pour corollaire paradoxal le développement de l’imagination sociologique (fonction heuristique de «stimulant cognitif») .
Pour l’auteur des Contre-feux 2, deux raisons expliquent principalement cet engagement devenu total : l’urgence de la situation — qui lui fait retrouver des accents sartriens pour stigmatiser le silence responsable des économistes (p. 9) et exalter «le volontarisme universaliste» (p. 23) — et le triomphe des nouveaux chiens de garde. En effet, parce que le néo-libéralisme assoit sa domination économique sur une domination symbolique à laquelle contribuent une armée de mercenaires intellectuels, professionnels européens du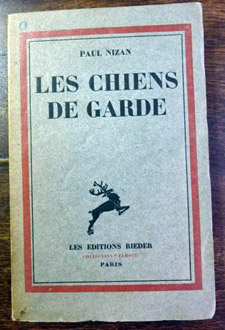 lobbying ou têtes pensantes regroupées en think tanks, pour lui il est grand temps de libérer l’énergie critique qui circule en vase clos, de faire réagir l’homo academicus et par là même de «faire sortir les savoirs hors de la cité savante» (p. 9). Faute de quoi disparaîtraient l’un des derniers obstacles au triomphe complet du totalitarisme néolibéral ainsi que, du reste, ce type d’intellectuel défini par Sartre comme «quelqu’un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas et qui prétend contester l’ensemble des vérités reçues et des conduites qui s’en inspirent au nom d’une conception globale de l’homme et de la société […]». Dès les années soixante, l’auteur des Situations, VIII soulignait déjà que ce qui sous-tend l’anti-intellectualisme est la volonté d’anéantir les adversaires pensants du capitalisme : «Chez nous, on annonce leur mort : sous l’influence d’idées américaines, on prédit la disparition de ces hommes qui prétendent tout savoir : les progrès de la science auront pour effet de remplacer ces universalistes par des équipes de chercheurs rigoureusement spécialisés» (p. 377). Et Sartre était conscient que ces techniciens supérieurs du savoir pratique ne pourraient se multiplier que si le pouvoir en place réussissait à aliéner l’université aux intérêts industriels et commerciaux. Or, depuis la fin du siècle dernier, règnent un anti-intellectualisme exacerbé et un mercantilisme institutionnel sans précédent. C’est pourquoi l’heure est à la revanche de ceux que Nizan qualifiait de chiens de garde, c’est-à-dire, non plus des professionnels de la pensée qui ont trahi leur mission en véhiculant la pensée bourgeoise, mais des journalistes et des intellectuels médiatiques qui font leur pâture des sujets à la mode : ce sont, déclare Bourdieu dans son entretien avec Hans Haacke, «des Zola qui lanceraient des "J’accuse" sans avoir écrit L’Assommoir ou Germinal, ou des Sartre qui signeraient des pétitions ou mèneraient des manifestations sans avoir écrit L’Etre et le Néant ou la Critique de la raison dialectique» (Libre-échange, Seuil, 1994, p. 58).
lobbying ou têtes pensantes regroupées en think tanks, pour lui il est grand temps de libérer l’énergie critique qui circule en vase clos, de faire réagir l’homo academicus et par là même de «faire sortir les savoirs hors de la cité savante» (p. 9). Faute de quoi disparaîtraient l’un des derniers obstacles au triomphe complet du totalitarisme néolibéral ainsi que, du reste, ce type d’intellectuel défini par Sartre comme «quelqu’un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas et qui prétend contester l’ensemble des vérités reçues et des conduites qui s’en inspirent au nom d’une conception globale de l’homme et de la société […]». Dès les années soixante, l’auteur des Situations, VIII soulignait déjà que ce qui sous-tend l’anti-intellectualisme est la volonté d’anéantir les adversaires pensants du capitalisme : «Chez nous, on annonce leur mort : sous l’influence d’idées américaines, on prédit la disparition de ces hommes qui prétendent tout savoir : les progrès de la science auront pour effet de remplacer ces universalistes par des équipes de chercheurs rigoureusement spécialisés» (p. 377). Et Sartre était conscient que ces techniciens supérieurs du savoir pratique ne pourraient se multiplier que si le pouvoir en place réussissait à aliéner l’université aux intérêts industriels et commerciaux. Or, depuis la fin du siècle dernier, règnent un anti-intellectualisme exacerbé et un mercantilisme institutionnel sans précédent. C’est pourquoi l’heure est à la revanche de ceux que Nizan qualifiait de chiens de garde, c’est-à-dire, non plus des professionnels de la pensée qui ont trahi leur mission en véhiculant la pensée bourgeoise, mais des journalistes et des intellectuels médiatiques qui font leur pâture des sujets à la mode : ce sont, déclare Bourdieu dans son entretien avec Hans Haacke, «des Zola qui lanceraient des "J’accuse" sans avoir écrit L’Assommoir ou Germinal, ou des Sartre qui signeraient des pétitions ou mèneraient des manifestations sans avoir écrit L’Etre et le Néant ou la Critique de la raison dialectique» (Libre-échange, Seuil, 1994, p. 58).
Ces pseudo-penseurs, que le sociologue nomme doxosophes en référence à Platon, sont imputables du même travers que dénonçait Sartre dans Situations, VIII : en jouant un rôle actif dans la société du spectacle, en collaborant avec les forces conservatrices — par le fait d’écrire dans des journaux et hebdomadaires de droite ou de soutenir la campagne présidentielle d’un candidat conservateur —, ou en s’instaurant les Défenseurs des Droits de l’Homme, se faisant ainsi les auxiliaires d’un humanitarisme d’alibi, d’un impérialisme occidental qui n’a de cesse que de pacifier et d’uniformiser la planète afin d’imposer le Nouvel Ordre économique (comment ignorer, par exemple, que, depuis la première guerre du Golfe, les interventions militaires sont à ce point humanitaires que les «forces libératrices» comportent des unités spéciales chargées de défendre les intérêts des pays dominants en concluant un maximum de marchés ?), ces essayistes mondains mettent l’universel dont ils se réclament en tant qu’intellectuels au service de l’ordre dominant. On remarquera d’ailleurs que, significativement, la disparition de Bourdieu n’a pas mis fin au réquisitoire. Ainsi, dans Existe-t-il une vie intellectuelle en France ? (Verdier, 2002), Jean-Claude Milner décrit «l’intellectuel d’aujourd’hui» comme «pusillanime devant les forts, dur aux faibles, ambitieux sans dessein, ignorant sous les oripeaux de la pédanterie, imprécis en style pointilleux, inexact en style détaillé» (p. 24). Dans Bourdieu, savant & politique (Agone, 2004), Jacques Bouveresse se montre encore plus polémique : «C’est le modèle de l’intellectuel déférent qu’adopte Sollers lorsqu’il caractérise notre époque comme étant "une époque de pluralités, d’incertitudes, de visages sans cesse nouveaux, de surprises, de croisements, de confrontations, de singularités irréductibles" et recommande à l’intellectuel d’accepter désormais, en les traitant sur un pied d’égalité, toutes les formes de contradiction et de débat, quelle que soit leur provenance et le degré de compétence et de sérieux de ceux qui expriment un point de vue différent du sien. Finkielkraut s’exprime de façon encore plus claire quand il suggère que, contrairement aux apparences, ce n’est pas au pouvoir abusif des médias que s’attaque Bourdieu. Ce contre quoi il réagit est ce qu’on peut appeler l’"incontrôlabilité démocratique"» (p. 69).
Ainsi, déplorant la déconsidération actuelle des intellectuels critiques, dans ses Contre-feux (Raisons d’agir, 1998), Bourdieu inscrit sa réflexion et son action dans le prolongement de celles menées par Marx, Nietzsche, Foucault et… Sartre ! Rien d’étonnant, donc, à ce que quelques formules attestent qu’il se rattache à la même sensibilité révoltée que Sartre, représentant comme lui «le sentiment du non», pour reprendre l’expression de Gracq dans Préférences (1961) : il est mû, en effet, par «une sorte de fureur légitime» (p. 7), «un sentiment de scandale» (p. 67)… Et il n’est guère difficile non plus de constater, surtout à la lumière de ses derniers textes, que le sociologue partage globalement la même conception de l’intellectuel que celle de l’écrivain-philosophe : il incarne «le gardien de la démocratie» pour l’un (S. VIII, p. 430), un contre-pouvoir critique pour l’autre (CF, p. 16). Au reste, Bourdieu se retrouve dans la même situation que Sartre, critiqué par la droite comme par la gauche, et préconise envers toute organisation politique la même position que Sartre envers le PC, «une collaboration dans la séparation» (Propos sur le champ politique, p. 105).
Toutefois, il reprend quelque distance vis-à-vis de ce «grand intellectuel irresponsable et en même temps magnifique» (p. 79) en posant que la pensée politique critique ne peut plus «être l’œuvre d’un seul, maître à penser livré aux seules ressources de sa pensée singulière» (CF 2, p. 36) : aux productions des groupements d’experts conservateurs (think tanks), à cet «universalisme de façade» (p. 38) que constitue la globalisation, il est urgent d’opposer le «travail collectif d’invention politique» (p.36) accompli par la réunion en «un véritable intellectuel collectif» (p. 35) d’«intellectuels résolument universalistes, c’est-à-dire réellement soucieux d’universaliser les conditions d’accès à l’universel»(p. 39). Cette tâche consiste à passer le discours économiste dominant au crible d’une triple critique — logique, sociologique et scientifique — et à résoudre des problèmes économiques, écologiques et culturels à l’échelle planétaire, même et surtout par le biais d’utopies réalistes. Et si, en raison du caractère scientifique que revêt aujourd’hui le discours dominant, Bourdieu estime que les savants doivent remplir le rôle prépondérant au sein de ce groupement d’intellectuels engagés, il n’en est pas moins persuadé que seuls les écrivains sont en mesure de «donner de la force symbolique, par les moyens de l’art, aux idées, aux analyses critiques» (p. 40). (Que l’on songe à Annie Ernaux, qui, dans ses autosociobiographies comme dans ses ethnotextes, met en scène les rapports de domination afin de les dénoncer ; à Valère Novarina, qui, dans L’Atelier volant ou L’Origine rouge, montre à l’œuvre le travail d’asservissement des langues mécaniques — que ce soit celle de l’habile et volubile Boucot, qui, dans une stichomythie bouffonne, cloue le bec à son ouvrier-sans-nom-et-sans-langue par une kyrielle de noms en «-ing», ou celle de la machine à dire voici, qui impose son flux significativement insensé — ; ou encore à Christian Prigent, qui confronte langagement et novlangue …).
Passant de la théorie à la pratique, il a donné l’exemple de ce que peut être un intellectuel collectif : éminent membre de l’ARESER (Association de réflexion sur les enseignements supérieurs et la recherche), qui a publié ses Diagnostics et remèdes urgents pour une  université en péril (Raisons d’agir, 1997), il a en outre collaboré (avec C. Debons, D. Hensche et B. Lutz) aux Perspectives de la protestation (Syllepse, 1997) ; que ce soit au sujet de la guerre des Balkans ou, en février 2001, des atteintes aux droits de l’homme perpétrées par un régime algérien que soutenait l’État français, il a participé, essentiellement dans Le Monde, à des prises de position collégiales ; c’est à la tête d’une équipe de chercheurs que, avec La Misère du monde (Seuil, 1993 ; «Points», 1998), il a initié un projet à la fois généreux et ambitieux qui, en donnant la parole aux exclus tout en dressant rigoureusement un état de la misère sociale dans un pays occidental — en reconstruisant objectivement le point de vue particulier des personnes interrogées, c’est-à-dire en analysant leurs conditions sociales objectives sans les réduire «à l’état de curiosité entomologique» (p. 11) —, visait à rien moins qu’un certain universel singulier ; enfin, engagé dans le mouvement social européen, qui possède son site Internet et se trouve à l’origine de manifestations diverses, il s’est montré solidaire d’autres mouvements sociaux anticapitalistes, dont il a examiné les caractéristiques communes dans ses Contre-feux 2 (à la fois particularistes et internationalistes, ils inventent de nouvelles formes d’organisation et d’action au nom d’une valeur suprême, la solidarité), collaborant avec AC ! (mouvement de lutte contre le chômage) ou ATTAC (Association pour la taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens), qui représente d’autant plus un intellectuel collectif qu’elle regroupe des intellectuels spécifiques à visée universaliste dont aucun n’est doté d’un «capital vedette» dans le champ médiatique comme dans le champ intellectuel. En ce qui concerne Sartre, la spécificité de son engagement est plutôt à chercher du côté de son activité littéraire.
université en péril (Raisons d’agir, 1997), il a en outre collaboré (avec C. Debons, D. Hensche et B. Lutz) aux Perspectives de la protestation (Syllepse, 1997) ; que ce soit au sujet de la guerre des Balkans ou, en février 2001, des atteintes aux droits de l’homme perpétrées par un régime algérien que soutenait l’État français, il a participé, essentiellement dans Le Monde, à des prises de position collégiales ; c’est à la tête d’une équipe de chercheurs que, avec La Misère du monde (Seuil, 1993 ; «Points», 1998), il a initié un projet à la fois généreux et ambitieux qui, en donnant la parole aux exclus tout en dressant rigoureusement un état de la misère sociale dans un pays occidental — en reconstruisant objectivement le point de vue particulier des personnes interrogées, c’est-à-dire en analysant leurs conditions sociales objectives sans les réduire «à l’état de curiosité entomologique» (p. 11) —, visait à rien moins qu’un certain universel singulier ; enfin, engagé dans le mouvement social européen, qui possède son site Internet et se trouve à l’origine de manifestations diverses, il s’est montré solidaire d’autres mouvements sociaux anticapitalistes, dont il a examiné les caractéristiques communes dans ses Contre-feux 2 (à la fois particularistes et internationalistes, ils inventent de nouvelles formes d’organisation et d’action au nom d’une valeur suprême, la solidarité), collaborant avec AC ! (mouvement de lutte contre le chômage) ou ATTAC (Association pour la taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens), qui représente d’autant plus un intellectuel collectif qu’elle regroupe des intellectuels spécifiques à visée universaliste dont aucun n’est doté d’un «capital vedette» dans le champ médiatique comme dans le champ intellectuel. En ce qui concerne Sartre, la spécificité de son engagement est plutôt à chercher du côté de son activité littéraire.
Mais en quoi consiste l’engagement de l’écrivain ? A exprimer une expérience à la fois singulière et universelle grâce à une utilisation particulière du langage commun visant à lutter contre sa fonction informative et signifiante — à «faire de son être-dans-le-langage l’expression de son être-dans-le-monde» (p. 448) —, nous répond-il dans le Plaidoyer pour les intellectuels. C’est dire que, plus essentiellement encore que l’intellectuel, dont la «conscience malheureuse» ne naît que de la contradiction entre son universalisme professionnel et son particularisme idéologique, celui qui, dans son métier même, est animé par la tension entre universel et singulier — tension qui peut, comme c’est le cas pour Sartre, être exacerbée par celle entre son public idéal (l’humanité entière) ou virtuel (la petite bourgeoisie intellectuelle et une partie du prolétariat non communiste) et son public réel (bourgeoisie cultivée) —, est un miroir critique de son temps : l’œuvre critique est un objet littéraire autonome qui fait passer «la collectivité […] à la réflexion et à la médiation», lui fait acquérir «une conscience malheureuse, une image sans équilibre d’elle-même qu’elle cherche sans cesse à modifier et à améliorer» (S. II, p. 316). Jean-François Louette parle d’engagement négatif, dans la mesure où le style est requis pour faire passer le contenu subversif. Il montre également que le style est le seul moyen efficace de dépasser la contradiction radicale entre universel (le langage d’autrui) et singulier (la parole individuelle) .
Afin de comprendre en quoi réside l’engagement de Sartre dans ses écrits (auto)biographiques (son auto-objectivation), il suffit de mettre en écho les propos de B. Denis — pour qui «l’interrogation biographique», qui «joue le rôle d’élément régulateur de son engagement», «est à la fois questionnement sur ce qui fonde tout engagement et dépassement de celui-ci dans une connaissance empathique de l’homme» (p. 273) — et ce qu’écrit J.-F. Louette dans «Ecrire l’universel singulier» et la dernière partie de Sartre contra Nietzsche («Sur l’engagement sartrien»). Là où il démontre qu’avec Les Mots, Sartre livre aux intellectuels de sa génération une autocritique exemplaire : la dialectique met Sartre en mesure de se situer historiquement et sociologiquement et ainsi, par ce travail d’autodémystification et de libération, d’offrir un modèle d’«invention totalisante de soi» et de politique de la «transparence oblique» (p. 384) ; dans Sartre contra Nietzsche, il ajoute que, grâce à cette méthode dialectique, Sartre narrativise une critique de la troisième République, opère la genèse d’une conscience malheureuse qui a plus de points communs avec l’aventurier qu’avec le militant et représente ironiquement ses rapports avec les communistes.
En définitive, on ne peut pas dire que Bourdieu ait rompu avec le modèle sartrien de l’intellectuel. Confronté au même problème que Sartre (le rapport entre l’individuel et le collectif, la liberté et le déterminisme, l’universel et l’être-situé), il a remplacé la question sartrienne : comment et dans quelle mesure l’intellectuel peut-il réaliser en lui-même mais pour tous le modèle de l’homme total, c’est-à-dire totaliser l’humain, être à la fois universel et singulier ?, par cette autre : comment et dans quelle mesure l’intellectuel peut-il, d’une part, s’objectiver en tant qu’intellectuel avant de prétendre tenir un discours sensiblement objectif sur le monde social, et, d’autre part, après avoir déjoué du mieux possible le piège de l’autoprojection, aboutir à une compréhension scientifique de l’objet analysé qui prenne en considération son point de vue particulier ?
En fait, Bourdieu, tout comme Sartre — qui, quoiqu’il ait inéluctablement commis des erreurs, est un modèle d’autocritique —, représente un type d’intellectuel critique un peu différent de l’intellectuel classique, au sens où il adhère à cette idée, qu’il essaie de mettre en pratique, que tout intellectuel doit faire précéder toute critique d’une critique de l’intellectuel ou, plus précisément, de son être-intellectuel. Sartre et Bourdieu sont ainsi deux intellectuels critiques, c’est-à-dire ni universalistes ni spécifiques, dont les moyens, les visées et la vision du monde divergent : d’un côté, un utopisme humaniste qui, alimenté non seulement à une philosophie de la liberté mais encore à une mythologie personnelle (cf. Les Mots) et une mythologie collective qu’a favorisée l’autonomisation du champ — contre lesquelles Sartre n’a cessé de se prémunir —, et s’appuyant sur le marxisme, le raisonnement dialectique, ou encore la psychanalyse existentielle, offre un modèle héroïque de l’intellectuel-artiste (cette «conscience malheureuse» qui, incarnant les tensions et les paradoxes de la sphère sociale, s’engage dans le monde et dans son œuvre), mais aussi une anthropologie concrète trouvant sa meilleure expression dans des écrits (auto)biographiques qui réalisent l’auto-objectivation du sujet écrivant (l’écrivain atteint alors l’«universel singulier») ; de l’autre, un utopisme réaliste qui, fondé sur l’expérience sociale de la désillusion et avec pour outils scientifiques la double historicisation, l’exégèse herméneutique et l’enquête statistique et qualitative, vise à révéler aux agents les contraintes qu’exerce leur champ sur eux au travers de leur habitus, et par là même s’érige contre toutes les formes de domination symbolique — qui, en proposant le modèle de l’intellectuel collectif et «l’objectivation du sujet de l’objectivation», vise à lutter contre la dérive prophétique de l’intellectuel classique.
L’intellectuel critique aujourd’hui : de la praxis individuelle à la praxis commune Être et faire
Si, jusqu’à présent, les intellectuels français n’avaient pas vraiment eu intérêt à ce que soit radicalement bouleversée une société dans laquelle ils occupaient une place non négligeable, désormais ils ne peuvent que s’inquiéter. D’abord, parce que l’autonomie de leur champ est plus qu’en péril : tandis que s’accroît le nombre d’«intellectuels précaires» (Cf. Anne et Marine Rambach, Les Intellos précaires, Hachette, «Pluriel», 2002), que les crédits pour la recherche sont dérisoires et que s’est enclenché le processus de regroupement en pôles de compétitivité de chercheurs dont le statut nuit à leur indépendance et leur efficacité, l’existence même des intellectuels est menacée dans une société médiatico-marchande qui les tourne en dérision et dans un système de reproduction du corps enseignant qui favorise le technicisme dans le secondaire (la prolifération de ceux que Sartre appelait les techniciens du savoir pratique) et, dans le supérieur, l’académisme et le carriérisme ; en outre, les lois du Marché régissant les sphères culturelles, les créateurs les plus audacieux ont de moins en moins de visibilité, victimes d’une production de masse qui aboutit à la sensure (Néologisme de Bernard Noël dans une lettre de novembre 1984 adressée à Serge Fauchereau (cf. «La Pornographie», in Le Château de Cène, Gallimard, 1969 ; rééd. «L’Imaginaire», 1990 p. 180)), censure économique qui sanctionne tous effets de sens (et notamment ceux engendrés par l’invention de nouvelles formes) par le biais des canaux de production, de diffusion, de vente et de réception critique. Sur un plan plus directement politique, leur position est des plus inconfortables depuis que, avec sa fondation destinée à favoriser les échanges entre penseurs, chercheurs et syndicalistes modérés, l’UMP a lancé une OPA sur les milieux intellectuels et universitaires afin de rénover les fondements idéologiques d’un «libéralisme à la française» (exception culturelle oblige !), et que les fast thinkers conservateurs n’ont de cesse que de se faire les chantres de la «mondialisation de la démocratie» et, tout à fait logiquement, les pourfendeurs de l’irresponsabilité des intellectuels — emboîtant ainsi le pas au Michel Crozier du rapport de la Commission trilatérale («The Crisis of Democracy», 1975), pour ne citer que l’un des pionniers en la matière —, de l’anti-américanisme, des survivances archaïques, des conservatismes corporatistes, etc. Voilà autant de raisons particulières qui, s’il en était besoin, devraient pousser les intellectuels français — connus, reconnus, méconnus ou inconnus — à (re)mettre leurs compétences au service de leur propension à se révolter, c’est-à-dire à renouer avec la tradition «d’ouvrir sa gueule» en faisant rendre raison à la Raison économique et en observant d’un œil critique un «monde de l’après 11 septembre» où les Maîtres brandissent (avec succès !) l’épouvantail du terrorisme et autres alibis pour remettre en place un dualisme fédérateur qui leur faisait défaut depuis la chute du Mur (au conflit est/ouest s’est substitué celui entre nord et sud, qui, consubstantiel à une vision manichéenne — civilisation vs barbarie —, prend l’allure d’une antique croisade contre les forces du Mal), et où la barbarie capitaliste a pris un visage humain, les Grands feignant «la compassion»…
En cette aube du XXIe siècle où il est matériellement plus facile de créer un lieu d’expression (revue, site internet…) et où les universités et les divers centres de recherche disposent encore d’une certaine autonomie et d’un peu de moyens, il est grand temps qu’un maximum d’intellectuels poursuivent et renouvellent la voie ouverte par Sartre et Bourdieu. Mais que peut bien recouvrir aujourd’hui le label «intellectuel critique» ? Une pratique, et non un état ou un statut symbolique. Conscient qu’«on a raison de se révolter» et qu’être c’est faire, il s’agit pour tout intellectuel critique de mettre à distance son être-intellectuel pour adopter une démarche qui produise des effets critiques. Tout le problème est de savoir comment mettre sa compétence au service des dominés sans perdre une spécificité capable de garantir l’efficacité de l’action. (Peut-il y avoir révolte sans pensée de la révolte ?). Car il serait vain que l’intellectuel mette entre parenthèses sa différence d’habitus avec le routier, le cheminot ou tous les «sans», pour feindre d’être comme «le peuple» : l’être-avec est préférable à un ersatz d’être-comme. Il importe donc de ne pas se lancer dans un militantisme de bonne conscience. Il n’est pas non plus indispensable que les penseurs soient les acteurs : les intellectuels ne sont peut-être pas les mieux prédisposés à l’Agit Prop ou à l’intervention médiatique… Bref, tout intellectuel n’est pas José Bové, mais tout José Bové n’est pas intellectuel.
C’est ici qu’il faut d’abord s’interroger sur la notion même d’intellectuel collectif, avant de réfléchir sur la constitution d’un collectif et les conditions de son engagement. Pierre Mounier y voit «une contradiction dans les termes», jugeant problématique, non seulement l’extension au collectif d’un mode d’intervention individuel, mais encore l’exportation de ce mode d’action dans l’ensemble du monde social : «si la ruse de la raison peut fonctionner à l’intérieur du champ intellectuel du fait précisément de l’autonomie de ce champ, en transformant les intérêts particuliers des individus en intérêt pour la raison, qu’en peut-il être lorsque ceux-ci sortent précisément du champ pour intervenir dans un espace social qui n’a pas les mêmes valeurs ?» (2001, p. 224). Aussi faudrait-il plutôt parler de «collectif d’intervention démocratique», de «groupe de réflexion politique»… Afin d’éviter l’institutionnalisation et l’agrégation d’intérêts particuliers en groupe de pression, ce type de formation devrait être à chaque fois un groupe en fusion qui, apparu dans des circonstances favorables, s’organise selon un modèle de type fédératif, et non pyramidal, et s’appuie sur des forces capables de «travailler à inventer et à construire un ordre social qui n’aurait pas pour seule loi la recherche de l’intérêt égoïste et la passion individuelle du profit, et qui ferait place à des collectifs orientés vers la poursuite rationnelle de fins collectivement élaborées et approuvées» (Contre-feux, p. 119). Une telle organisation pluridimensionnelle et occasionnelle serait en mesure de fournir des garde-fous contre l’intellectualocratie et l’intellectualocentrisme — lequel réside dans l’universalisation d’un ethos et d’intérêts particuliers. Car il ne saurait y avoir de véritable objectivation qu’interindividuelle : seul un groupe interdisciplinaire et réellement pluriel pourrait favoriser la double historicisation des prises de position (leur situation par rapport à des trajectoires individuelles et à la doxa épistémologique et scolastique) ainsi qu’une réflexion sur la construction de l’objet et les limites des modalités d’application théorique qui déterminent les limites des modalités d’intervention. Dès lors, apparaîtrait une forme d’engagement qui se distinguerait de la stratégie individuelle : il s’agirait de mobiliser dans le domaine public des expériences acquises individuellement ou collectivement (au sein d’un groupe de chercheurs ou d’une association quelconque) ; quelle que soit sa trajectoire dans son champ d’appartenance — quel que soit son capital symbolique —, chaque intellectuel devrait actualiser sa rupture avec un certain élitisme et différencier nettement son œuvre individuelle et ses contributions à une stratégie collective.
Petit exercice critique : Que le néo-libéralisme n’est pas un humanisme…
Dans la perspective d’une sociologie critique, le démasquage d’une idéologie dominante d’autant plus efficace que produite et/ou relayée par des think tanks et divers médiateurs socioculturels, peut s’opérer au moyen d’un examen historicisant et herméneutique des concepts, topiques et stratégies discursives. C’est cette approche qui guidera ici ma micro-analyse de ce que, dans la France d’aujourd’hui, j’appellerai le néo-libéralhumanisme. Une telle orientation idéologique, qui se ressource dans la pensée de Tocqueville, Constant, Aron et, sur le plan économique, Cannac, sert de ciment aux diverses fractions d’une droite qui se veut moins dogmatique et plus pragmatique — une «nouvelle droite» qui se démarque du courant étatiste de l’après-guerre et de celui qui, proche du néo-libéralisme anglo-saxon, a prévalu — et échoué — entre 1986 et 1988 (bref, celle de Jean-Pierre Raffarin et de Dominique de Villepin, par opposition à celle de Alain Madelin et de Nicolas Sarkozy ). On prendra comme point de départ la «charte des valeurs» que l’UMP a lancée en novembre 2002 («Liberté, solidarité, responsabilité, nation, Europe») et des points de vue révélateurs de nos deux derniers chefs de gouvernement : pour J.-P. Raffarin, il faut demeurer dans «l’esprit de mai» (cf. Cent minutes pour convaincre, France 2, 26 septembre 2002) — façon de confronter malicieusement l’esprit qui s’est amorcé lors de la réélection de Jacques Chirac et la «pensée 68» —, et, rejoint en cela par son alter ego «humaniste», Dominique de Villepin, c’est l’homme qui a charge de son destin, et non la société.
L’un des livres dans lequel cette droite s’est immédiatement reconnue est celui que Luc Ferry et Alain Renaut ont fait paraître chez Gallimard en 1985, qui rend subtilement responsable la pensée 68 (celle des Foucault, Derrida, Bourdieu, Lacan…) d’un individualisme contemporain que Gilles Lipovetsky, dans L’Ere du vide (1983), qualifie de problématique — parce que, entérinent les deux auteurs, l’individualité s’est désintégrée, le sujet est devenu hétéronome. Selon eux, en effet, cette pensée 68 a provoqué rien moins qu’une catastrophe ontologique, le sujet autonome cédant désormais la place aux structures, aux déterminations inconscientes et socio-économiques, à l’altérité, la différance… Ce qu’ils récusent est ce qu’on pourrait appeler la topologisation du sujet, son altérisation : pour eux, un double anti-humanisme fait de l’homme un lieu d’expression d’antagonismes socio-économiques et le lieu de l’avènement de l’Etre. S’ils reconnaissent que «la philosophie française des années 68 a eu le mérite (s’il n’en est qu’un, ce sera celui-là) de remettre en question les fondements métaphysiques de l’humanisme traditionnel et naïf» (p. 24), ils rejettent ce qui la rapproche de la métaphysique traditionnelle, à savoir son caractère réifiant. Et s’ils acceptent une dimension existentialiste déjà présente chez Rousseau, Kant et Fichte, ils exigent «que soit prise en compte la signification de cette ouverture constitutive de l’ek-sistence […] : l’idée d’humanité ne surgit comme telle que si l’ouverture peut être pensée à partir de cet horizon d’autonomie qui lui confère son sens et sa représentabilité» (p. 265). Leur point d’aboutissement, malgré qu’ils en aient, est donc des plus traditionnels : avec pour tremplin la bonne vieille dichotomie liberté/déterminisme, leur humanisme revient à réaffirmer la capacité de l’homme à choisir ses propres fins.
La même année, dans leur troisième tome de Philosophie politique, Des droits de l’homme à l’idée républicaine (PUF, 1985), ils avaient proposé de voir dans l’idée républicaine une conciliation légitimiste — une synthèse molle — d’une pensée libérale légaliste qui, privilégiant les droits-libertés, préconise une politique de l’entendement, et d’une pensée socialiste métaphysiciste qui, accordant la priorité aux droits-créances, opte pour une politique de la raison. La quête entreprise par Luc Ferry d’un humanisme non métaphysique le conduit à faire de positivité vertu : s’interroger sur le sens de la vie (cf. L’Homme-Dieu ou le sens de la vie, Grasset, 1996), c’est donner dans un humanisme spiritualiste qui «a ceci de commun avec le religieux qu’il reconnaît le mystère de l’homme, de sa conscience pour elle-même, son statut unique et hors nature, sa vocation morale, et fait de l’amour une expérience capable de donner un sens à la vie» — un humanisme spiritualiste qui a trouvé à s’épanouir dans un «univers laïque et individualiste, qui laisse à la liberté de l’homme toute sa place» (entretien dans Sciences Humaines, n° 25, sept. 1996). Lequel univers laïque est né à la fin du XVIIIe siècle, en même temps que l’idéologie des droits de l’homme et des valeurs individualistes : «L’humanitaire est inséparable de la naissance de la famille et de l’amour moderne, c’est-à-dire du mariage d’amour, qui introduit le sentiment entre les époux et entre les parents et les enfants. L’amour de ses proches peut servir de médiation pour accéder à l’universel». Son credo : l’homme est libre ; derechef, les sciences humaines sont coupables de réductionnisme… Et si d’aventure, au détour de phrases introductives (cf. Qu’est-ce qu’une vie réussie ?, Grasset, 2002), il déplore le triomphe de la raison instrumentale, de la logique de la concurrence au détriment de la logique du sens, ce n’est pas pour remettre en question le nouvel ordre économique, mais pour revenir sur la sagesse de l’Homme-Dieu. Dix ans plus tôt, c’était le nouvel ordre écologique qu’il dénonçait comme rétrograde (Grasset, 1992) : exalter la pureté de la nature, c’est oublier que l’homme, contrairement à l’animal, n’est pas déterminé par sa nature. S’ériger en chantre de l’Homme, c’est assurément se donner le bon rôle : tout le monde sait qu’il ne sied pas de jouer les Cassandre… Ce moralisme néo-néokantiste est à mettre sur le même plan que les pensées néo-rationalistes.
La pensée libérale, qu’elle soit d’ordre philosophique, sociologique ou économique (que l’on songe à l’individualisme méthodologique, aux théories rationnelles de l’action ou à l’économisme de Gary Becker, prix Nobel d’économie en 1992 et théoricien du «capital humain»), est par nature essentialiste et antigénétique. Se défiant de l’État — toujours suspecté de porter en soi le germe d’un collectivisme uniformisant et d’un dirigisme totalitarisant —, elle conçoit l’individu comme un être rationnel capable de se déterminer librement — ce qui est une façon de se démettre sur lui de toute responsabilité et, plus insidieusement encore, de le rappeler à l’ordre (un individu responsable est un être-de-devoir : l’ordre rationnel dissimule un ordre moral). Tout comme la liberté, la solidarité s’accompagne d’un garde-fou conservateur, absent de la charte celui-là, car implicite : le non-assistanat. On le voit, si, en théorie, ce libéralhumanisme qui prend pour appui une philosophie rationaliste et volontariste prône une liberté inconditionnée (tout individu est libre de ses choix et tous les individus sont libres en droit), dans les faits cette liberté doit souffrir de sérieuses restrictions normatives, psychologiques et socio-économiques : l’individu-citoyen doit indéfiniment prendre ses responsabilités et remplir ses devoirs ; l’individu-consommateur est à ce point un être autonome (rationnel et donc libre) que la société marchande s’adresse en permanence à l’homme pulsionnel, le stimulant sans cesse — avec succès ! — ; l’homo communis — c’est-à-dire l’exclu de toute méritocratie et de toute oligarchie — n’a pas l’opportunité de poser librement ses fins (non seulement il ne dispose pas des capitaux — économique, social et culturel — nécessaires à la réalisation de ses projets, mais en plus il est conditionné à «garder sa place»). Le moralisme, l’intellectualisme ou l’essentialisme sont des luxes — voire, des ruses — de dominant qui permettent d’en rester au «débat d’idées» et de faire l’économie d’une réflexion sur les rapports de force et sur l’individualisme contemporain : tandis que la pensée substantialiste se nourrit de grands principes (liberté, solidarité,…) sans se préoccuper des conditions de leur application et procède par réification, en posant par exemple que l’homme postmoderne est destructuré, la pensée génétique prend pour objet la structuration de l’espace social (la prédominance du champ économique sur tous les autres champs), le mode de fonctionnement du champ du pouvoir et les modalités d’exercice de la domination, les facteurs psychologiques, culturels, idéologiques et socio-économiques susceptibles d’expliquer certains invariants dans les comportements des acteurs, les conditions subjectives et objectives de différenciation entre les acteurs, ou encore le processus d’individuation qui dévoile la violence symbolique.
C’est ainsi que, en suivant la logique de Bourdieu — et en synthétisant à l’extrême —, on peut rendre compte de l’individualisme contemporain par le triomphe de la pensée néo-libérale : elle a en effet réussi à imposer «l’individualisation de la relation salariale» (Contre-feux, p. 111) et, par le biais du vote et du sondage, la sérialisation «démocratique». Comme il l’affirme dans une conférence de 1973 : «Avec le sondage, ou le vote, comme avec le marché, le mode d’agrégation est statistique, c’est-à-dire mécanique et indépendant des agents» (Propos sur le champ politique, p. 85). Or, «le mode de production atomistique et agrégatif cher à la vision libérale est favorable aux dominants qui ont intérêt au laisser-faire et peuvent se contenter de stratégies individuelles (de reproduction) parce que l’ordre social, la structure, joue en leur faveur» (p. 87). Quant à la fameuse «crise des valeurs» et à la désagrégation du sujet, elles sont liées à un individualisme consumériste qui exalte le pulsionnel, à une situation d’anomie tout à fait particulière qu’on pourrait qualifier de panomique : dans une société marchande hyperrelativiste, où les incitations au travail ne peuvent rivaliser avec les invitations au divertissement et où, parce que «tout se vaut», c’est à chacun de faire son choix, c’est-à-dire de se donner les moyens d’assouvir ses envies, c’est bien la déréglementation axiologique qui crée le malaise dans la civilisation. (Sans oublier non plus l’anomie économique, que Durkheim définit comme un décalage entre les aspirations matérielles des individus et leur situation). Reste à évoquer la stratégie discursive des défenseurs de la pensée néo-libérale (politiciens et doxosophes), des partisans de la révolution conservatrice : leur coup de force rhétorique consiste à inverser les rapports dominant/dominé (à faire passer pour dominante la pensée dominée) ; leur imposture à adopter la posture critique propre aux avant-gardes politiques et artistiques (aux minorités originales) pour fustiger une pensée unique qui n’est plus la pensée dominante mais la critique de la pensée dominante. Quelques exemples de cette rhétorique révolutionnaire-réactionnaire : ce n’est pas l’impérialisme américain qu’il faut combattre, mais l’anti-américanisme ; nos nouveaux Maîtres, gavés de la «pensée Bourdieu-Bové», ne sont autres que les communautaristes, les «zélotes des ONG», les féministes, les gays, etc. ; le pouvoir n’appartient pas aux décideurs politiques et économiques, mais aux antimondialistes qui (se) manifestent dans les rues (déclaration de Jean-Marie Meissier lors d’une des dernières émissions de M. Field sur France 3) ; les vrais privilégiés, ce sont les fonctionnaires et tous ceux qui bénéficient d’acquis sociaux ; l’anticonformisme aujourd’hui, c’est de contester l’idéologie permissive née de 1968… Cette rhétorique est d’autant plus pernicieuse que, vu la suprématie des forces néo-libérales, elle envahit une bonne partie de l’espace public. Les conservateurs ont donc toutes les chances de remporter la lutte sociale pour la conquête de labels valorisants : innovation vs conservation ; réforme vs conservatisme ; moderne vs archaïsme ; humanisme vs anti-humanisme ; anticonformisme vs conformisme ; individualisme vs étatisme ; libéralisme vs totalitarisme… Oui, décidément oui, il est temps pour l’intellectuel «d’ouvrir sa gueule».
Non, décidément non, le néo-libéralisme n’est pas un humanisme.
(1) Cf. Pierre Bourdieu, Les Enjeux philosophiques des années 50, Centre Georges-Pompidou, 1989, p. 18, et son entretien avec Franz Schultheis sur Sartre, d’abord paru dans Süddeutsche Zeitung, 15 avril 2000, puis dans une version française revue par F. Thumerel et corrigée par l’auteur, dans L’Année sartrienne. Bulletin du Groupe d’Études Sartriennes, n° 15, juin 2001 (cf. pp. 194-195), sans oublier son Esquisse pour une auto-analyse, Raisons d’agir, 2004 (cf. p. 21).
![[recherche] De l'intellectuel Critique, par Fabrice Thumerel](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2006/01/BourdieuSartreBackG.jpg)
![[recherche] De l’intellectuel Critique, par Fabrice Thumerel](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2006/01/band-SartreBourdIntellectuels.jpg)
Pingback: Libr-critique » [Chronique] La “crise” des intellectuels
j’avoue avoir survole car il est tard, il faudra que je lise a tete reposee.J’appartiens a une generation decue par Sartre etc mais aussi par ce que vous denoncez si bien et que je qualifie de recuperation par des courants anti-humanistes .J’aime votre conclusion: « il est temps que l’intellectuel ouvre sa gueule », en esperant que ce ne sera pas un fantoche style BHL. Il me semble que si l’intellectuel ne peut qu’etre avec, son devoir est: clarte du langage et sincerite.