 Voici la fin de l’entretien, qui fait écho à « Libr-critique dans l’espace littéraire numérique. Notes (auto)réflexives » et «De la critique et de la fonction critique en terrain miné ».
Voici la fin de l’entretien, qui fait écho à « Libr-critique dans l’espace littéraire numérique. Notes (auto)réflexives » et «De la critique et de la fonction critique en terrain miné ».
FT : Parmi les préjugés critiques, tu relèves celui de la modernité entendue comme perpétuel dépassement des formes ; et tu ajoutes : « Mais ce modèle de l’histoire esthétique est lui-même daté. D’autres modèles sont possibles, en rhizome par exemple, qui concilient le développement créatif et le retour partiel à des formes anciennes, ou plutôt à des possibilités formelles qui n’ont pas été exploitées » (p. 387). Pourrais-tu expliciter ta remarque ?
Par ailleurs, pour me faire l’avocat du diable, n’y a-t-il pas non plus un impensé dans ta conception de la critique ? Celui du sens… Quand et comment, selon toi, un texte fait-il sens ? Dans quelle mesure des créations contemporaines comme les poésies-dispositifs ou les écritures multimédias font-elles sens à tes yeux ?
PJ : Je veux dire par là que l’idéologie du dépassement des formes, d’une part est un conservatisme, puisque cela revient à ne créer qu’en fonction du passé, et un formalisme, évidemment. Je veux dire qu’un artiste est un bricoleur, qui construit sa maison avec des morceaux de récupération, se débarrasse de ceci, intègre cela, développe ici, s’arrête là. L’ensemble, éventuellement, est original, et sera peut-être du jamais vu. Notre rapport à l’art du passé est beaucoup plus complexe que la représentation rustique de la ligne droite, un cran plus loin toujours. A force de fréquenter le passé, on s’aperçoit de toutes les possibilités qui se sont ouvertes à un moment donné, et qui n’ont pas toutes été développées. On les suit. Je ne sais pas si on dépasse quelque chose : on compose. La création est une composition des temps et des langages. 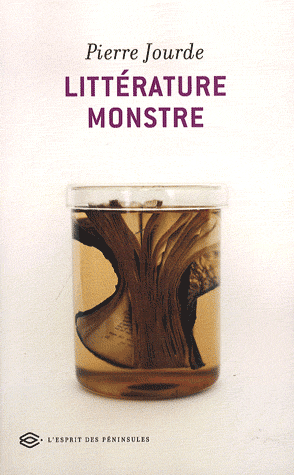
Pour ce qui est du sens, c’est une vaste question, je ne la traiterai pas ici, mais je ne l’ai nullement évitée. J’en traite surtout dans le livre sur l’incongru. Les passages sur le dépassement du symbolique dans Littérature monstre ne t’ont peut-être pas échappé, dans l’avant-propos. La dimension symbolique du sens n’est ni la seule, ni la plus intéressante dans la littérature moderne. Commenter un texte, pour moi, n’est pas montrer ce qu’il veut dire symboliquement, mais de quelle manière il creuse nos représentations pour tenter d’atteindre l’être, au sens heideggérien du terme. C’est pourquoi aussi l’art a pour moi à voir avec l’émotion, n’est pas seulement cérébral. L’émotion est inhérente à l’art, parce qu’elle est la découverte, par lui, de la consubstantialité de la chose singulière et du néant, consubstantialité qui est l’être même. L’être ne peut pas nous atteindre intellectuellement, mais sous la forme de tonalités, d’humeurs (je reste dans une ligne heideggérienne), qui sont la matière du romanesque, ou dans une extase poignante. Ce que l’on appelle le sens, c’est le dépli interprétatif de cette émotion métaphysique. Même la dimension sociale du roman obéit à ce schéma, si l’on considère que la vie sociale est une lutte et un jeu de leurres autour de la détention imaginaire de l’être. Ou encore : ce que l’on appelle le sens, en littérature, est d’abord, non l’énonciation d’un quelconque message, mais la mise en scène des discours et des bavardages qui nous colonisent, et la représentation de notre difficulté à être au monde, c’est-à-dire à laisser advenir l’être. Mais il est impossible de signifier l’être, on ne peut qu’en désigner la place.
FT : Et à la page suivante, tu affirmes : « Les problèmes que connaît aujourd’hui la littérature sont moins le fait des écrivains que des éditeurs et des journalistes qui en donnent une représentation déséquilibrée. Chercher à rééquilibrer cette représentation condamne encore aujourd’hui celui qui s’y risque à une relative solitude » (p. 388). Ce qui est une façon d’aller à l’encontre d’un préjugé à ton égard : tu conçois le critique comme un régulateur, et non comme un éreinteur…
PJ : Régulateur, c’est très juste. Mais j’assume l’ironiste en moi. Il faut faire le ménage dans nos modes de représentation, et le rire reste à mon sens le plus efficace balai. De fait, la quasi-disparition de la critique littéraire, à quelques exceptions près, du moins en ce qui concerne le support papier, demande une contrepartie. La marchandisation de la littérature s’accompagne d’une prolifération de la critique de révérence, contre laquelle il faut réagir. Elle a toujours existé, mais ce qui est nouveau, c’est qu’elle se donne en plus pour la seule légitime. Pour elle, une critique négative viendrait, par nature, d’ennemis de la littérature. Je pense que c’est exactement l’inverse, mais pour ce qui est des préjugés, j’ai eu ma dose. J’ai publié La Littérature sans estomac pour réagir aux choix d’une certaine critique, qui accordait une importance démesurée à des livres à mon sens sans intérêt, alors que la littérature compte beaucoup d’auteurs passionnants que l’on ne mentionne pas assez. Il s’agissait aussi, tout simplement, de regarder de près les textes au lieu de parler d’autre chose. Je me préparais à ce que la critique soit, en toute justice, critiquée. Je ne prévoyais pas qu’il s’agissait, pour certains, de tout autre chose : non pas de lui répondre sur le plan des textes et des idées, mais bien de lui dénier toute légitimité, et de jeter sur elle la suspicion, sur le plan idéologique ou moral.
FT : Et l’on sait où conduit le déni du dialogue critique… aux querelles claniques : « Ceux qui n’apprécient pas mes écrits sont mes ennemis, puisque appartenant à une autre chapelle »… Mais je te laisse poursuivre…
PJ : Si les soutiens ont été nombreux, de nombreuses répliques ont visé au-dessous de la ceinture. Surtout, elles ne se sont pas manifestées ouvertement : menaces épistolaires envers mes soutiens, lettres d’insultes, manœuvres pour faire supprimer des articles de moi, ou à mon sujet. Depuis, rien n’a changé. Tu parles « d’impressionnante somme », à propos de Littérature monstre, et cela me fait plaisir, bien sûr. Mais quel que soit le degré d’intérêt de ce livre, je te parie qu’on n’en parlera guère, pas plus que pour Littérature et authenticité, où j’ai pourtant eu l’impression de développer une théorie originale de la littérature. Si je fais de la polémique, je suis un amuseur, pas un penseur, ou bien quelqu’un qui déteste son époque. Ou un aigri ambitieux. Si je fais de la théorie, c’est chiant, inutile d’en parler. Ainsi va le journalisme littéraire.
La liste de ces interdits serait longue. Je me contenterai d’en évoquer deux récents : une page portrait devait paraître dans le journal Le Monde, et a été supprimée sur intervention du supplément littéraire. A la rentrée 2008, Claire Devarrieux, responsable du supplément littéraire de Libération, a déclaré à l’attachée de presse des éditions Balland qu’elle ne publierait jamais d’article sur un auteur qui a critiqué des écrivains défendus par Libération. Bien plus, l’interdiction s’étend aux auteurs publiés dans la même maison que le coupable, Balland et l’Esprit des péninsules. Ils paient pour lui.
Inutile de chercher à dénoncer ce sectarisme. On vous répondra que si on vous entend, c’est bien la preuve qu’il n’y a pas de censure, que tout cela n’est pas si grave, on n’est pas en URSS, et il y a mieux à faire que de se plaindre. De fait, cela ne m’empêche pas d’exister. Je peux m’exprimer en maints endroits, notamment ici. Mais ces coups bas constants finissent par lasser d’autant plus que beaucoup paraissent considérer tout cela comme naturel.
FT : C’est la raison pour laquelle il faut dépasser le clivage que tu analyses entre deux lieux critiques : l’un a perdu sa crédibilité (critique journalistique) et l’autre se maintient encore par trop au-dessus de la mêlée (critique universitaire)… Car tu oublies le troisième pôle antagoniste, là où a désormais lieu le débat littéraire : celui d’un certain nombre de sites et blogs littéraires exigeants…
PJ : Eh oui, tu as raison sur ce point. C’est un oubli impardonnable, et Libr.critique est le meilleur exemple de site à la fois libre et exigeant. Je n’ai pas accordé assez d’importance à internet. Mais il ne faut pas trop se faire d’illusions non plus. La contrepartie de ce foisonnement et de cette liberté, c’est que les sites intéressants se noient dans le flot de n’importe quoi proposé par des gens incultes ou sectaires. On reproduit aussi allègrement la doxa, sur internet. Et puis je suis affligé, écoeuré par 80 % des commentaires de blogs ou de sites, rédigés par des corbeaux aussi lâches qu’orduriers, des compulsifs du net et des gens qui n’ont rien à dire. La liberté est réelle, le relâchement aussi. Quant à la discussion, il arrive qu’elle ait réellement lieu, mais je vois trop souvent des gens camper dans leurs camps, sur leurs préjugés, et se bombarder de tranchée à tranchée.
FT : Évidemment, mon intention n’était, ni de requérir un compliment – mais j’y suis sensible, tu t’en doutes −, ni de me lancer dans une promotion aveugle du Net : l’important n’est certes pas le support, mais les pratiques effectives. Je fais d’ailleurs chaque jour ou presque l’expérience des phénomènes que tu dénonces ici. Mais force est de constater que cette révolution technologique a permis de sortir de la sphère commerciale et médiatique pour proposer des lieux autonomes de création et de réflexion critiques.
J’aimerais maintenant, suite à deux récents articles publiés récemment sur Libr-critique.com (« Libr-critique dans l’espace littéraire numérique. Notes (auto)réflexives) » ; « De la critique et de la fonction critique en terrain miné »), et après t’avoir lu attentivement, terminer par une réflexion sur l’actuelle situation de la critique – des plus critiques, hélas…
J’ai été très sensible à deux constats majeurs que tu dresses dans « Le Critique et son Double » : d’une part, à l’empire du discours critique (1960-1980) a succédé l’emprise du discours promotionnel, qu’il soit le fait des médias, des éditeurs, voire des auteurs eux-mêmes ; d’autre part, le politiquement correct et l’académisme ambiants constituent de solides freins, non seulement à la critique de combat telle que tu l’entends, mais encore à tous types de critique qui s’interrogent sur les valeurs éthiques et esthétiques établies (on ne peut ainsi s’en prendre ni aux canons de la modernité, ni aux écrivains en vogue, ni aux « minorités » agissantes et écrivantes…).
Pour ma part, j’ajouterai que la critique au sens où nous l’entendons – comme description et généalogie des formes, lesquelles comportent des jugements motivés sur la situation de l’œuvre, voire l’écart entre ses caractéristiques et les intentions affichées de l’auteur – est aujourd’hui prise entre deux feux : l’hyperrelativisme spectaculaire et l’académisme universitaire. Je n’insisterai guère sur ce dernier, dans la mesure où, comme tu le rappelles, l’apport à la littérature contemporaine de la critique universitaire est indéniable : on peut simplement regretter que trop souvent encore elle se cantonne aux seules « valeurs sûres » et œuvres « lisibles » (Bonnefoy, Dupin, Jaccottet ; Bergounioux, Echenoz, Le Clézio, Michon…), quand elle ne rejoint pas les valeurs du Marché (on voit même poindre de plus en plus d’articles sur Angot…).
Mais surtout, ce qui est plus grave, c’est que la puissance d’attraction de notre société anomique est telle qu’elle en vient à intégrer bon nombre d’éditeurs et d’auteurs du pôle autonome, qui désormais partagent le fantasme d’une communication directe avec le public : pour eux, la critique étant une survivance de l’esprit des Lumières, il convient de passer outre et de mettre un maximum de contenus à la disposition de destinataires autonomes. Mais ce (web)lecteur-consommateur ne saurait exister : tel l’homo oeconomicus de Bourdieu, c’est « un monstre anthropologique » issu d’une projection intellectualo-centrique. Aucun lecteur, fût-ce le critique le plus savant, ne saurait appréhender tous types d’œuvres sans médiation critique ; seul le critique-passeur replace l’objet esthétique dans une histoire, se pose la question de la valeur, et enrichit les œuvres de son expérience comme de sa lecture interprétative.
Ces dérives témoignent en fait d’une grave crise de la valeur esthétique…
PJ : Tu parles d’or, et je souscris entièrement à ton analyse. Nous avons besoin de passeurs, j’ai eu, j’ai besoin de passeurs. Il y a des critiques par lesquels, tout à coup, la lumière se fait, même lorsqu’il s’agit de polémistes ou d’ironistes. Rivarol, Bloy, Barbey, Thibaudet, Sartre, Blanchot, Bataille, Barthes, Deleuze, Richard et bien d’autres sont des éveilleurs. La représentation d’une rencontre forcément enrichissante à tous les coups entre une œuvre et une liberté pleinement assumée, immédiatement donnée, est une pure illusion, une vue de l’esprit, une négation du devenir et de la complexité. Par ailleurs, le refus de la critique, telle que je l’analyse, par exemple, dans l’essai de Bertrand Leclair, est exactement ce qui convient à la marchandisation de la littérature. L’université, de son côté, parle des textes contemporains, de plus en plus, et contrairement à ce que tu dis se confronte aussi à l’illisible. Elle aime ça, même. Mais tout est objet culturel d’égale valeur à ses yeux. Tout est objet de discours critique, Angot comme Quignard. L’intellectuel aime Angot parce que l’esprit se déteste lui-même, et n’aime rien tant que se perdre, racheter sa faute intellectuelle en se niant dans une forme de bêtise brute. Mais l’université, à mon sens, se retire un peu trop sur l’Aventin, refuse toute espèce de conflit. Elle laisse le champ libre à la critique journalistique, dont, à quelques exceptions près, la bêtise et la malhonnêteté vont croissant, jusqu’à des sommets inédits.
D’ailleurs, parlant de l’université, je ne parle en réalité que des professeurs. L’immense majorité des étudiants ignore absolument tout du contemporain. Lorsque j’ai voulu, en prenant sur mon temps libre, instituer une heure ouverte à tous de lecture de textes contemporains, à l’université (Bernard Noël, Jaccottet, Verheggen, Novarina, etc.) j’ai dû arrêter faute d’amateurs, j’avais deux étudiants sur quatre-vingts. Ça ne sert à rien pour les examens, n’est-ce pas. Il y a du travail à faire, de formation et d’esprit critique. Ce n’est pas la patouille sectaire et approximative des journaux qui nous y aidera, à quelques exceptions près. Si les jeunes découvrent la littérature dans Les Inrocks, on est mal partis.
FT : Il nous reste à biaiser, par exemple en introduisant des contemporains dans les programmes et examens… C’est ainsi que mes étudiants, en dehors des classiques de la modernité, ont eu à commenter des textes de Desportes, Ernaux, Jourde, Novarina, Pennequin… Par ailleurs, bon nombre de mes étudiants en Arts du spectacle prennent plaisir à fréquenter Bouvet, Fiat, Prigent…
PJ : Tu as raison, l’université doit agir pour la littérature contemporaine, et les étudiants y font souvent de grandes découvertes. Mais c’est un domaine dans lequel, lorsqu’ils arrivent en première année, ils sont à peu près vierges. Un ou deux peuvent avoir déjà lu du Gavalda, du Serge Brussolo, ou des anglo-saxons (Stephen King, par exemple).
![[Entretien] De la critique en terrain miné. Dialogue avec Pierre Jourde (2)](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)