Avant que de présenter quelques titres de la collection "Architextes", nous remercions la passionnée Françoise Favretto d’avoir bien voulu répondre à cinq questions sur les éditions de l’Agneau, leur revue L’Intranquille et leurs collections.
FT : On commencera par le commencement : pourquoi avoir choisi ce nom, l’Atelier de l’agneau ? Il est vrai que la Bergerie française de l’édition est envahie par les loups…
FF : N’étant pas à l’origine des éditions, je les ai reprises avec leur nom que je n’ai pas modifié. C’est dans l’ancien atelier d’un peintre que l’Atelier de l’agneau a vu le jour. Dans une rue au centre-ville de Liège, la rue de l’agneau. Je n’ai pas connu ce lieu mais je sais qu’il y avait une presse à gravure, des artistes, des écrivains, et comme figure fondatrice et unifiante Jacques Izoard. L’écrivain Eugène Savitzkaya fait partie des fondateurs, il devint assez vite un auteur reconnu publié chez Minuit et il apprécie que j’aie pu continuer les éditions.

FT : Pourriez-vous retracer votre itinéraire personnel, puis votre parcours au sein de cette maison ?
FF : Diplômée en littérature et linguistique, je n’ai enseigné que de façon sporadique, trouvant davantage de liberté dans le travail des revues (j’en ai réalisé 4), plus spontané, qui privilégie les échanges. J’ai donc commencé avec la revue 25. Puis l’édition. J’ai beaucoup écrit de critiques de livres et de revues, et je continue, lisant toujours un crayon à la main… Parler de lectures… Annoter les manuscrits… J’écris aussi des textes personnels, je dessine, voyage, photographie et crée des livres d’artistes… organise des lectures publiques. J’essaie de créer un espace pour la littérature exigeante.
FT : Sur votre site éditorial est indiqué que vous préférez des textes qui privilégient la « forme » … Qu’entendez-vous par là ? De quelle « forme » s’agit-il ?
FF : Je ne parle pas, bien sûr, des formes fixes comme le sonnet, la ballade… Par exemple, si j’aime les arbres, c’est surtout pour leur forme, ovale ou ébouriffée. Et leur ombre fantomatique dans la nuit, effrayante. L’impact, l’ombre, le contour… Je regarde d’abord cela et ensuite ce qu’ils produisent : des cerises, des kiwis…
cela et ensuite ce qu’ils produisent : des cerises, des kiwis…
De même pour les textes, la narration ne m’intéresse pas vraiment, n’étant pas lectrice de « romans ». La « forme » pour moi c’est au sens spécifique de gestalt en allemand, qui vient du verbe gestalten, « mettre en forme mais en donnant une structure qui donne du sens ».
La poésie n’advient qu’avec le travail de la forme, qui peut s’adjoindre le son. Qu’on me raconte n’importe quoi, je n’y suis sensible que si je vois/sens/entends une construction, un mouvement, une intention, un rythme. Quelque chose de structuré. En ce sens, cela peut être de la prose, je ne vois pas de grande différence entre ces genres s’il y a un travail de la pâte, soyez de bons boulangers…
A part quelques textes d’art brut, directs, tellement bouleversants, où l’on ne peut que s’incliner – mais ils sont très rares – je ne crois pas à la poésie spontanée, au « jet fulgurant ». Le poète doit trouver « sa » forme. Je dois parfois expliquer cela aux jeunes poètes : écrire est un travail…
FT : Le nom de votre revue, L’Intranquille, convient parfaitement à votre projet éditorial, non ?
FF : Agités du bocal, poissons rouges dans une écume blanche, rejetons de l’impossible, traducteurs du miroitement, décalés du corps et de l’âme, revisités à l’aune de l’intrépide, remués et remuants, troublés et troublants, les 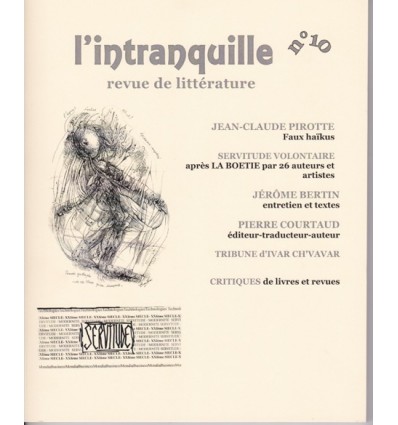 auteurs de l’intranquille vous saluent.
auteurs de l’intranquille vous saluent.
Le livre de l’intranquillité de Pessoa a donné son nom à la revue. On a aussi penché pour « Le sel des Garamanthes », symbole des longues marches des peuples du désert qui ne vivaient que de vente de sel. L’image âpre qui y était connotée révélait une nostalgie première et un peu trop ascétique, alors que « l’intranquille » dit bien l’époque. Des thématiques ont surgi d’emblée : « dégage » en 2011, « le triple A » (pour amuser les artistes visuels), « genres d’après », « servitude volontaire », « concrétisez ! » par exemple. Présenter de nouveaux poètes nous a semblé indispensable et aussi des traductions de tous pays : indiens d’Amérique (sioux), langue de Mauritanie, femmes d’Iran et tous pays européens. Une partie critique abondante termine le numéro après un passage dans l’histoire littéraire, du XVIIIe à nos jours, en essais ou journaux intimes (Michel Valprémy, Ford Madox Ford, Flaubert, Doris Lessing, etc.). Des artistes actuels illustrent ces 90 pages, surtout de dessins.
FT : Pourriez-vous maintenant esquisser l’archéologie de votre collection « architextes », qui a une place particulière dans votre maison ? Quel a été son fil rouge ? Quels liens établissez-vous entre des auteurs aussi différents que Edith Azam, Jean-Pierre Bobillot, Jacques Demarcq, Sébastien Dicenaire, Philippe Jaffeux, Marius Loris, ou encore Sylvie Nève ?
D’autres collections aussi : « transfert », « 25 », « Litté-nature » (Virgile, Rousseau, Thoreau, Reclus), « archives », « géopoétique », « ethnopoésie »…
Pour « architextes », donc : une annonce parue dans un journal comportait une coquille « cherche architextes » au lieu de « architectes ». Alors je me suis mise à en chercher… avec un pochoir (encore la forme), un critère :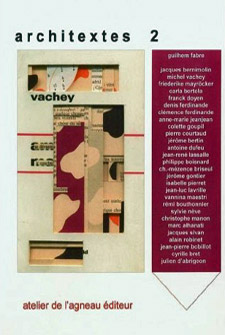 archi = excès, débordement…
archi = excès, débordement…
J’ai établi une règle interne et personnelle que voici :
Les textes doivent déborder de la norme jusqu’au syntagme. Le mot doit donc être attaqué dans le procès de démolition de l’ordre langagier établi. A partir de cela, s’est formé (oui, encore la forme) un collectif de 29 auteurs, « ARCHITEXTES 2 », préfacée par Guilhem Fabre. Puis une collection du même nom : 26 livres à ce jour et plusieurs autres en cours.
Les auteurs que vous citez dans votre question remuent les mots, peuvent casser à outrance ou pas, mais s’activent dans la destruction/recomposition.
Azam est l’invention même, achoppe sur les mots, tourbillonne et refait. Demarcq à partir des bruits d’oiseaux retrace des itinéraires poétiques. Jaffeux qui scinde, troue et perce. Dicenaire imagine une « potentiologie » où la poésie peut sauver le monde. Marius Loris 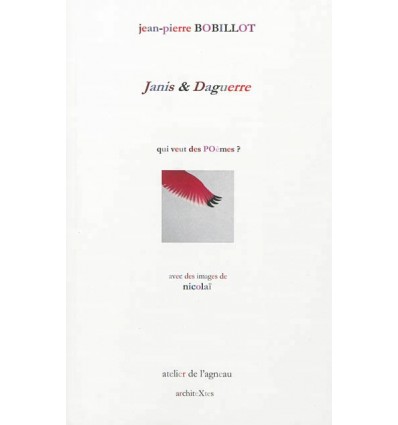 tend à l’excès dans la retranscription sonore de ses textes : les lisant, il dégrade les syllabes par sa vitesse d’élocution et finit sans plus pouvoir respirer…
tend à l’excès dans la retranscription sonore de ses textes : les lisant, il dégrade les syllabes par sa vitesse d’élocution et finit sans plus pouvoir respirer…
Et Sylvie Nève qui a toujours joué du langage comme d’une scie, Bobillot, théoricien savant, allant à l’extrême du verbe relooké…
De mon point de vue, ils ne sont donc pas différents. Tous passent par la voix, le sonore. J’en ajouterais quelques autres : les logorrhées surinvesties du si discret Denis Ferdinande (5 livres), le multilinguisme de Christoph Bruneel « ga’goes’ goet’ gro groins », les indépassables narrations de L.M. De Vaulchier envahies de dessins, Jandl et Mayröcker traduits par Lucie Taïeb pouvant passer allègrement de la collection « transfert » (traductions donc) à « architextes » tant les expériences comiques pour l’un, sensuelles pour l’autre, donnent modèle aux nouveaux auteurs.
![[Entretien] L'Intranquille Agneau, entretien de Françoise Favretto avec Fabrice Thumerel](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2017/04/AgneauLecture.jpg)
![[Entretien] L’Intranquille Agneau, entretien de Françoise Favretto avec Fabrice Thumerel](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2017/04/band-Agneau.jpg)