 Voici le deuxième extrait (lire le premier) des "Carnets de travail" qui vont être regroupés à la fin du prochain livre de François Bon, L’Incendie du Hilton, à paraître en septembre chez Albin Michel (les premiers ont paru sur le site de l’écrivain, Le Tiers Livre).
Voici le deuxième extrait (lire le premier) des "Carnets de travail" qui vont être regroupés à la fin du prochain livre de François Bon, L’Incendie du Hilton, à paraître en septembre chez Albin Michel (les premiers ont paru sur le site de l’écrivain, Le Tiers Livre).
Rêve de tête ouverte, mais proprement, par le haut : et dedans c’était exactement ce que je voulais pour mon livre, lueurs orangées ou carrément rouges avec dedans des mondes miniatures, des gens en attente.
Carnet : temps de la préparation, d’arpenter le jardin, avant de se saisir des outils, d’entrer dans l’autre zone, là-haut, l’écriture sans retour. Ce n’est pas vrai, même à l’ordinateur, qu’on efface, qu’on recommence : c’est tout de suite qu’il faut écrire juste. Et risque parallèle du carnet : se décharger ici de ce que devrait être réservé à la zone principale. Ici accumuler, construire, mais le saut, l’ambiguïté, les garder pour là-haut.
Moments où on se sentirait comme un peintre en bâtiment : tâche précise à faire, on se rend à l’endroit du chantier, on n’a aucune idée de la phrase telle qu’elle sera, sauf ce à quoi elle s’emboîte, et voilà, pinceaux et brosses, on se met au travail et ça vient. On fait les huit lignes, les douze lignes, on sait qu’on ne doit pas dépasser ou prolonger la figure. On nettoie, on range. On revient le lendemain voir. La plupart du temps, on a quitté le réel, et complètement. D’autres fois c’est plus curieux : ce qu’on a mis au jour, on découvrira ensuite que le réel le contenait, sans qu’on le sache.
Précision dans l’échelle des noms : ceux qu’on nomme explicitement, ceux dont on permet de deviner le nom probable, ceux dont on change les initiales, ceux qu’on ne nomme absolument pas. Que la variation permanente dans ce statut du nom soit l’exact lieu d’interrogation et instance de crédibilité des personnages : un roman qui passe outre ce questionnement est condamné d’avance (ce qui en fait pas mal, mais ne rassure pas pour soi-même).
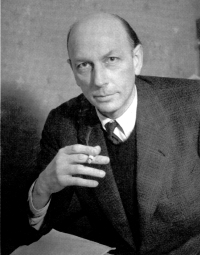 Peur du feu : elle vient pour nous autres de bien antérieur à notre condition contemporaine. C’est pour ces strates fossiles dans notre rapport au feu qu’aussi elle inquiète. Qui, pour ne pas avoir sur ses pages de peau trace ancienne de brûlure ? Dans le Agir, je viens d’Henri Michaux, la mort de Marie-Louise Ferdière : elles furent combien, cet hiver du début des années cinquante, à avoir brûlé vives dans leurs robes de chambre de nylon ? Il n’y aurait rien du Michaux ultérieur, celui de Connaissance par les gouffres, Misérable miracle, L’infini turbulent, sans cet initial sacrifice de l’épouse veillée cinq semaines en vain. Peur du feu : « ça va tellement vite », ceux qu’on a trouvés les yeux encore ébahis devant la maison détruite. Ceux qui s’immolent volontairement – encore l’hiver dernier, cette chômeuse à bout, au Mans je crois, un bidon d’essence qu’elle se verse sur elle et ça va encore plus vite que se pendre. Sauf que le geste : retourné sur nous, la communauté des autres. Jugement ces dernières semaines de ces gamines qui, à Ivry-sur-Seine, il y a deux ans, avaient voulu se venger d’une copine en mettant le feu à sa boîte aux lettres : une dizaine de morts, plutôt par asphyxie. Il y a quelques années, quand je prenais très souvent ce train de nuit, de la gare de l’Est à Nancy, ou dans l’autre sens, cette famille morte dans son compartiment, aussi : le chef de wagon avait laissé cramer sa petite cafetière électrique. Les feux qu’on a vus (le plus gros : un entrepôt, une fois, à Aubervilliers – je crois que j’étais en voiture avec Stéphane Gatti –, ces flammes grimpant à quarante mètres, les bruits d’explosion). Feu de forêt en montagne, vu à peu de distance (une forêt qu’on aimait, où on avait marché peu avant), feux aperçus très près depuis l’autoroute. Peur du feu : les feux qu’on a faits.
Peur du feu : elle vient pour nous autres de bien antérieur à notre condition contemporaine. C’est pour ces strates fossiles dans notre rapport au feu qu’aussi elle inquiète. Qui, pour ne pas avoir sur ses pages de peau trace ancienne de brûlure ? Dans le Agir, je viens d’Henri Michaux, la mort de Marie-Louise Ferdière : elles furent combien, cet hiver du début des années cinquante, à avoir brûlé vives dans leurs robes de chambre de nylon ? Il n’y aurait rien du Michaux ultérieur, celui de Connaissance par les gouffres, Misérable miracle, L’infini turbulent, sans cet initial sacrifice de l’épouse veillée cinq semaines en vain. Peur du feu : « ça va tellement vite », ceux qu’on a trouvés les yeux encore ébahis devant la maison détruite. Ceux qui s’immolent volontairement – encore l’hiver dernier, cette chômeuse à bout, au Mans je crois, un bidon d’essence qu’elle se verse sur elle et ça va encore plus vite que se pendre. Sauf que le geste : retourné sur nous, la communauté des autres. Jugement ces dernières semaines de ces gamines qui, à Ivry-sur-Seine, il y a deux ans, avaient voulu se venger d’une copine en mettant le feu à sa boîte aux lettres : une dizaine de morts, plutôt par asphyxie. Il y a quelques années, quand je prenais très souvent ce train de nuit, de la gare de l’Est à Nancy, ou dans l’autre sens, cette famille morte dans son compartiment, aussi : le chef de wagon avait laissé cramer sa petite cafetière électrique. Les feux qu’on a vus (le plus gros : un entrepôt, une fois, à Aubervilliers – je crois que j’étais en voiture avec Stéphane Gatti –, ces flammes grimpant à quarante mètres, les bruits d’explosion). Feu de forêt en montagne, vu à peu de distance (une forêt qu’on aimait, où on avait marché peu avant), feux aperçus très près depuis l’autoroute. Peur du feu : les feux qu’on a faits.
On a chacun travaillé sur son 11 septembre. On croit même, à quelques années, le travail achevé en soi. Nous avons visité le mémorial, regardé les jeux de clés, les photos, les objets. On a entendu les messages téléphoniques laissés sur les répondeurs, vu les archives film. On s’est immobilisé longtemps sur la galerie surplombant le chantier. Dans cet article que j’avais rédigé (les journaux s’aperçoivent de notre existence dans ces occasions, on nous demande notre avis en cinq mille signes, puis disparaissez), le visage de cette gamine tout en haut des deux tours, quinze mois plus tôt. Dans cette salle avec vue des quatre côtés, et qui oscillait lentement (les architectures de cette taille, même en béton, ne sont jamais totalement rigides – c’est même peut-être cette oscillation qui fascinait encore plus que l’horizon urbain ainsi surplombé), elle tenait le bar où nous avions pris un café et un thé, même genre qu’au Tim Hortons : grands gobelets de breuvage trop chaud et sans vraiment de goût. J’étais retourné lui demander je ne sais quoi, j’avais eu du mal à bien comprendre ce qu’elle m’expliquait, pour cela qu’après son visage me revenait. Et cette nuit-là aussi, au Hilton, descendant en masse serrée, poussés par les types en casque et visière, l’étroit escalier de secours dont on découvrait l’existence : et si ce chemin-là, comme il l’avait été pour ceux des étages supérieurs du 11 septembre, avait été coupé – qu’on serait restés là, contraints à remonter, empêchés probablement par ceux qui venaient après nous ?
visité le mémorial, regardé les jeux de clés, les photos, les objets. On a entendu les messages téléphoniques laissés sur les répondeurs, vu les archives film. On s’est immobilisé longtemps sur la galerie surplombant le chantier. Dans cet article que j’avais rédigé (les journaux s’aperçoivent de notre existence dans ces occasions, on nous demande notre avis en cinq mille signes, puis disparaissez), le visage de cette gamine tout en haut des deux tours, quinze mois plus tôt. Dans cette salle avec vue des quatre côtés, et qui oscillait lentement (les architectures de cette taille, même en béton, ne sont jamais totalement rigides – c’est même peut-être cette oscillation qui fascinait encore plus que l’horizon urbain ainsi surplombé), elle tenait le bar où nous avions pris un café et un thé, même genre qu’au Tim Hortons : grands gobelets de breuvage trop chaud et sans vraiment de goût. J’étais retourné lui demander je ne sais quoi, j’avais eu du mal à bien comprendre ce qu’elle m’expliquait, pour cela qu’après son visage me revenait. Et cette nuit-là aussi, au Hilton, descendant en masse serrée, poussés par les types en casque et visière, l’étroit escalier de secours dont on découvrait l’existence : et si ce chemin-là, comme il l’avait été pour ceux des étages supérieurs du 11 septembre, avait été coupé – qu’on serait restés là, contraints à remonter, empêchés probablement par ceux qui venaient après nous ?
 « On n’écrit pas dans le retrait, ce n’est pas vrai. Dans le retrait de parole, certainement : tu as parlé dans le jour, tu n’écriras pas le lendemain. Pour le reste… Savoir qu’on ne doit pas se tromper : et l’aberration même du texte, la prendre comme injonction. Quand tu y reviens, le lendemain, alors oui, prendre le temps. C’est là le plus difficile : la netteté, ce qu’on donne à mémoriser. Des mois, alors, si tu veux. Et laisser du vide, de l’espace pour le travail de qui le texte accueille. Alors, oui, même l’aberration, permise. – Mais ça mine, mais ça ronge… »
« On n’écrit pas dans le retrait, ce n’est pas vrai. Dans le retrait de parole, certainement : tu as parlé dans le jour, tu n’écriras pas le lendemain. Pour le reste… Savoir qu’on ne doit pas se tromper : et l’aberration même du texte, la prendre comme injonction. Quand tu y reviens, le lendemain, alors oui, prendre le temps. C’est là le plus difficile : la netteté, ce qu’on donne à mémoriser. Des mois, alors, si tu veux. Et laisser du vide, de l’espace pour le travail de qui le texte accueille. Alors, oui, même l’aberration, permise. – Mais ça mine, mais ça ronge… »
Tableau de Bosch, avec les incendies, les armées, et ces personnages errants, comme minuscules et perdus, et puis ces scènes plus grandes, coques fantastiques où on entre – le revoir avec précision. Celui qui m’avait dit, il y a tellement longtemps : « Bosch ? Un peintre pour écrivains. » Alors merci à lui, Jérôme Bosch.
![[Texte] François Bon,](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png) L'Incendie du Hilton" />
L'Incendie du Hilton" />